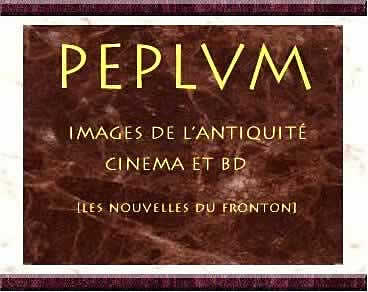 |
|
Eric
Teyssier & Brice Lopez
Gladiateurs.
Des sources à l'expérimentation
|
La gladiature a duré plus de huit siècles
et s'est déroulée dans tous les pays du
monde méditerranéen. Elle fut aussi populaire
que peut l'être le football aujourd'hui. Popularisés
et totalement déformés par la peinture et
le cinéma, les jeux du cirque font partie d'une
image stéréotypée de l'Antiquité.
Pourtant, les textes et les représentations iconographiques
permettent de restituer ce que furent ces combats qui
enthousiasmèrent les foules et provoquèrent
la construction d'amphithéâtres dans tout
l'Empire romain.
Après une minutieuse enquête historique,
le chercheur rencontre un champion des arts martiaux et
pousse l'étude jusqu'à l'expérimentation
des combats. Loin des idées reçues, un monde
de spectacle, de violence aux règles très
strictes réapparaît de façon surprenante.
Nous voilà assis sur les gradins du Colisée,
où des hommes parfois considérés
comme des héros vont s'affronter devant le peuple
et les élites de Rome (quatrième plat
de couverture).
Les auteurs exposent leur démarche scientifique
: à partir des matériaux archéologiques,
la reconstitution des armes, leur équilibrage, l'analyse
des attitudes fonction des représentations figurées,
l'évolution des armements depuis la protogladiature
- les combats funèbres comme celui décrit
au Chant XXIII de l'Iliade. Ensuite, la gladiature
ethnique (samnites, gaulois, thraces), puis l'apparition
au Ier s. de nouvelles spécialités tel l'étonnant
rétiaire, dont les «armes» n'appartiennent
à aucun usage militaire connu, et son antagoniste
attitré, le mirmillon. C'est le combat du
pêcheur contre la murène. Enfin, l'apparition
de nouvelles spécialités (secutor, provocator,
hoplomaque, scissor, etc.) qui sous le Haut Empire vont
déterminer un nouveau type d'escrime où le
bouclier devient l'élément offensif, tandis
que le gladius disparaît au profit d'armes courtes
comme le poignard thrace (falx supina) ou la dague
(pugio). |
|
|
|
| |
L'«effet Gladiator»
Avec les martyrs du christianisme et la révolte de l'esclave-gladiateur
Spartacus, le cinéma (1)
a largement diffusé auprès du grand public
des images de l'amphithéâtre («Chic, je
vais aller au cirque !», chante, dans Astérix,
le légionnaire gaffeur dont César souhaite se débarrasser).
Le poncif du pauvre bougre qui, pour une peccadille, est envoyé
affronter les fauves ou des brutes humaines. Comme si un novice
était capable d'offrir au public des afficionados
un spectacle digne d'intérêt ! L'extraordinaire succès
du récent Gladiator conforte cette image, même
si Maximus est loin, justement, d'être un combattant novice.
Ce film colporte l'idée du massacre gratuit : des gladiateurs
surarmés et surentraînés exterminent de pauvres
novices enchaînés deux à deux, aveuglés
par le soleil.
Magnifique illustration du Pollice verso de Gérôme,
le film de Ridley Scott sacrifiait trop facilement à l'exigence
d' «entertainement» du cinéma à grand
spectacle (2).
On imaginerait mal, du reste, une sorte de reportage sur une compétition
d'escrime - comme on en voit parfois à la fin du JT - avec
ses arbitres, ses commentaires techniques.
Pourtant, lesdits arbitres apparaissent fréquemment dans
les représentations figurées, point de départ
des investigations d'Eric Teyssier et du groupe ACTA Expérimentation
(Université de Nîmes), qui réunit des athlètes
de haut niveau comme Brice Lopez ou Pierre Dufour, spécialistes
des arts martiaux, qui réfléchissent sur la manière
d'utiliser les différentes panoplies. Car chaque armatura
a ses caractéristiques précises : on n'associe pas
les hautes jambières avec un grand bouclier mais avec un
petit (parma); les virevoltants rétiaires ne portent
jamais de casque qui, restreignant leur champ de vision, les handicaperaient;
la manica protège le bras droit, qui tient l'épée,
jamais celui qui brandit le petit bouclier comme on le voit dans
la plupart des péplums.
Et il ne faut pas confondre les chasses du matin et les exécutions
capitales de midi, avec les combats de gladiateurs de l'après-midi.
Les bestiaires ne sont pas de vrais gladiateurs car les bêtes
- par définition - n'obéissent à aucune règle
codifiée; quand aux exécutions capitales, elles
se passent de commentaires.
Les gladiateurs pratiquent une escrime spécifique qui
n'a du reste aucun rapport avec ce que l'on voit généralement
à l'écran : arme à la fois défensive
et offensive, le bouclier est au centre du débat, le combattant
se tassant derrière lui au lieu de l'utiliser comme contrepoids,
attitude inspirée de l'escrime contemporaine.
Un docu-fiction BBC récent a partiellement soulevé
le voile d'obscurité pesant sur la gladiature. Certes les
figures d'escrime n'y sont pas encore très au point, les
armes sont surdimensionnées, les armaturæ
incertaines, mais Tilman Remme - à partir d'une épigramme
de Martial - a reconstitué la vie d'un champion-gladiateur,
esclave qui pour échapper aux mines a librement choisi
de combattre dans l'arène (comparez avec la scène
correspondante, qui ouvre le Spartacus de Kubrick !).
Parfois, la mort vient sanctionner l'incompétence ou la
lâcheté des combattants, mais rarement. Car la formation
et l'entretien des gladiateurs coûte cher, et le «matériel»
détérioré est lourdement facturé à
l'éditeur des jeux. Le jeu consiste à soumettre
l'adversaire en l'épuisant par la lutte, en lui infligeant
des blessures légères (dans le chapitre consacré
à la protogladiature, les auteurs rappellent qu'aux jeux
funèbres de Patrocle, Ajax et Diomède s'arrêtent
au premier sang). Les gladiateurs, toutefois, sont formés
pour accepter la mort sans faiblir, tendre la gorge. On n'en attendait
pas moins dans une culture guerrière, où la valeur
de la vie humaine est très relative - a fortiori
celle d'individus socialement infâmes, paradoxalement autant
adulés que méprisés.
- L'ouvrage séduira les amateurs de péplums
comme les passionnés d'Antiquité, notamment ceux
qui pratiquent la reconstitution historique.
|
| |
|
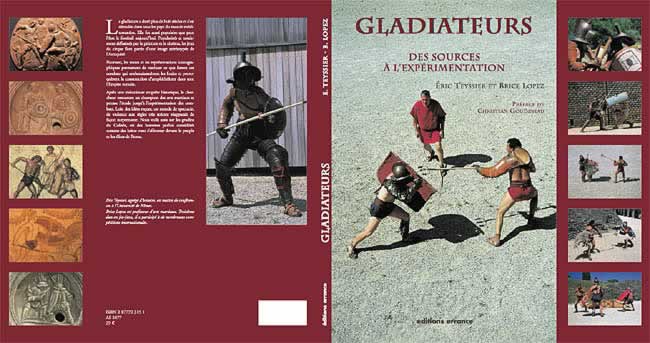
Eric TEYSSIER & Brice LOPEZ, Gladiateurs.
Des sources à l'expérimentation (préface
de Christian Goudineau),
Editions Errance, 2005, 156 p.
ISBN 2 87772 315 1 - Prix : 29 EUR |
|
| |
NOTES :
(1) S'il rectifie bien des idées
reçues, l'ouvrage d'E. Teyssier et B. Lopez n'aborde
absolument pas la question du traitement cinématographique
de la gladiature. Mais sur ce site dévoué au péplum,
nous ne pouvons évidemment pas éluder cette problématique
dans la recension de leur livre.
Pour plus ample informé, nous vous renvoyons à
notre article paru voici quinze ans : Michel ÉLOY, «Les
gladiateurs au cinéma» (pp. 277-294), in Spectacula
I. Gladiateurs et Amphithéâtres (sous la dir.
Claude Domergue, Christian Landes et Jean-Marie Pailler), Lattes,
Editions Imago [Musée archéologique Henri Pradès],
1990. - Retour texte
(2) Le même problème
se pose dans les films de cape et d'épée, où
des cascadeurs pratiquent une escrime-spectacle, qui n'a rien
en commun avec celle qui a cours dans les salles d'armes. -
Retour texte
|
|