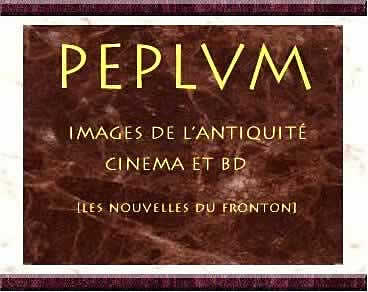 |
| |
| |
Spartacus
(Robert
Dornhelm - EU, 2004)
Le retour de Spartacus
|
|
| |
| |
| |
| Spartacus nous revient
dans une nouvelle adaptation pour la TV, signée
Robert Dornhelm. Les extérieurs furent tournés
en Bulgarie (1),
autrefois la Thrace (2).
Le roman d'Howard Fast avait déjà été
porté à l'écran par Kirk Douglas
et Stanley Kubrick en 1960 (4 Oscars en 1961 [3]).
Au contraire du Spartacus de Koestler (1939),
amer bilan d'un communiste déçu, Fast
empli d'exaltation militante composa le sien
(1951) en pleine répression maccartyste. |
Fast food
Dans ses grandes lignes le scénario de Robert Schenkkan,
prix Pulitzer en 1992 pour The Kentucky Cycle, reprend
la trame linéaire du film de Kubrick, préférable
à l'évocation toute en flash-back et
allers-retours du roman de Fast, mais
en le complétant d'éléments historiques
négligés tant par le roman original que par
la version cinématographique de 1960. Voué
semble-t-il aux remakes des grands péplums
des Sixties, le producteur Ted Kurdyla nous avait
déjà donné l'année précédente
un Helen of Troy.
Desire is War (2003) (4)
mis en scène par John Kent Harrison, qui reprenait
la trame du film homonyme de Robert Wise.
Certes, Goran Visnjic - le Dr Luka Kovac dans la série
TV Urgences - et Angus Macfadyen ne risquent pas
de nous faire oublier Kirk Douglas et sir Laurence Olivier.
Ni Ross Kemp, l'entraîneur des gladiateurs Cinna,
le Marcellus (Charles McGraw) du film de Kubrick dans le
rôle du «parfait méchant». Quand
à Charles Laughton (Gracchus) et Peter Ustinov (Lentulus
Batiatus), c'étaient des pointures, des vedettes
confirmées, que dire : des monstres sacrés,
à la cheville desquels n'arrivent pas le pourtant
excellent Alan Bates (Zorba le Grec, Love), vieilli,
méconnaissable, ni le cauteleux Ian McNeice. |
|
Déjà vu dans les rôles du roi Bruce (Braveheart,
1995), Richard Burton/Marc Antoine (The Elizabeth Taylor Story,
TV 1995), Lucius (Titus, 1999) et Zeus (Jason et les
Argonautes, 2000), Angus Macfadyen nous campe un Crassus pompeux
et affecté, pas du tout l'homme d'affaires pragmatique
enrichi par les proscriptions et la spéculation immobilière,
que l'on aurait pu imaginer. De vieille noblesse consulaire, Crassus
ne démarra-t-il pas dans la vie avec un capital de 300
talents pour, à sa mort, en laisser 7.500 ? Du reste, le
scénario écrase la chronologie historique et le
contexte politique romain pour en ramener les protagonistes à
des caricatures simplifiées. Pas évident, le métier
de scénariste ! C'est ainsi que Jules César «réconciliant»
Pompée et Crassus en... 71, anticipera quelque peu ses
bons offices de 60 (fondation du premier triumvirat). Et que rapprochées
dans le temps, les deux premières «guerres serviles»
de Sicile (138-132 et 104-100) paraîtront avoir eu lieu
l'année précédente (5).
Avec une moindre durée - Kubrick 189', Dornhelm 165' -,
le scénariste Robert Schenkkan réussira néanmoins
à développer certains épisodes de l'épopée
des gladiateurs rebelles comme : 1) la destruction de l'armée
de Clodius Glaber au pied du Vésuve (6);
2) les Romains vaincus contraints de se battre comme des gladiateurs;
3) la décimation des légions de Crassus; 4) la séparation
d'avec Crixos et la défaite de ce dernier au pied du mont
Garganus; 5) l'encerclement des rebelles dans le Bruttium à
l'automne 72 et, enfin, 6) Pompée (7)
raflant tous les mérites de la victoire, les honneurs du
Triomphe et la déception de Crassus qui ne récolte
que l'Ovation. |
|
1. Cruautés guerrières
La décimation de leurs propres troupes par les Romains,
punition militaire, la vengeance des gladiateurs rebelles qui,
tout compte fait, ne devaient sans doute pas valoir beaucoup mieux
que leurs anciens maîtres sont deux moments forts de l'épopée
historique de la Troisième guerre servile. Quid
à l'écran ?
1.1. La décimation
Selon le roman de Fast, Crassus décima dix pour cent des
5.000 hommes de la VIIe légion, soit un peu moins de 500
légionnaires si l'on considère qu'elle venait déjà
d'encourir des pertes. Selon la VF du téléfilm 2003,
«seulement» 150 légionnaires firent les frais
de la décimation
ordonnée par Crassus - il s'agissait de la légion
de Mummius (8),
qui après avoir prématurément attaqué
s'était débandée.
L'épisode est emprunté à Plutarque selon
qui, du reste, Mummius ne semble pas avoir été pris
par les gladiateurs révoltés : «4.
Crassus blâma rudement Mummius, puis arma de nouveaux soldats
en leur demandant des garants pour attester qu'ils les conserveraient
[leurs armes]. Enfin, prenant les cinq cents du premier rang
qui avaient surtout déclenché la panique, il les
partagea en cinquante dizaines et fit mettre à mort dans
chacune un homme tiré au sort. Il leur infligeait ainsi
un châtiment traditionnel qui était tombé
en désuétude depuis de longues années. 5.
Une honte particulière est attachée à ce
genre de mort, et l'exécution, accompagnée de rites
sinistres et effrayants, se fait sous les yeux de tous. Après
avoir corrigé de la sorte ses soldats, Crassus les mena
contre les ennemis» (PLUT., Crassus, IX-XV).
Crassus fit donc exécuter cinquante légionnaires
(cf. SALL., Hist., IV, 22), mais selon APPIEN (G.
Civ., I, 118) cette décimation aurait porté
sur le chiffre incroyable de quatre mille hommes, soit le dixième
de dix légions de quatre mille hommes ! Entre les deux,
le scénariste du téléfilm a donc opté
pour... plus qu'un moyen terme !
1.2. La vengeance des gladiateurs
Œil pour œil, dent pour dent. Faits prisonniers, les
généraux Marcus Servius, un ancien consul, et Pilico
Mummius, ami d'enfance de Crassus, sont contraints de se battre
à mort comme des gladiateurs, dans le roman de Fast. Mais,
selon le téléfilm 2003, le général
survivant fut ensuite, mais plus tard, crucifié - par dépit
- devant les fortifications de Crassus qui a encerclé les
rebelles dans le Bruttium (9).
Dans la version 1960, l'épisode a été décalé
au tout début de la révolte, lorsque pillant leur
villa, les esclaves contraignent deux patriciens à s'étriper
mutuellement, alors que dans le téléfilm 2003, conformément
au roman de Fast, c'étaient ces deux généraux
romains qui étaient ainsi obligés de se combattre
- ce qui est plus judicieux au niveau de l'empathie et, surtout,
moins choquant que de voir ainsi maltraités deux «paisibles
civils», âgés de surcroît, même
si de par leur position sociale on comprend qu'ils font partie
des impitoyables exploiteurs des esclaves.
En réalité cet épisode avait mis aux prises,
début 72, les 3 ou 400 survivants des légions des
consuls Publicola et Clodianus, lors des jeux funèbres
de Crixos. «Plus tard, (...) ceux qui haïssaient
le plus les esclaves, et ceux qui en savaient le moins long sur
ce qui s'était passé (10),
(...) dirent que les esclaves obligeaient les prisonniers romains
qu'ils avaient faits à s'entre-tuer [comme des gladiateurs].
(...) On fut donc assuré - comme l'ont toujours été
les maîtres - que lorsque le pouvoir échoit à
ceux qui ont été opprimés, ils s'en servent
pour faire la même chose que leurs oppresseurs. (...) Il
n'y avait jamais eu d'orgie de massacre dans l'arène
[des esclaves révoltés]... il n'y avait eu que
cette unique fois où Spartacus, animé d'une rage
et d'une haine froides, avait désigné les deux patriciens
romains (11)
en disant : Vous ferez ce que nous avons fait ! Allez nus sur
le sable, avec des couteaux, vous apprendrez comment nous mourrions
pour l'édification de Rome et le plaisir de ses citoyens»
(12). |
|
|
1.3.
Un marxiste trompé
Fast excuse les hommes de Spartacus, pour qui il prend fait
et cause en écrivant leur roman, usant de sa liberté
d'auteur-dieu pour, sinon les disculper, tout au moins minimiser
leurs crimes. Car ces représailles sont des crimes
et Varinia le fait clairement comprendre à Spartacus,
lorsque celui-ci fait crucifier le général
romain survivant (téléfilm 2003) ! «Ne
fait pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît»,
dit le proverbe. Mais les rebelles ont «déjà
donné», et doivent épancher leur rancune.
Nier leurs représailles serait aussi naïf que
de minimiser la dureté, voir la cruauté des
maîtres romains qui s'étale dans toute la littérature,
de Varron à Apulée en passant par Juvénal
et Plaute (13).
Autant prétendre que la Révolution d'Octobre
se fit sans bavures de le part des Bolcheviques, comme du
reste de la part des Blancs. Deux ans après avoir
écrit Spartacus, Fast devait recevoir le Prix Staline
de la Paix (1953), distinction rare pour un Américain,
en pleine guerre froide. Et trois ans plus tard, bouleversé
par la révélation des crimes du régime
stalinien, Fast - sans renier ses idéaux, au contraire
- démissionna discrètement du parti communiste
américain (1956). Discrètement, afin de ne
pas embarrasser ses camarades de combat.
Dans le Docteur Jivago (David Lean, 1965), conséquence
de la révolution, les communistes installaient des
miséreux sans-abris dans l'hôtel privé
du héros «bourgeois», n'abandonnant à
son propriétaire qu'une modeste chambre. La réquisition
était compréhensible, même si quelque
part dérangeante. La version 1960 de Spartacus
n'occultait pas la brutalité des esclaves révoltés,
qui parfois génère un sentiment de malaise
comme la scène du pillage de la villa campanienne,
lorsque les deux patriciens âgés dont nous
avons parlé sont contraints de se battre l'un contre
l'autre comme des gladiateurs. Utile au scénario,
la séquence du pillage de la villa patricienne,
avec son cortège de déprédations et
de vengeances offrait à Kirk Douglas-Spartacus l'occasion
d'affirmer son personnage de leader charismatique humaniste.
Spartacus peut proclamer à la face de tous la honte
qu'il y aurait, pour les esclaves, à retomber dans
les travers de leurs anciens maîtres.
Les esclaves ne vaudraient-ils pas mieux que leurs bourreaux,
dont ils prétendent s'émanciper ?
|
|
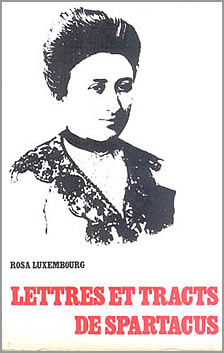
Rosa LUXEMBOURG,
Lettres et tracts de Spartacus,
Editions de la Tête de Feuilles, 1972 |
|
Dans le téléfilm 2003, la patricienne Helena et
son frère tombent entre les mains de l'armée des
rebelles et se font lyncher par leurs propres porteurs de litière
- mais hors-champ ! La caméra revient alors sur le palanquin
où gît le cadavre ensanglanté de celle qui
à l'école de Batiatus, peu de temps auparavant,
se délectait avec ses amis de la mise à mort de
gladiateurs. Spartacus en est réduit à constater
qu'il ne peut totalement contrôler les forces qu'il a déchaînées.
Certes, il arrive à les canaliser vers un but encore mal
défini, mais il ne peut empêcher les excès
ou les bavures de ces pauvres gens sans éducation, qui
ont tant souffert.
En prenant de la graine, des romanciers français plus récents
et plus réalistes, comme Joël Schmidt (1998) et Gérard
Pacaud (2004) auront de Spartacus une vision un peu moins idéalisée
: celle d'un chef de horde qui n'arrive plus à maîtriser
ses troupes. G. Pacaud soulève le voile sur un patricien
démembré à la hache, son épouse enceinte
éventrée et le fœtus arraché, jeté
aux pourceaux etc. : «Le massacre de la famille du sénateur
et de ses esclaves (restés fidèles) n'éveilla
en Spartacus aucune compassion (14).»
|
|
Joël SCHMIDT, Spartacus, Mercure de France,
1988, 207 p.
et Gérard PACAUD, Spartacus. Le gladiateur et
la liberté, Paris, Ed. du Félin, coll.
«Kiron», 2004, 280 p. |
|
Les viols en moins - qu'il faut imaginer
hors champ de la caméra -, le pillage de la villa
campanienne annonçait, dans le film de Kubrick, la fameuse
séquence du Dernier train du Katanga (Two Mercenaries,
Jack Cardiff, 1967), lorsque les passagers du train tombaient
entre les mains des rebelles mulélistes, les «Simbas»
qui massacraient hommes, femmes et enfants européens ou
africains dans des conditions atroces (15).
«C'est tout de suite l'émeute, les sévices,
le pillage. (...) Des hordes de soldats mutinés,
traînant avec eux des femmes blanches déshabillées
et sanglantes, occupent les carrefours et brisent toutes les vitrines
de Léopoldville. (...) Un seul but : humilier et
tuer les Blancs. (...) Partout des agitateurs courent le
pays et sèment la mort, au nom d'un marxisme teinté
de sorcellerie. Crimes rituels, viols, tortures, telle est leur
méthode pour prendre en main les populations de la brousse.
(...) Après les injures, les coups. On me frappe à
coups de gourdin, les machettes font des tourbillons impressionnants
au-dessus de ma tête. Tous hurlent, comme pour se donner
du courage. (...) Je songeais à ceux à qui
l'on avait coupé les bras et les jambes et enfoncé
des bâtons dans leurs plaies béantes, en les obligeant
à marcher. Et les colons, les missionnaires, les femmes
violées, les officiers massacrés par leurs hommes,
les Noirs fidèles torturés avec leurs maîtres.
Tant de sang, tant de larmes, tant de haine» (16). |
|
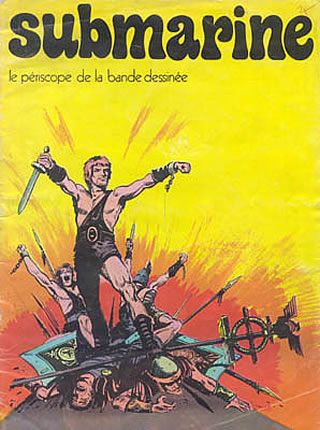
Une version bédéique de
Spartacus dessinée par Pierre-Léon Dupuis
sur scénario de Sylvie de Nussac, la critique théâtrale
du Monde ! (Submarine, Périscope de Bande
Dessinée, nĘ 7 & 8, 1974). Curieuses connotations
antifascistes : les aigles des «méchants»
romains incluent la croix celtique, symbole alternatif à
la croix gammée nazie. Le personnage de Spartacus
est dessiné d'après des photos du danseur
soviétique Vladimir Vassiliev, qui tient le rôle
titre dans la version cinématographique (1976) du
ballet de Khatchaturian |
|
Puissant ou misérable, l'homme
reste un loup pour l'homme. Toutefois, il convient de relativiser
les choses, sous peine de révisionnisme. Il ne nous appartient
pas de porter un jugement moral sur les Romains et leur système
esclavagiste qui, après tout, n'a été aboli
dans nos sociétés occidentales que depuis fort peu
de temps. Encore ne sommes nous pas toujours à l'abri de
certaines résurgences, de bouffées de totalitarisme
de droite ou de gauche faisant peu de cas de la dignité
humaine ! Jacques «Alix» Martin, dans sa BD Le
fils de Spartacus, n'a pas craint de résumer l'épopée
spartaciste comme n'étant rien de plus que le pillage de
l'Italie par une bande de brutes sauvages ! «L'on va
revoir ces bandes de pillards féroces mettre l'Italie à
feu et à sang» (p. 5, 4e v.), «ivres
de rancune, (ils) pillèrent et saccagèrent
les villes de Nola, Suesula et Calatia... Ce fut terrible»
(p. 19, 10e v.), puis ils «allèrent détruire
Métaponte, l'antique cité grecque» (p.
24, 2e v.). Et Martin de montrer, en gros plan, un gladiateur
au faciès patibulaire, serrant dans un bras un jeune garçon
terrorisé, en brandissant de l'autre main une volaille
sur fond d'incendie et de corps brutalisés. Influencé
par son ambitieuse maîtresse Maia, Spartacus se comporte
en potentat et dans sa «cité idéale»(17)
se dressent bientôt croix et gibets où se balancent
ceux qui entrent en désaccord avec lui. Les marxistes auront
beau faire sur Spartacus une projection de préoccupations
qui leur sont propres, il n'en demeure pas moins vrai que nous
ignorons tout des intentions du gladiateur thrace et de son projet
de société, s'il en eut jamais un(18).
Si leur système social était impitoyable, les Romains
nous ont au moins légué les bases de notre civilisation,
notamment les concepts de droit et de justice. Bien sûr,
leurs excellents principes étaient déformés
par les préjugés de leur temps : qui n'est pas citoyen
n'est rien, et les esclaves sont moins que rien. Mais les citoyens
eux-mêmes sont peu de chose quand l'intérêt
public est en jeu. Les Romains avaient les défauts de leurs
qualités. Les choses étaient-elles mieux chez leurs
voisins ? Il est permis d'en douter.
1.4. Le travail ennoblissait les Romains
Les choix idéologiques de Fast transsudent par tous les
pores de son bouquin. Ainsi au Sénat, le sénateur
Gracchus interroge un légionnaire rescapé, Aralus
Porthus : «As-tu un métier ? (...) Non... je n'ai
pas de métier sinon de faire la guerre, dit le soldat.
(...) Depuis combien de temps sers-tu dans la Troisième
Cohorte ? - Deux ans... et deux mois. - Et avant ? - Je vivais
des secours de la république». Instrument d'oppression,
l'armée romaine est donc le débouché naturel
des chômeurs, des propres à rien qui n'ont pas
de métier. Les guerres civiles, puis d'expansion ont
transformé le soldat-citoyen en mercenaire corps et âme
inféodé à son condottiere de général.
«Sur les terres de notre bon hôte,
pérore Cicéron, vivaient jadis au moins trois
mille familles de paysans. A raison de cinq personnes en moyenne
par famille, cela faisait quinze mille individus. Et ces paysans
étaient de rudement bons soldats (...). Et de bons
fermiers aussi. Ils ne savaient peut-être pas cultiver des
pelouses ni tracer des parcs, mais prenez l'orge. Rien que l'orge
: le soldat romain marche à l'orge (19).
Y a-t-il un arpent de ton domaine, Antonius, qui produise
moitié autant d'orge qu'un paysan travailleur parvenait
à en récolter sur la même surface ?
- On n'en produit même pas le quart, reconnut Antonius Caius.
(...)
- Et pourquoi... pourquoi ? demandait Cicero. Pourquoi
nos esclaves ne sont-ils pas capables de produire autant ? La
réponse est bien simple.
- Parce qu'ils n'en ont pas envie, déclara tout uniment
Antonius.
- Voilà... parce qu'ils n'en ont pas envie. Pourquoi
cela les intéresserait-il ? Quand on travaille pour un
maître, le seul but que l'on ait est de saboter le travail.
Inutile d'affûter le soc des charrues, ils auront tôt
fait de l'ébrécher. Ils brisent les faux, rompent
les fléaux et avec eux le gaspillage devient un principe.
Voilà le monstre que nous avons créé à
notre usage. Sur ces dix mille arpents vivaient jadis quinze mille
personnes; il y a maintenant ici un millier d'esclaves et la famille
d'Antonius Caius, tandis que les paysans croupissent dans les
faubourgs et les ruelles de Rome. Il faut bien comprendre cela.
C'était facile, bien sûr, quand le paysan en rentrant
de la guerre trouvait sa terre envahie par les mauvaises herbes,
sa femme dans le lit d'un autre et des enfants qui ne le reconnaissaient
même pas, c'était facile de lui donner en échange
de sa terre une poignée d'argent et de le laisser venir
à Rome pour y vivre dans les rues»(20).
L'impérialisme romain est une hydre qui a commencé
par dévorer ses propres défenseurs, les soldats-citoyens.
Aucune des deux versions (1960 et 2003) n'a jugé bon de
reproduire ce discours qui, en vérité ne figurera
que dans la bouche de James Mason, plaidant au Sénat pour
l'intégration des Barbares dans l'Empire, paysans libres
plutôt qu'esclaves. Et c'était dans une production
de Samuel Bronston, La chute de l'Empire romain (1964),
réalisée - ironie - par Anthony Mann. Cet Anthony
Mann qui, imposé par Universal à Kirk Douglas, travailla
une semaine sur le film (la scène dans les mines de Lybie,
filmée en Californie dans la Vallée de la Mort,
en janvier 1959, c'est lui), avant que l'acteur-producteur ne
le vire au profit de Kubrick (21)
! Trois cents pages plus loin, Gracchus rétorquera à
Cicéron :
«Songe un peu, mon cher Cicero, à ce que le soldat
romain a à perdre si les esclaves triomphent. Les vainqueurs
auraient terriblement besoin de lui, car il n'y a pas assez d'esclaves
pour cultiver comme il faut la terre. Il y aurait assez de terres
pour tout le monde, et notre légionnaire verrait alors
se réaliser son rêve le plus cher : avoir son petit
coin de champ et sa maison. Et pourtant il marche pour détruire
ses propres rêves, afin que seize esclaves puissent continuer
à trimbaler un gros porc comme moi dans une litière
capitonnée. Nies-tu la vérité de mes propos
?» (22).
Le travailleur libre est donc de meilleure rentabilité
que l'esclave. Mais est-ce pour autant la solution au problème
de l'exploitation de l'homme par ses semblables ? Non sans inquiétude,
le marxiste Fast laisse entrevoir à Caius la seconde étape
de la révolte de l'homme asservi : la révolte prolétarienne.
Le capitaliste Crassus convie ses amis à visiter ses fonderies
où travaillent des hommes libres, «Un esclave
mange votre nourriture et meurt. Mais ces ouvriers se transforment
en or. Et je n'ai pas à m'occuper de les nourrir et de
les loger non plus. (...) Les ouvriers se révolter
?» Crassus sourit et secoua la tête. «Non,
cela n'arrivera jamais. Ce ne sont pas des esclaves, tu comprends.
Ce sont des hommes libres. Ils peuvent aller et venir comme il
leur plaît. Pourquoi se révolteraient-ils jamais
? (...) Non. En fait, durant toute la Guerre Servile nous
n'avons jamais éteints nos fours. Il n'y a aucun lien entre
ces hommes et des esclaves.»
Pourtant, alors qu'il quittait la fabrique, «Caius se
sentait envahi par une impression de malaise. Ces hommes étranges,
silencieux, barbus qui travaillaient si vite et avec une telle
dextérité, lui inspiraient une sourde crainte. Et
il ne s'expliquait pas pourquoi» (23).
|
|
|
2. Le roman d'Howard Fast
Achevé d'écrire à New York en juin 1951,
le roman d'Howard Fast (CLICK,
CLICK
et CLICK)
(24)
fut d'abord vendu sous le manteau. Il importe de rappeler que
ce communiste américain plus tard repenti (cf. «The
Naked God : The Writer and the Communist Party», 1957) avait
été inscrit sur la liste noire du sénateur
Maccarthy en raison de son soutien aux républicains espagnols,
comme il le contera dans son livre Le Serment (25),
et même emprisonné (26).
Spécialiste des récits historiques, il a traité
de la guerre de l'indépendance américaine (Two
Valleys, 1933 et The Unvanquished, 1942), composé
la chronique de cinq générations de fermiers américains
(Strange Yesterday, 1934), raconté l'armée
révolutionnaire de Valley Forge (Les Héros désespérés/Conceived
in Liberty, 1939), la déportation des Peaux-rouges
(Le Dernier espoir : le roman des Peaux-rouges/The Last Frontier,
1944), la guerre de Sécession (La Route de la Liberté/Freedom
Road, 1944), les frères Macchabées (My
Glorious Brothers [27],
1950) et Moïse (Moses, Princes of Egypt, 1959). Egalement
auteur de nombreux polars, il est - paradoxalement - surtout connu
du public français pour son recueil de nouvelles de science-fiction
publié chez Marabout, Au seuil du Futur (1961).
2.1. L'outil doué de parole
Pourtant Howard Fast, de son propre aveu, n'a pas cherché
à écrire un «roman historique». N'espérons
donc pas trouver dans Spartacus la relation «archéologique»
d'un événement du passé : l'auteur a seulement
voulu composer un apologue, se livrer à une réflexion
sur l'esclavage. D'où l'insertion d'un M. Tullius Cicero
- notre Cicéron - porte-parole de l'idéologie romaine-esclavagiste,
pour laquelle l'esclave qu'est qu'un «outil doué
de parole» (instrumentum vocale, l'expression est,
en réalité, de Varron). Les esclaves ne respectent
rien de ce qui est à leur maître. «On obtient
de meilleurs résultats en attelant des esclaves à
la charrue, observa Cicero (...). La bête qui pense
est toujours préférable à celle qui est incapable
de pensée. Cela va de soi. Et puis un cheval vaut cher.
Il n'y a pas de tribus de chevaux contre lesquelles nous puissions
partir en guerre pour ramener cent cinquante mille prisonniers
qu'on vendra aux enchères. Du reste, si on utilise des
chevaux, les esclaves les abîmeront. (...) - C'est
exact, acquiesça Antonius. Les esclaves tueront un cheval.
Ils n'ont aucun respect pour rien de ce qui appartient à
leur maître... sinon leur propre personne» (28).
Le mépris ou l'ignorance des Romains est également
signifié d'une manière plus insidieuse par des phrases
comme : Helena «méprisait toute cruauté
inutile envers les animaux, qu'il s'agît d'esclaves ou de
bêtes de somme» (29).
Ou nos patriciens de s'étonner de ce que la vue des 6.412
crucifiés de la voie Appienne terrorise leurs porteurs
de litières, ces objets fonctionnels en principe dénués
de sentiments, de psychologie :
- Sans doute s'imaginaient-ils à la place des suppliciés,
dit le général [Crassus] en souriant.
- Peut-être. Crois-tu qu'on puisse trouver chez des esclaves
de pareils sentiments ? Nos porteurs de litière sont pour
la plupart nés en servage, presque tous ont été
rompus au fouet à l'école d'Appius Mundellius et,
tout en étant robustes, ils ne valent guère mieux
que des animaux. Seraient-ils capables de s'identifier ainsi à
autrui ? J'ai du mal à croire à l'existence de telles
qualités chez des esclaves. Mais tu dois le savoir mieux
que moi. Penses-tu que tous les esclaves aient compati aux malheurs
de Spartacus ?
- Je crois que oui, pour la plupart (30).
Fast mêle la dialectique marxiste à des emprunts
à Caton l'Ancien, homme rude et avare, mais qui s'y connaissait
en matière d'esclaves car il peinait aux champs avec les
siens et partageait leur ordinaire. Caton l'Ancien ou Caton le
Censeur (234-149), M. Porcius Cato pour l'état civil, appartenait
à ces «vieux romains» de la République,
austères et vertueux. Moins d'un siècle après
lui, les patriciens de Fast sont - bien évidemment - d'une
toute autre trempe, fats et délicats.
Ainsi, pour pouvoir manger «convenablement» une personne
de qualité doit avoir au moins quatre esclaves spécialisés
: un libarius (pâtissier), mais encore «le
cocus, les pistores et obligatoirement un dulciarus,
sinon il faut envoyer acheter les sucreries cuites au marché,
et l'on peut tout aussi bien s'en passer». Et un privata
qui ne s'occupe que de ranger les vêtements, pas même
de les laver, et cependant tout est en dessous de tout ! Quel
service, mes amis ! Et l'épouse de reprocher à son
mari qu'il lui faut «tous les mois un nouveau tonsores
(sic); il n'y a qu'un dieu qui puisse te raser comme il faut,
mais moi si je te demande un autre coiffeur ou un masseur...»
Et le mari de répondre, du tac au tac : «Ce n'est
pas tout d'avoir besoin de cent esclaves (...), mais il
faut les former... et même quand on les a formés,
je me demande parfois si cela en vaut la peine.» |
|
|
2.2.
«Christ marxiste»
La version 1960 nous montre un Spartacus ignorant (il est né
esclave, et n'a reçu aucune éducation) mais avide
de savoir, qui demeure toutefois muet quant à d'éventuels
états d'âmes mystiques. Bien évidemment à
l'époque, un film américain ne pouvait trop ériger
en héros un adepte du matérialisme historique pur
et dur. Le téléfilm 2003, par contre, nous fait
découvrir un Spartacus athée, qui ne croit en rien,
en aucun dieu. C'est Varinia la Celte qui tentera de lui inculquer
quelque spiritualité (31)
- mais dans le roman d'H. Fast, Varinia ne semble pas spécialement
concernée par les questions d'ordre spirituel. C'est une
liberté qu'a pris le romancier américain d'avec
ses sources : Plutarque (Crassus, VIII, 4) nous apprend,
en effet, que la compagne anonyme de Spartacus - Thrace comme
lui - est une prêtresse de Dionysos, sujette à des
transes mystiques. Joël Schmidt (Spartacus, 1998),
qui la nomme Thracica, en fera ses choux gras, et plus récemment
G. Pacaud (Spartacus, 2004) verra Arcanoë - ainsi
l'a-t-il baptisée - régulièrement organiser
des bacchanales pour le plus grand bien des damnés de la
terre : la horde des esclaves rebelles est devenue un «club
échangiste» ! Voilà le paganisme remontant
aux sources du «communisme primitif»...
Il est à noter - et le détail n'est certes pas
innocent - que le dernier gladiateur crucifié, devant les
portes de Capoue, sera le Juif David, de la sorte implicitement
promu «Christ marxiste». Dans le film 1960, David
n'est plus qu'un nom plaqué sur un personnage de gladiateur
interprété par Harold J. Stone, relégué
à l'arrière-plan. Le juif David, avait un rôle
autrement plus intéressant dans le roman : c'est lui qui
voulait transformer les prisonniers romains en gladiateurs, lui
aussi qui était crucifié le dernier, aux portes
de Capoue. Mais Kirk Douglas (à la ville Yssur Danielovitch
Demsky, fils d'immigrés juifs russes), qui voyait en Spartacus
un second Moïse sortant d'Egypte son peuple d'esclaves, avait
une vision «sioniste» de son film (32).
Spartacus/Moïse aurait tenté de conduire les opprimés/les
élus vers la Terre promise... (!). C'est pourquoi Douglas
transféra sur Spartacus, c'est-à-dire sur lui-même,
certains traits qui initialement appartenaient à David.
Et c'est ainsi que, dans le film, c'est Spartacus qui sera - anonymement
- crucifié, en dernier, alors que chez les historiens romains
le Thrace était tué dans la bataille, mais son corps
n'était pas identifié - ce qui laissait le champ
libre à toutes les hypothèses romanesques possibles
(33).
2.3. Plan du roman
Le roman d'H. Fast ne se présente point comme un récit
linéaire, mais comme une série de dialogues où
l'on voit se rencontrer des gens qui ont connu Spartacus à
l'un ou l'autre moment de sa vie, ou, tout simplement, ont entendu
parler de lui.
1ère partie : Comment Caius Crassus voyageait sur
la grand-route de Rome à Capoue, en ce mois de mai -71.
- La «guerre des gladiateurs» qui vient de s'achever,
vue par des patriciens réunis par hasard dans la Villa
Salaria (13 chapitres).
2e partie : Ce que Crassus, le grand général,
raconta à Caius Crassus à propos d'une visite
que lui fit à son camp, Lentulus Batiatus, qui dirigeait
une école de gladiateurs à Capoue. - Le témoignage
de Batiatus nous apprend les origines de Spartacus, arraché
aux mines de Nubie (5 chapitres).
3e partie : Récit du premier voyage à Capoue
que firent Marius Bracus et Caius quelque quatre années
avant la soirée à la Villa Salaria. Combat
entre deux paires de gladiateurs. - Le jeune Caius se souvient
de sa visite à Capoue (10 chapitres).
4e partie : Où il est question de Marcus Tullius Cicero
et de l'intérêt qu'il portait aux origines de la
grande Guerre Servile. - Analyse de la «guerre servile»
par un jeune politicien ambitieux, Cicéron, ses causes
et son développement (11 chapitres).
5e partie : Dans laquelle on trouvera évoqués
certains souvenirs de Lentulus Gracchus, concernant notamment
son séjour à la Villa Salaria. - Le sénateur
Gracchus se souvient de la stupéfaction du Sénat
à l'annonce de la révolte des esclaves et de la
première défaite d'une légion (7 chapitres).
6e partie : Où il est question du voyage à
Capoue de quelques-uns des invités de la Villa Salaria,
de quelques aspects de cette belle cité, et de la crucifixion
des derniers gladiateurs dont furent témoins les voyageurs.
- Spartacus revit dans la mémoire de David agonisant,
le dernier de ses compagnons, crucifié aux portes de
Capoue (10 chapitres).
7e partie : Où il est question du retour à
Rome de Cicero et de Gracchus. Des propos qu'ils tinrent durant
le voyage, du rêve que fit Spartacus et de la façon
dont Gracchus en eut connaissance. - Crassus et Gracchus
s'opposent dans leur quête de l'amour de Varinia, veuve
de Spartacus. Par elle, nous découvrons le monde de justice
et d'égalité dont avait rêvé Spartacus
(8 chapitres).
8e partie : Dans laquelle Varinia trouve la liberté.
- Varinia transmet à son fils, le fils de Spartacus,
son idéal de résistance à Rome et aux valeurs
qu'elle incarne (2 chapitres).
2.4. Les protagonistes fastiens
Certains personnages du roman seront télescopés
pour n'en faire qu'un dans le film 1960 (clivages conservés
dans la version 2003), ainsi le riche et homosexuel Marcus Bracus,
commanditaire du combat privé à Capoue. Dans le
roman, Marcus Bracus - qui se fond dans le «Marcus
Licinius Crassus» du film - demande un combat à mort
pour divertir son jeune amant Caius Crassus (34
(«Clodius Glaber», dans le film). Le couple est accompagné
de Lucius et de son épouse, non nommée.
«Quatre ans plus tard», un autre groupe d'amis entourant
le même jeune Caius Crassus (35),
soit sa sœur Helena et l'amie de celle-ci, Claudia,
vont retrouver à la Villa Salaria appartenant à
un certain Antonius Caius (36),
où sont déjà arrivés le général
vainqueur Licinius Crassus, le sénateur démocrate
Lentulus Gracchus interprété par Charles
Laughton dans le film, et Marcus Tullius Cicero, autre
personnage non retenu dans les deux versions filmiques. C'est
pour le romancier l'occasion de confronter dans un débat,
à table, les thèses pro-esclavagistes de Cicéron
et anti-esclavagistes de Gracchus.
Dalton Trumbo (37)
va bâtir son casting «romain» à
partir de là. Soit d'une part le quatuor formé par
Marcus Crassus (Laurence Olivier), sa maîtresse Helena Glabrus
(Nina Foch), le frère de celle-ci Clodius Glaber (John
Dall) et Claudia Marius (Joanna Barnes) sa jeune épouse
ou fiancée et, d'autre part, les personnages de Batiatus
(Peter Ustinov) et son «patron» Gracchus (Charles
Laughton) - auxquels il n'aura plus que Jules César (John
Gavin) à rajouter. César n'apparaît nulle
part dans le roman.
Notons que l'alliance politique de Gracchus et César
contre Crassus se trouve être, par ailleurs, une hérésie
historique - César ayant toujours été un
allié de Crassus. En ce qui concerne Caius Crassus (nom
qui malheureusement prête à confusion avec celui
du général [où donc Fast avait-il la tête
?]), Dalton Trumbo estima plus intéressant de directement
confronter, au pied du Vésuve, le général
vaincu avec un vainqueur qui n'était autre que ce gladiateur
dont il s'était diverti à Capoue.
En lisant Fast, on a un peu l'impression qu'il n'y a pas de
consul à Rome en -73. Le romancier laisse son personnage,
Gracchus, mener les débats au Sénat comme senator
inquæsitor, ou jouter à loisir contre Crassus.
Un coup d'œil dans les Fastes consulaires nous apprend toutefois
que les consuls de 73 étaient C. Cassius Varus et M. Terentius
Varro. Cette absence de souci historique (38)
prive Fast d'un personnage intéressant (39),
car Terentius Varro - plus connu comme Varron - peut-être
considéré comme le théoricien de l'esclavagisme.
Originaire de Reate en Sabine, Varron (116-28 av. n.E.) était
un Romain foncièrement honnête et droit, nostalgique
des antiques vertus romaines et pénétré d'hellénisme
tout en même temps. Admirateur de Caton le Censeur, il prônait
dans le traité qu'il consacra à l'exploitation d'un
domaine rural, le De re rustica (40),
le retour des Romains à la terre. Mais il y exposait également
comment rationaliser le travail des esclaves tout en évitant
le gaspillage.
On conçoit qu'un tel personnage si différent du
«capitaliste» corrompu Crassus ait été
boudé des romanciers qui - G. Pacaud excepté (41)
- semblent ignorer son existence. Ultérieurement, Varron
sera légat de Pompée dans sa campagne contre les
pirates (67-66). Au début de la guerre civile, il devint
gouverneur pompéien de l'Espagne ultérieure. Une
de ses deux légions ayant déserté pour passer
à Jules César, il se rendit avec l'autre et devint
son ami. Varron devait déjà avoir, à ce moment,
une solide réputation d'érudit, car en -47 César
lui confia la direction des bibliothèques publiques qu'il
venait de créer à Rome. Il fut plus tard proscrit
par Marc Antoine et passa à Octave, qui lui restituera
ses biens. Polygraphe, Varron composa soixante-quatorze ouvrages,
soit 620 livres, traitant des sujets les plus divers, dont bien
peu nous sont parvenus : trois livres de son De re rustica,
cinq de sa De lingua latina et quelques fragments de ses
Antiquités romaines. Un grammairien du IVe s., Flavius
Sosipator Charisius nous a laissé une étonnante
citation de Varron, qui laisse pensif : (...) Spartaco innocente
coniecto ad gl[adiatori]um..., «Spartacus jeté
sans avoir commis de faute dans la gladiature».
Succincts, les récits qui relatent la guerre de Spartacus
(42)
n'attribuent à Varron aucun rôle particulier, ni
décision. De fait, ils ne le mentionnent pas. C'est pourtant
lui et son collègue C. Cassius Varus qui, de facto,
sanctionnèrent l'envoi de Glaber contre les gladiateurs
rebelles. Mais Fast préfère ignorer ce romain vertueux
et austère, pour imaginer le Sénat romain mené
par un personnage à sa meilleure convenance, le démocrate
Gracchus - prolongation des célèbres tribuns de
la réforme agraire (43).
2.5. Lourdeur et licence d'un romancier marxiste
Dalton Trumbo avait beau être homme de gauche et l'un des
Unfriendly Ten, les «Dix d'Hollywood», il détestait
Howard Fast et son marxisme étriqué, le jugeant
«aussi étroit d'esprit que les gens qui combattaient
le communisme» (44).
Dès lors, on ne s'étonnera pas de telle anecdote,
digne d'un roman de science-fiction - Soylent Green n'est
pas loin, quoique... Pline ne rapporte-t-il pas que le sang encore
chaud d'un gladiateur, ou un morceau de son foie pouvait guérir
de l'épilepsie ? - que Fast a placé dans son roman.
C'est l'ultime exploitation de l'homme par l'homme que l'idée
d'un chevalier Caius Marcus Senvius, qui a fait fortune en fabricant
des saucisses... Lorsqu'on lui demande s'il ne regrette pas le
gâchis que représentent les corps de 6.000 esclaves
en train de pourrir sur leurs croix, il répond avec aplomb
que : 6.000 x 150 livres de chair humaine font 900.000 livres.
«J'en ai acheté 250.000 livres» de ces...
«outils» cassés, comme aurait dit Cicéron.
«Je les ai fumés, passés au hachoir, et
mélangés à de la viande de porc assaisonnée
de sel et d'épices. La moitié est destinée
à la Gaule, la moitié à l'Egypte. Et à
un prix très raisonnable» (45).
Le romancier ne se prononce pas sur la question de savoir s'il
s'agit d'une boutade de Marcus Senvius, ou s'il l'a réellement
fait dans la «réalité». Bien ancré
dans le mythe (le festin de Tantale, ceux de Lycaon, d'Atreus
ou du shakespearien Titus Andronicus, saint Nicolas ressuscitant
les écoliers que l'aubergiste a découpés
et mis au saloir), on retrouve ici le vieux fantasme de l'«Auberge
rouge» où l'on assassine les clients pour en servir
la chair aux autres, mais revisité par les méthodes
industrielles du nazisme qui de ses victimes massacrées
ne craignit pas de récupérer cheveux, dents et même
la graisse pour en faire des savons. Fortement épicés
les pâtés et les saucisses sont, par nature, des
aliments de provenance incertaine dont on peut redouter que le
pâtissier - au sens premier du terme, «qui fait des
pâtés» - ne se soit débarrassé
de ses déchets de cuisine, mélangés avec
des chairs illicites (chats, chiens, rats...) ou interdites (chair
humaine). La vieille chanson du Père Lustucru et du chat
de la Mère Michel !
Suite…
|
NOTES :
(1)
... tout comme ceux du Vercingétorix
de Jacques Dorfmann et de l'Astérix de Zidi.
L'ouverture des Pays de l'Est a permis à nombre
de films épiques récents de bénéficier
d'extérieurs d'une grande beauté, ainsi
la Lituanie pour Attila et la Slovaquie pour
Cœur de Dragon.
Dans les années 1980, la République
socialiste de Bulgarie commémora le 1300e anniversaire
de la fondation de l'entité nationale et mit
en chantier plusieurs grands films historiques «officiels»
commémorant les principaux jalons de son histoire
comme la fondation de l'Etat bulgare en 681 (Khan
Asparuch, Ludmil STAÏKOV, 1983 - en VHS VF
: La Gloire de Khan); Cyrille et Méthode
alphabétisant les Slaves (Constantin le
philosophe, de Georgi STOYANOV, 1983); les premiers
monastères (Boris Ier, le dit des lettres,
Borislav SHARALIEV, 1984); la christianisation, en
864 (Boris Ier - Le baptême, Borislav
SHARALIEV, 1984); la lutte contre Byzance, en 811
(Le Jour des souverains, Vladislav IKONOMOV,
1986), etc. Toutefois, bien qu'il naquît dans
leurs montagnes longtemps avant que les Bulgares ne
s'y établissent, ou peut-être bien à
cause de cela, aucun ne fut consacré à
Spartacus. Pour autant, cela ne signifie pas que les
Bulgares aient oublié ce héros de la
Liberté, si hardiment revendiqué par
les communistes, dont nombre de romanciers se sont
attachés à reconstituer les exploits
: St. STOÏLOV (Spartak, 1969), Stoiân
STAÏNOV (Legenda za mladdciâ Spartak
[La légende du jeune Spartak], 1972), M.
Daskalova (Spartak, 1979) et Plamen
TZONEV (Spartak - Le Thrace, 1981). Une mention
spéciale pour Le Thrace de la tribu des
Maides - La jeunesse de Spartak de Todor HARMANDJIEV,
davantage axé sur la description des premiers
habitants de la Bulgarie, ce qui laisse peu de place
à la relation de la révolte des esclaves.
En 1970, le roman fut adapté en BD dans le
magazine bulgare Daga [Arc-en-Ciel]. - Retour
texte |
|
| 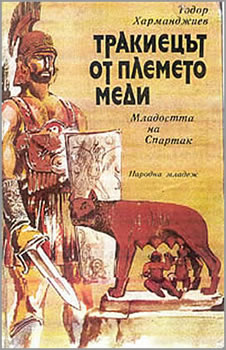
Todor HARMANDJIEV, Le Thrace
de la tribu des Maides - La jeunesse de Spartak,
Edition du Comité central de la Jeunesse
communiste, 1980 (extrait de Yanita KOSTOVA, Images
de Spartacus). |
|
|
(2) Ils sont néanmoins censés
représenter des paysages de l'Italie. - Retour
texte
(3) Pour les Costumes, la Direction
artistique, la Photographie (pour Russell Metty, mais en réalité
ce fut surtout Kubrick qui officia derrière la caméra,
ne laissant guère d'initiative à son directeur
de la photographie) et, pour Peter Ustinov, le Meilleur rôle
secondaire. - Retour texte
(4) Disponible en DVD Universal VO
et VF. - Retour texte
(5) Dans cette nouvelle version 2003,
Crixos se vante d'avoir participé aux deux premières
révoltes ! - Retour texte
(6) Cet épisode figure dans
les versions 1960 et 2003, qui les traitent très différemment
: en 1960, le Vésuve est un volcan pelé; en 2004,
c'est une montagne boisée, avec une falaise à
pic et des sarrements de vignes plus conformes sans doute à
ce qu'était alors le Vésuve 150 ans avant le fameux
cataclysme. - Retour texte
(7) ... à l'instigation du
populiste Lentulus Agrippa qui, dans le téléfilm,
remplace le Gracchus du roman et de la version de Kubrick, tous
deux inventés pour les besoins de la cause.
En réalité, Pompée et Crassus ne se sont
pas «bouffés le nez» comme le laisse entendre
le téléfilm 2003, mais au contraire se sont entendus
pour obtenir l'un le Triomphe sur Sertorius, l'autre l'Ovation
pour sa victoire sur de vils esclaves (mais avec une couronne
de lauriers, au lieu de celle de myrte !), et se faire tous
deux élire au consulat en dépit du fait qu'ils
n'en réunissaient pas les conditions légales.
- Retour texte
(8) Au sujet de Mummius, qui semble
être un descendant du béotien de consul qui en
146 rasa Corinthe, rappelons que Steven Saylor en a fait un
protagoniste de son très bon roman L'étreinte
de Némésis, traçant de lui un portrait
intéressant.- Retour texte
(9) C'est une des incohérence
du scénario, mais au cinéma tout doit s'enchaîner
très vite : Spartacus est venu négocier avec Crassus
l'évacuation de son armée loin de Rome et son
empire, alors que tapis dans les fourrés ses hommes s'apprêtent
déjà à exhiber le général
romain supplicié ! En temps réel, c'est insoutenable,
invraisemblable.
Par contre il est tout à fait exact - selon les textes
- qu'un soldat romain dont le grade ne nous est pas connu fut,
par défi, crucifié sur l'ordre de Spartacus face
aux fortifications de Crassus.- Retour texte
(10) De fait, les auteurs les plus
conséquents, Plutarque, Appien et Florus, ont rendu compte
du bellum Spartacium près de deux siècles
après les faits. Contemporain des événements,
Salluste et Varron - dont on ne possède que de minces
fragments -, semblent eux avoir eu une vision du personnage
plus nuancée, même si pour Cicéron, contemporain
lui aussi, le nom de Spartacus reste synonyme de «brigand
de la pire espèce» (N.d.M.E.). - Retour
texte
(11) Ces deux patriciens romains
ont été clairement désignés, deux
pages avant, comme étant les généraux Servius
et Mummius, dont le gladiateur juif David a exigé qu'ils
combattent comme gladiateurs (FAST, Spartacus, p. 296
- toutes les références au roman d'H. Fast renvoient
à l'édition J'Ai Lu, nĘs 101-102). - Retour
texte
(12) FAST, Spartacus, J'Ai
Lu, p. 298. - Retour texte
(13) Cf. Joël SCHMIDT,
Vie et mort des esclaves dans la Rome antique, Albin
Michel, 1973. - Retour texte
(14) G. PACAUD, Spartacus. Le
gladiateur et la liberté, Paris, Ed. du Félin,
coll. «Kiron», 2004, p. 45. - Retour
texte
(15)... que Cardiff filmait avec
beaucoup de retenue malgré tout, la suggestion étant,
comme souvent, plus insupportable encore que la complaisance.
- Retour texte
(16) Colonel Jean SCHRAMME, Le
bataillon léopard. Souvenirs d'un Africain blanc,
Robert Laffont, 1969. - Retour texte
(17) Cette «Cité Idéale»
est une utopie communiste du dominicain espagnol Tomaso Campanella
(La Cité du Soleil, 1623) intégrée
par Arthur Koestler dans son Spartacus (1939 [trad. fr.
chez Aimery Somogy, 1945]). Le fait que la BD de J. Martin y
réfère, et aussi utilise l'expression christique
«le fils de l'Homme» pour désigner tantôt
le chef des rebelles (Le fils de Spartacus, p. 39, 7e
v. et note), tantôt son fils Spartaculus (op. cit.,
pp. 11, 9e v. et 47, 3e v.), démontre que J. Martin s'est
davantage inspiré de Koestler que de Fast. - Retour
texte
(18) ... ce qui resterait à
démontrer ! - Retour texte
(19) Les légionnaires romains
se nourrissaient de blé. On ne leur distribuait de l'orge
qu'en cas de disette, ou pour les punir (cf. Y. LE BOHEC,
L'armée romaine sous le Haut Empire).
C'est ainsi qu'Auguste «fit décimer et nourrir
avec de l'orge» les survivants de cohortes qui avaient
lâché pied (SUÉT., Aug., 24) (N.d.M.E.).
- Retour texte
(20) FAST, Spartacus, pp.
59-60. - Retour texte
(21) En fait, «Abby»
Mann se laissait un peu trop influencer par Peter Ustinov, cabotin,
qui tirait la couverture à lui. Son éviction fut
semble-t-il assez amicale; en tout cas, quatre ans plus tard,
Mann dirigerait encore Douglas dans Les héros de Telemark
.- Retour texte
(22) FAST, Spartacus, p. 367.
- Retour texte
(23) FAST, Spartacus, p. 357.
- Retour texte
(24) Howard Melvin Fast (11 novembre
1914-12 mars 2003) est issu d'une pauvre famille juive newyorkaise.
Ouvrier métallurgiste originaire de la ville de Fastov,
en Ukraine, son père s'était établi aux
Etats-Unis en 1878, où les services d'immigration l'avaient
rebaptisé «Fast» d'après sa ville
natale. - Retour texte
(25) The Pledge (1988). Le
Serment (trad. Françoise Ravaux), Paris, Messidor
«Roman», 1990. - Retour texte
(26) Il fut incarcéré
le 7 juin 1950, pendant trois mois. C'est au sortir de prison
qu'il entreprit la rédaction de Spartacus. - Retour
texte
(27) A été réédité
par Claude Aziza sous le titre «La Gloire des Macchabées»
in «Omnibus» Jérusalem, le Rêve
à l'ombre du Temple, Paris, Presses de la Cité,
1994. - Retour texte
(28) FAST, Spartacus, pp.
55-56. - Retour texte
(29) FAST, Spartacus, p. 13.
- Retour texte
(30) FAST, Spartacus, p. 42.
- Retour texte
(31) Au sens littéral de spiritus
(«souffle») : Varinia, posant sa bouche sur celle
de Spartacus, y insuffle son âme divine... et sa croyance
religieuse. Cette scène du téléfilm 2003
s'inspire d'un passage du roman de Fast où, dans les
mines, Spartacus aspire par un baiser l'âme d'un jeune
compatriote thrace agonisant (FAST, Spartacus, p. 103).
Le «baiser à la russe» des camarades ? -
Retour texte
(32) Frédéric MARTIN,
L'Antiquité du cinéma, Dreamland, coll.
«CinéLégendes», 2002. - Retour
texte
(33) Dans le roman de Joël Schmidt
(Spartacus, Mercure de France, 1988), Spartacus est laissé
pour mort sur le champ de bataille du Silarus. Son amante Thracica
l'aidera à se crucifier lui-même sur la dernière
croix de la voie Appienne, face aux portes de Capoue : le parricide
et demi-incestueux Spartacus tient, en effet, à expier
la malédiction œdipienne qui le poursuit depuis
qu'il est descendu de sa montagne de Thrace. Curieux roman.
- Retour texte
(34) Quatre ans plus tard, Caius
Crassus se retrouvera dans le lit de Marcus Licinius Crassus,
le grand général de Rome (FAST, Spartacus,
pp. 111-112). Ah ! On savait s'amuser, en ces temps là.
Et Trumbo a bien eu raison de télescoper Marcus Bracus
avec Marcus Licinius Crassus. - Retour
texte
(35) Personnage de fiction. - Retour
texte
(36) Personnage non retenu dans les
versions 1960 et 2003. - Retour texte
(37) Interdit d'écriture par
la persécution maccarthyste, le scénariste Dalton
Trumbo (1905-1976) écrivit entre 1947 et 1959 une trentaine
de scénarios sous pseudonymes. Il revient à Kirk
Douglas (conspué par l'American Legion, la puissante
association d'anciens combattants, mais aussi la féroce
critique Hedda Hopper, qui qualifia Spartacus de «film
coco») d'avoir fait apparaître au générique
de son film les noms de Dalton Trumbo et Saul Bass (autre nom
de la Liste Noire). En fait Stanley Kubrick, toujours «serviable»,
avait proposé de signer de son nom à lui le scénario
: ce fut un point de friction entre l'acteur-producteur et son
réalisateur, et Douglas mit fin à la discussion
en se décidant à sortir des limbes le nom du scénariste
réprouvé (K. DOUGLAS, Fils du chiffonnier,
pp. 321-322). - Retour texte
(38) A notre connaissance,
seul Gérard Pacaud a fait intervenir Varron dans son
roman. - Retour texte
(39) En fait, le discours
qui eut normalement être celui de Varron, Fast l'a attribué
à Cicéron. - Retour texte
(40) Caton également
composa un De agri cultura, le plus ancien ouvrage en
prose latine qui nous soit parvenu complet. - Retour
texte
(41) Joël Schmidt,
pour sa part, focalise sur le collègue de Varron, le
consul Caius Cassius Longinus [ou C. Cassius Varus, variante]
qui envoie Glaber contre Spartacus en -73; l'année suivante,
comme proconsul de la Gaule cisalpine, il affrontera Spartacus
devant Modène et périra dans la bataille. - Retour
texte
(42) Velleius Paterculus,
Florus, Appien et Plutarque. - Retour texte
(43) Tiberius Sempronius
Gracchus, tribun de la plèbe en -133, assassiné,
et son frère Caius, tribun de la plèbe en -123,
contraint au suicide. Rappelons tout de même que loin
d'être des «révolutionnaires», les
Gracques ne réclamèrent rien de plus que la stricte
application de lois plus anciennes, favorables aux prolétaires.
Plus tard on fera d'eux - mais à tort - des prototypes
des socialistes. - Retour texte
(44) Kirk DOUGLAS, Le
fils du chiffonnier, Presses de la Renaissance, 1989, p.
305. - Retour texte
(45) FAST, Spartacus,
pp. 25-27. - Retour texte
|
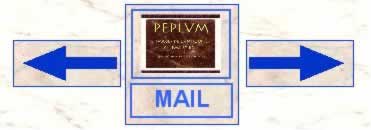
|