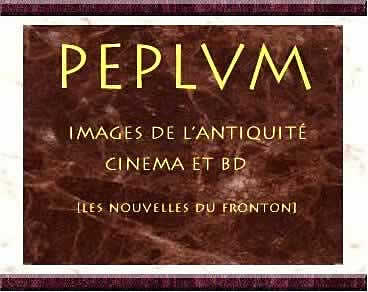 |
| |
| |
Le Dernier des Romains
[Pour la conquête de Rome]
(Robert Siodmak, 1967)
|
|
|
|
Mein Kampf...
um Rom !
Tourné dans les studios Buftea à Bucarest alors
que la mode des péplums était - provisoirement -
passée, Kampf um Rom fit une carrière des
plus discrètes de ce côté-ci du Rhin. En Belgique,
cette superproduction allemande d'Arthur Brauner sortit avec plus
de cinq ans de retard, en 1974, dans une version d'exportation
raccourcie intitulée Pour la conquête de Rome
et qui, à Bruxelles, tint l'affiche... quinze jours (!).
Il ne semble pas que cette version courte ait été
distribuée en salle en France, si ce n'est en vidéo
à l'orée des années '80 et sous le titre
Le dernier des Romains. Mais les péplomanes inconditionnels
qui reçoivent la deuxième chaîne allemande
(ZDF) auront eu l'occasion de voir le film dans sa version intégrale,
en deux parties.
Soixante ans après la chute «officielle»
de l'Empire romain d'Occident, il n'en restait plus qu'un seul,
le dernier des Romains, et c'est R. Siodmak qui en eut la peau
comme l'année précédente il avait eu celle
du colonel Custer (1),
cette «ganache militariste» (Hervé Dumont).
Le «Dernier des Romains» c'est Laurence Harvey, inoubliable
dans le rôle du colonel William Barret Travis, l'avocat
aventurier un peu coincé qui commande le fort de l'Alamo,
face à ce truculent baroudeur de colonel Bowie - l'inventeur
du fameux «Bowie Knife» (2)
- incarné par Richard Widmark dans The Alamo, western
épique produit, réalisé et interprété
par John «Davy Crockett» Wayne en 1960 (3).
Laurence Harvey donc, incarne le préfet de Rome Cornelius
Cethegus Cäsarius, intrigant et ambitieux, mais surtout qui
rêve de restaurer la grandeur de la Ville Eternelle... Pour
y arriver, cet aïeul de Machiavel pousse à s'entre-détruire
le royaume des Ostrogoths - l'occupant étranger de la péninsule
- et son voisin exécré Byzance, c'est-à-dire
l'Empire romain d'Orient du grand Justinien. Lequel Justinien,
justement, après avoir reconquis l'Afrique du Nord sur
les Vandales et l'Andalousie sur les Wisigoths, ne songe qu'à
parachever son œuvre de restauration impériale en
annexant l'Italie. Dans ces conditions, que voulez-vous que fît
Bélisaire, sinon mourir avant son heure devant les portes
de Rome ? |
|

Cethegus, le préfet de Rome, à
la tête de ses légions.
La vérité historique nous oblige à
signaler qu'au VIe s. de n.E. les «légionnaires»
romains ne portaient plus ce genre de costumes, du reste
plus théâtraux qu'archéologiques, ni
ce type d'emblèmes sur leurs boucliers... |
|
Ce Cethegus - protagoniste de premier
plan -, Gibbon ne le mentionne pas dans sa relation des événements
dont question. C'est que le personnage a été inventé
de toutes pièces par le romancier allemand Felix Ludwig
Sophus Dahn (1834-1912), qui en 1876 publia Ein Kampf um Rom,
quelques années après la fin de la guerre franco-prussienne.
F. Dahn y célébrait les grands ancêtres germaniques
dont les vertus éclatantes contrastaient avec «la
malice des Welsches» («der Tücke der Welschen»)
- les Romains, décadents et vaincus, c'est-à-dire
en filigrane les Français (4).
Mais si Bélisaire eut quelque démêlé
avec l'autorité romaine ce fut plutôt avec le pape
Sylvère, que d'ailleurs il finit par exiler (17 novembre
537), pour mettre sur le trône de Saint Pierre le diacre
Vigile. Lequel rétribua Byzance de deux cents livres d'or...
pour son obligeance.
Pour autant, Bélisaire ne se laissa point exterminer devant
les portes de Rome lors de la bataille de mars 537, au contraire
de ce que l'on voit dans le film. Avec ses troupes, il occupait
la Ville depuis plusieurs mois déjà, y étant
entré le 10 décembre 536. Quoique disgracié,
le brillant général que Justinien jalousait secrètement,
expira paisiblement dans son lit en 565 - et non aveugle, mendiant
son pain, comme le prétend la légende («Date
obolum Belisario !»).
Felix Dahn
C'est à Munich, en 1859, qu'inspiré à la
fois par Schopenhauer et Darwin, Felix Dahn commença la
rédaction de son roman héroïco-pessimiste sur
le crépuscule des Goths Ein Kampf um Rom. Il le
continuera à Ravenne (Italie) pour l'achever à Königsberg.
Les sept livres de la saga portent les noms de sept rois goths
: Theoderich, Athalarich, Amalaswintha, Theodahad, Witichis,
Totila et Teja. Il s'agit d'une variante nationale
(mais étonnement peu chauvine) du roman historique à
la Walter Scott, avec idéalisation romantique des Germains.
«... Type parfait de l'érudit germanique,
Felix Dahn, écrira Gilles Nélod (5),
a laissé de puissants ouvrages scientifiques (...).
Chez lui, la rigueur de l'histoire s'allie à l'imagination;
ces caractéristiques marquent particulièrement ses
romans Les croisés (1884), Frédégonde
(1886), Attila (1888) et Une lutte pour Rome (1876)
qui, décrivant l'effondrement des Goths en Italie, est
illustré de cartes et mêle les héros imaginaires
aux personnages réels, dont la vie est toutefois romancée.
Typiquement réactionnaire, apologiste du régime
prussien, érudit pesant, Felix Dahn s'illustre dans un
genre qu'on a appelé non sans quelque ironie le «roman
de professeur». Signalons encore ses deux récits
mythologiques : Y a-t-il des dieux ? (1874) et La consolation
d'Odin (1880).»
Ein Kampf um Rom allait devenir pour des décennies
une référence incontournable de la littérature
de jeunesse allemande, l'égal de Karl «Winnetou»
May ! Bien sûr, il ne trouva pas grâce aux yeux d'un
marxiste tel que le hongrois Georges Lukacs - le grand théoricien
du roman historique - qui vers la fin des années trente
(6),
bousculant la critique littéraire bourgeoise traditionnelle,
s'affligeait de l'inanité des efforts des littérateurs
à brasser de ces thèmes exotiques empruntés
à un passé révolu, de leur énergie
gaspillée à dépeindre «la beauté
innocente et à jamais perdue de l'enfance (... telle)
l'Egypte d'Ebers, les Grandes Invasions de Dahn» (7),
«menu fretin» d'écrivaillons. Leurs descriptions
de la vie antique «tout à fait vulgaires comme
dans les romans autrefois si populaires de Dahn ou Ebers»
qui, en fait, parlent surtout de leurs problèmes contemporains
sous de fallacieux alibi historique. Pour conclure, plein de commisération,
qu'«au bout de dix ans, seuls quelques érudits
appliqués se souvien[dront] qu'il y eut à
un moment donné un romancier historique très célèbre
tel que Felix Dahn».
L'édition originale en quatre volumes du roman de F. Dahn
date, nous l'avons dit, de 1876. Sa principale source était
La guerre des Goths de Procope de Césarée,
qui avait été le secrétaire particulier de
Bélisaire, le favori de l'impératrice Théodora
(avant de régler ses comptes avec l'un et l'autre de ses
protecteurs dans ses Anecdotes). Professeur d'histoire
à Hambourg, F. Dahn est également auteur des «Rois
des Germains» (Die Könige der Germanen,
1861-1909), ouvrage monumental dont le tome VIII ne comporte pas
moins de six volumes, d'une «Histoire des peuples germaniques»
(Urgeschichte der germanischen Völker, 1882-1900)
en trois volumes et d'un Prokopius von Cäesarea. Ein Beitrag
zur Historiographie der Völkerwanderung (1865).
Byzance romanesque
Hors quelques productions «officielles» de Pays
de l'Est concernés, la période byzantine n'a
guère été abordée sur nos écrans
occidentaux qu'à travers le règne de Justinien
dans diverses versions de Théodora (Henry Pouctal,
FR - 1912; Ambrosio-Film (Turin), IT - 1913; Leopoldo Carlucci,
IT - 1922 Riccardo Freda, FR-IT - 1953; O. Assonitis, IT -
TV 1983 (?) [8])
tandis que, paradoxalement, un seul film fut consacré
à la chute de Constantinople en 1453 (L. Feuillade,
1913). Cependant, l'ingérence byzantine en Italie est
en filigrane du Glaive du conquérant (Rosmunda
et Alboino, C. Campogalliani, 1961) quoique complètement
occultée, et de La Terreur des Barbares du même
réalisateur, touchant à la même période
(C. Campogalliani, 1959). |
| Pourtant, s'il peut regretter
l'absence d'une traduction française du roman
de F. Dahn, le lecteur francophone ne devrait pas trop
se sentir étranger à cette passionnante
tranche d'Histoire. Outre la traduction de L'Histoire
du Déclin et de la Chute de l'Empire romain
de Gibbon (9),
dont on peut compléter la lecture par l'Histoire
des Goths d'Herwig Wolfram (10)
plus à jour, nous devons à Robert Graves
un Comte Bélisaire (1938 [11])
d'excellente facture qui met en évidence le rôle
décisif, lors de la reconquête de l'Italie
par Byzance, de la merveilleuse cavalerie gothe mercenaire,
les cataphractaires archers-lanciers (à ce sujet
on déplorera un peu la prédominance de
l'infanterie orientale [12]
mise en évidence dans le film de Siodmak, dont
la figuration est étique malgré la collaboration
de l'armée roumaine). N'omettons pas la feuilletonnesque
saga en trois volumes de Jean-Luc Dejean (Les Dames
de Byzance et L'impératrice de Byzance,
Jean-Claude Lattès, 1983, et Les légions
de Byzance, Trévise, 1984). Nous accorderons
toutefois une mention spéciale à la très
belle uchronie de l'américain Lyon
Sprague de Camp, De peur que les ténèbres
(13)...
Ce dernier roman raconte l'histoire de Martin Padway,
un professeur d'histoire visitant Rome au temps de Mussolini.
Tombé dans une faille temporelle, le voici atterrissant
dans l'Italie de Théodoric et employant toutes
ses ressources d'homme du vingtième siècle
pour éviter une guerre entre les gentils barbares
et les méchants byzantins. Le règne de
Théodoric (roi 493-526) avait, en effet, apporté
trente-deux ans de paix à l'Italie, jusqu'alors
déchirée par les conflits entre barbares
- même si Gibbon se garde bien d'avoir de son
règne une vision angélique. L'affabilité
du roi ostrogoth avait séduit les Romains, et
quoique arien il avait laissé leur liberté
de culte aux catholiques. Théodoric avait établi
sa capitale à Vérone, aussi l'épopée
des Niebelungen parle de lui comme de «Dietrich
de Berne». Padway, donc, va tant bien que mal
réinventer la distillation, l'imprimerie, les
télécommunications etc. Bien sûr,
sa connaissance du passé historique fera de lui
une sorte de prophète éclairé,
respecté des Ostrogoths ! |
|
|
|
|
|
Le tournage du film
Hervé Dumont a raconté le tournage de Pour la conquête
de Rome dans la biographie qu'il consacra à Robert Siodmak.
«Entre-temps, en Allemagne, Artur Brauner, de plus en plus
épris de gigantisme, s'est aussi lancé dans la superproduction
à grand renfort de vedettes américaines; il vient
de sortir un Genghis Khan (1965) de Henry Levin, avec Omar
Sharif et James Mason, et l'année suivante les deux parties
des Nibelungen, filmées à Spandau et à
Belgrade par Harald Reinl, pour la jolie somme de 8 millions de
DM. Le producteur a des idées fixes : le projet d'un
remake des Nibelungen date déjà de 1959
(quand Fritz Lang travaillait pour la CCC-Filmkunst). Mais le nouveau
projet que Brauner caresse depuis plusieurs années également
dépasse en démesure tout ce que le cinéma européen
a échafaudé de spectaculaire à ce jour. Ayant
décidé de se mesurer à Cinecittà et
même à Hollywood, il sort Siodmak de sa demi-retraite
tessinoise et le convoque en Roumanie pour y diriger Kampf um
Rom (Le dernier des Romains) - une fresque historique en Ultrascope
et Eastmancolor, avec des acteurs de dix nations différentes
et un budget «kolossal» de 15 millions de DM. |
|

Le général byzantin Narsès (Michael
Dunn), eunuque dans l'histoire,
nain dans le film, et Cethegus (Laurence Harvey) |
|
Depuis 1960, le marché mondial
a été inondé de «péplums»
italiens, bandes ressuscitant sans trop de scrupules tantôt
l'Ancien Testament, tantôt la mythologie grecque ou l'histoire
romaine, confectionnées à peu de frais à Cinecittà,
en Espagne ou en Yougoslavie. En huit ans, l'Italie a produit quelque
140 films «de romains» - signés parfois par des
vétérans américains (Huston, Aldrich, Walsh,
Tourneur, Fleischer, Ulmer, de Toth, Fregonese, Maté, Rapper,
Bernhardt, etc.). Alors que le genre est sur son déclin -
dès 1965, Cinecittà vit à l'heure de l'espionnite
007 avant de se recycler dans le spaghetti-western - Brauner tente
sa chance en Roumanie, pays encore relativement épargné
par la coproduction capitaliste. Son choix géographique est
fondé : les studios roumains viennent en effet de sortir
deux «péplums» héroïco-patriotiques
relatant la lutte des Daces contre les légions romaines de
Trajan, dont un a été financé en partie par
Brauner (14).
Grâce au soutien du gouvernement de Bucarest, les deux
bandes, de qualité médiocre, ont bénéficié
d'une figuration (armée roumaine) et de reconstitutions fabuleuses,
à peine imaginables en Italie. Avec Kampf um Rom, Brauner
voit donc la possibilité de réutiliser partiellement
armures et décors, et de mobiliser des foules à bon
marché.
Le sujet que Brauner se propose de porter à l'écran
avec tant de faste est tiré d'un best-seller toutes catégories
du professeur d'histoire hambourgeois Felix Dahn (1834-1912),
Ein Kampf um Rom (Un combat pour Rome); la vente en librairie
se chiffre à deux millions - quelle meilleure garantie pour
les banques ? Roman-fleuve publié en quatre volumes,
Ein Kampf um Rom (1876) se veut en toute modestie la «chronique
illustrée» du VIe s. Dahn a potassé La guerre
des Goths de l'historien grec Procope de Césarée;
il retrace donc la lutte des Ostrogoths contre une Rome moribonde
et une Byzance à l'apogée de sa gloire, de la mort
de Théodoric le Grand en 526 à l'expulsion des Germains
de la péninsule italienne par Justinien en 553. Trop passionné
par son sujet, Dahn ne parvient pas à capter la réalité
historique de l'époque, mais il sait captiver son lecteur
par une action dramatique très dense. Une bonne partie du
roman comme du film se déroule à la cour de Ravenne,
capitale de l'éphémère empire ostrogoth, où
le perfide Cethegus (Laurence Harvey), «le dernier des Romains»,
s'occupe à diviser les deux filles de Théodoric (la
«James Bond-girl» Honor Blackman et la Suédoise
Harriet Anderson) - encouragé en cela par l'empereur de Byzance
Justinien Ier (Orson Welles) et son épouse Théodora
(Sylva Koscina), qui espèrent ainsi débarrasser l'Italie
des Barbares. Une fois la cour de Ravenne divisée et affaiblie
par les intrigues, la ville de Rome est occupée de force
par l'armée byzantine, puis assiégée sans succès
par les Ostrogoths; l'histoire s'achève en hécatombe
wagnérienne, les protagonistes étant assassinés,
empoisonnés ou taillés en pièces dans une des
quatre grandes batailles - quand ils ne se suicident pas simplement
(comme Cethegus). Les Ostrogoths survivants emmènent les
corps de leurs chefs et s'établissent avec l'aide de la flotte
viking sur l'île de Gotland, dans la mer Baltique. |
|
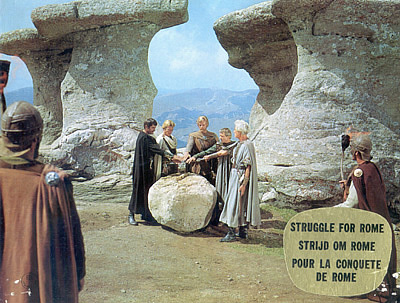
Le serment des chefs ostrogoths |
|
Variante nationale du roman historique
à la Walter Scott, Ein Kampf um Rom recrée
un univers germanique idéalisé et romantisé
à outrance, teinté d'esprit chevaleresque, de pessimisme
nietzschéen et de fatalisme : Dahn met son texte au service
des plans de Bismarck et de la réunification de l'Allemagne.
Dès sa parution, le roman devient, avec les aventures exotiques
de Karl May, la lecture quasi obligatoire de tout adolescent allemand
(et ceci jusqu'à la fin des années cinquante); sa
popularité auprès du public allemand est alors comparable
à celle des œuvres d'Alexandre Dumas et de Jules Verne
en pays francophone. Il va de soi que l'exhortation naïve
et chauvine de «l'esprit germanique» chère
à la bourgeoisie wilhelmienne n'est plus pensable, vingt-cinq
ans après l'écrasement du Troisième Reich,
mais l'accueil public réservé aux épouvantables
Nibelungen de 1966 (trois millions de spectateurs en douze
mois) persuade Brauner de persévérer et de réaliser
avec Siodmak «le plus grand film allemand depuis que les
Allemands font du cinéma» [Brauner]... (15).
|
|

Roi ostrogoth.
Notez l'oiseau de métal, sur son casque, qui appartient
à la Tène (2e ou 3e s. av. n.E.) et la Croix
chrétienne portée par son accompagnateur,
qui doit nous rappeler que les Goths, bien que barbares,
sont de confession arienne |
|
Le producteur charge une douzaine
de scénaristes - Ladislaus Fodor en tête - de concentrer
le récit et surtout d'en éliminer soigneusement toute
coloration nationaliste. «Nous avons extirpé tout le
contenu idéologiquement gênant», témoigne
Siodmak. «Reste une histoire passionnante. Car ce qui m'intéresse
en premier lieu, ce sont les caractères, les actes et les
comportements des protagonistes. J'essaie de leur infuser un peu
de vie, de leur conférer une dimension shakespearienne»
(16).
Ambition louable, mais contrecarrée par l'éléphantiasis
braunerienne et une apathie cinématographique généralisée
de tous les participants. Le tournage de cinq mois (mai-sept. 1968)
a lieu sur les terrains des «Studios Bukaresti» à
Buftea, sous une chaleur torride atteignant parfois 60 degrés
- ce qui explique peut-être bien des choses ! Siodmak est
logé dans une villa à 40 km de la capitale; peu impressionné
par les énormes responsabilités qui lui incombent,
il profite de son séjour roumain pour revoir fréquemment
des membres disséminés de sa famille. Brauner réserve
à son produit une campagne publicitaire bourrée de
superlatifs et une première berlinoise aux flambeaux (décembre
1968) ! A l'image des Nibelungen, sa nouvelle superproduction
est projetée en deux parties de 103 et 84 minutes respectivement
(à l'étranger, elles seront réunies en un film
d'une heure et demie, au risque de rendre l'histoire incompréhensible).
La presse allemande se confond en sarcasmes. Friedrich Luft «secoue
la tête et se tait» (17),
tandis que Herbert Linder proclame : «Robert Siodmak
n'est qu'un fonctionnaire et la juste punition pour une industrie
cinématographique qui aspire au fonctionnariat»
(18).
Cela ne serait pas si grave - rappelons les âneries proférées
au sujet du Cléopâtre de Mankiewicz - si le
public, lui aussi, ne réagissait mollement. Tout comme
La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann qui entraîna,
cinq ans auparavant, la chute du producteur Samuel Bronston,
Kampf um Rom entre dans les chiffres rouges avec quatre millions
de DM de déficit et met l'empire Brauner en péril.
Le premier handicap de ce film-mammouth est qu'il vient à
la traîne d'une longue série de «péplums»
italiens : la vogue est passée, le public momentanément
las du gigantisme. Le métrage hypertrophié n'arrange
rien. Ceci dit, dans son ensemble, le film manque gravement de relief;
la version intégrale de Kampf um Rom n'est qu'une
interminable bande dessinée sans entrain ni conviction, où
des milliers de braves Roumains paradent dans des costumes trop
propres et des armures trop brillantes. La surabondance des personnages
secondaires, des cabales, trahisons et contre-trahisons de toutes
sortes finissent par ennuyer et ajoutent à la confusion :
nous sommes loin d'un Criss Cross à la sauce antique.
Toutefois, les moments spectaculaires - réalisés par
Sergiu Nicolaescu et le spécialiste hollywoodien Andrew Marton
(la course de chars de Ben Hur) - ne manquent pas d'allure;
l'assaut en masse des créneaux de Rome par les Goths, avec
de gigantesques tours tirées par des bœufs, a nécessité
1.400 figurants à pied et 300 cavaliers. (Les murs de la
cité sont ceux, à peine modifiés mais considérablement
rallongés, de l'impressionnante forteresse des Fêtes
galantes de René Clair, 1966). L'ultime combat, une bataille
rangée sur les flancs du Vésuve, où les armées
s'affrontent en formations géométriques rigides sur
un fond chromatique gris, vert et brun, s'inspire du Spartacus
de Kubrick. Admettons que la conception de ces «clous»
soit de Siodmak, comme il le prétend. Mais par ailleurs,
sa mise en scène est singulièrement peu imaginative;
l'amourette entre le beau Goth et l'ingénue Romaine est pénible,
et les crises de jalousie entre les sœurs royales sombrent
dans le théâtral. |
|
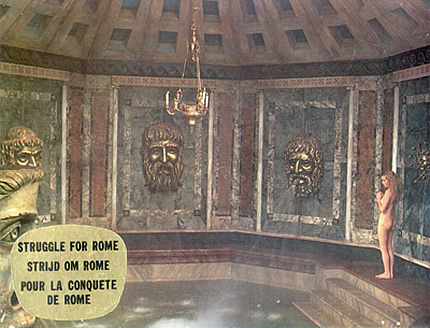
Exilée dans une petite île du lac Bolsena,
Amalasonte (Amalaswinta) mourut étouffée dans
son bain, le 30 avril 535, sur l'ordre de son cousin et
époux Théodat, que par son mariage elle avait
fait monter sur le trône d'Italie |
|
| Siodmak ne retrouve que très
épisodiquement sa verve et ses particularismes d'antan. Trahison
et fatalité sont des constantes connues de son univers, mais
noyées ici dans un canevas décousu; le thème
des sœurs rivales (dont l'une périt ébouillantée
dans un bain de soufre et l'autre égorgée) est à
classer parmi ses bizarreries favorites. Il y a quelques trouvailles
dans sa description venimeuse de la cour de Byzance, hantée
d'espions et d'intrigants ambitieux, et où Siodmak joue avec
tentures et mosaïques (couleurs dominantes : turquoise, noir
et or). La description est sans finesse, mais non dépourvue
de baroquisme : le brillant stratège Narsès, un eunuque
arménien, devient chez Siodmak un nabot machiavélique
et sournois (le nain Michael Dunn), flanqué d'un lion («votre
fauve sent mauvais») et de troublants éphèbes
nubiens; le film en fait un maître-chanteur qui accule l'impératrice
au suicide. Sylva Koscina a rarement été présentée
sous un jour aussi érotique; l'intelligente Théodora
- glorifiée très sagement en 1953 par Riccardo Freda
sous les traits de son épouse Gianna Maria Canale (Teodora,
Imperatrice di Bisanzio) - se transforme ici en nymphomane bisexuelle,
autocrate mais esclave des caprices de ses amant(e)s. Derrière
son apparence d'épais et léthargique satrape oriental,
le Justinien si hésitant d'Orson Welles dissimule un tempérament
rusé. Il est aussi typique de voir qu'en passant du roman
à l'écran, Siodmak a déplacé le poids
de l'incolore chef barbare Totila (Robert Hoffman) au patricien
Cethegus, le seul personnage qui présente une ambiguïté
plus marquée; ce préfet de Rome, un nostalgique de
la grandeur impériale, trompe son entourage à tour
de rôle dans l'unique but de rétablir des valeurs révolues
comme la «noblesse d'âme»; enferré dans
son attitude paradoxale, il deviendra la victime de ses propres
machinations (amis et ennemis s'allient contre lui), trompé
à son tour jusque dans sa chair (croyant qu'il s'agit d'un
adversaire, il tuera sa fille déguisée en Goth). Laurence
Harvey donne à cet antihéros acharné une certaine
crédibilité, mais le contexte superficiel et boursouflé
du film l'empêche de hausser le ton au niveau de la tragédie.
Totalement étouffée par le spectacle au premier degré,
la mise en scène de Siodmak ne parvient pas à creuser
ces situations, à mieux les intégrer dans le drame
général. L'impression de disparité et de désordre
qui traverse son film provient du fait que, dépassé
par l'ampleur tentaculaire de l'entreprise et trop soucieux de mettre
en valeur son décor, de soigner l'image, il en vient à
se désintéresser du récit à proprement
parler (auquel il ne croit pas). Dès lors, le rythme languit
et la timide volupté de certaines scènes ne saurait
sauver le film. Résultat : une suite de jolis chromos.
|
|
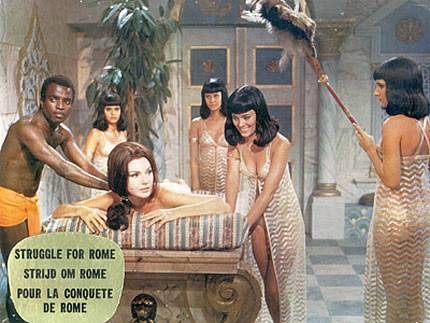
«Sylva Koscina a rarement été présentée
sous un jour aussi érotique, écrit Hervé
Dumont. L'intelligente Théodora - glorifiée
très sagement en 1953 par Riccardo Freda sous les
traits de son épouse Gianna Maria Canale - se transforme
ici en nymphomane bisexuelle, autocrate mais esclave des
caprices de ses amant(e)s.» |
|
L'opérateur Richard Angst
affirme du reste que Siodmak, souffrant de crises aiguës
de diabète, fut souvent absent - physiquement ou mentalement
- pendant le tournage (19).
En fait, la machinerie de la CCC-Film-kunst n'était
pas à la hauteur des ambitions de Brauner; il lui manquait
l'infrastructure efficace des studios américains, qui eût
pu décharger quelque peu le réalisateur et lui permettre
de se concentrer plus sur la mise en scène. En dépit
de ses soixante-huit ans, Siodmak devait contrôler personnellement
les moindres accessoires, surveiller la fabrication hésitante
de centaines de costumes et travailler jusqu'à 14 heures
par jour, secondé par quelques assistants roumains dont
l'expérience dans le genre était toute relative;
la nuit, harassé, il devait souvent réécrire
des scènes pour le lendemain. Récupérant
d'un léger accident, il jura de ne plus jamais s'embarquer
dans pareille aventure : «C'est ma toute dernière
combine à grand spectacle» («Mein letzter Schinken»)
! Il ne se doutait pas que c'était son dernier film tout
court. Et à un journaliste qui lui demandait pourquoi il
avait accepté ce travail, il répondit exacerbé
: «Voilà la question que je me pose tous les matins
!» (20).
Kampf um Rom est le 56e film de Siodmak. Un labeur qui, couronnant
quatre ans de responsabilités écrasantes, l'a proprement
exténué. Le bilan de cette ultime tranche de sa
carrière est négatif, si l'on excepte la réussite
très partielle qu'est Custer of the West, et l'on
peut se demander comment ce cinéaste intimiste a pu pareillement
s'égarer dans des machineries à grande figuration
qui ne lui offraient guère de liberté et dont il
n'avait pas le contrôle. Sans doute la tendance de l'époque
ne lui laissait-elle pas le choix - même les plus grands
noms du 7e Art n'ont pu se soustraire au gigantisme à la
mode (Nicholas Ray et Les 55 jours de Pékin, par
exemple). Siodmak proclamait à qui voulait l'entendre son
amour du changement, son besoin de diversité. Peut-être
cherchait-il à excuser par là un éclectisme
dénué d'ambition et de discernement ? Voulant donner
une coloration romantique à sa passion, il répétait
souvent qu'il souhaitait tourner jusqu'à sa mort. En réalité,
il est notoire que le réalisateur se morfondait à
Ascona («l'endroit est plein d'horlogers en vacances...»),
tiraillé par l'angoisse d'être un jour écarté
des studios - et livré à lui-même. L'inactivité
le plongeait dans un état dépressif prononcé
d'où seule la fébrilité du tournage pouvait
le sortir : arrivé à ce stade, toute proposition
- fut-elle absurde - était la bienvenue, tant qu'il pouvait
prononcer le fatidique «Silence, on tourne !» Ses
incartades dans Karl May ou le péplum ne traduisent qu'une
fuite en avant, qu'une tentative désespérée
de «rester dans la course». Par malchance, la superproduction
avec ses interminables extérieurs et ses impondérables
était le dernier genre auquel cet homme de presque soixante-dix
ans aurait dû sacrifier.
Siodmak avait besoin du contact étroit avec les acteurs;
il développait sa mise en scène en fonction des
rôles qu'il avait auparavant creusés, si possible
approfondis durant de longues séances avec les comédiens.
Une fois la trame psychologique tissée, les rapports de
force bien définis et les points de tension élaborés,
Siodmak se souvenait qu'il était aussi un technicien averti;
son talent s'épanouissait alors sous les sunlights du studio,
à l'intérieur d'un espace limité où
l'illusion de la réalité était recréée
par les artifices de l'éclairage et les filtres de la caméra.
Lui qui fut trente ans durant un maître de l'image amoureusement
ciselée et des demi-teintes psychologiques dut se sentir
dépaysé, catapulté comme général
en chef d'une armée de figurants et de techniciens pour
s'adonner à l'imagerie de prestige où, de surcroît,
il perdait une bonne partie de son énergie en problèmes
d'intendance. Rappelons aussi que pour Siodmak, le canevas n'était
pas l'essentiel : il n'a souvent été que prétexte
à dépeindre des caractères et un milieu.
La geste héroïque lui était contraire, s'il
ne pouvait la parodier. Le grand air, les forces naturelles et
les panoramas exaltants l'indifféraient - il leur préférait
les tourments sournois de l'âme. Bref, l'épopée
était foncièrement étrangère à
son tempérament. Etre condamné à diriger
des foules sous les cieux yougoslaves, roumains ou andalous ne
pouvait qu'étouffer ce qui lui restait d'inspiration, paralyser
définitivement son intuition créative et le réduire
à un consciencieux exécutant sous la férule
d'un commanditaire mégalomane» (21). |
|

Le faste voluptueux de la cour de Byzance |
|
Fiche technique
|
Dernier des Romains
(Le)
Dernier des Romains (Le) [FR] [CH]
Pour la conquête de Rome [BE] / Struggle for Rome / Strijd
om Rome [VL]
Allemagne (RFA) - Italie - Roumanie, 1967
t.o. : Kampf um Rom / Guerra per Roma (La) / Calata dei Barbari
(La) / Lupta pentru Roma / Batalia pentru Roma
Guerra per Roma (La) (22)
[IT] / Calata dei Barbari (La) [IT]
Last Roman (The) (23)
/ Fight for Rome (24)
Kampf um Rom [AL]
Invasion de los Barbaros (La) [SP]
Batalia pentru Roma [ROUMANIE] / Lupta pentru Roma [ROUMANIE]
Prod. : CCC Filmkunst (Berlin) et Pegaso (Rome) (en coprod. avec
Studioul Cinematografic [Bucarest]) / Technicolor / Techniscope
/ V.All. : 1ère Part. 2.816 m (103') - 2e Part. 2.285 m
(84') / V. Angl. 1ère Part. 99' (...)
Fiche technique
Réal. : Robert SIODMAK; Réal. 2e éq. : Serge
NICOLAESCU & Andrew MARTON; Scén. : Ladislas FODOR
(d'après le roman de Felix DAHN, Ein Kampf um Rom,
1876); Images : Richard ANGST, Vasile OGLINDA (Assist. op. cam.
: Lothar HOHLFELD); Prod. : Artur BRAUNER; Dir. prod. : Ion CHILOM
& Peter HAHNE; Régie gén. : Wolfram KOHTZ; Assist.
réal. : Theo PARTISCH, Don NARTASE, J. POLLINI; Décors
: Ernst SCHOMER, Sander KULI, Costel [Constantin] SIMIONESCU (Studios
: Berlin-Spandau); Cost. : Irms PAULI, Horia POPESCU; Mont. :
Alfred SRP; Maq. : Freddy ARNOLD, Cilly DIDZONEIT; Son : Max GALINSKY;
Musique : Riz ORTOLANI.
Fiche artistique
Laurence HARVEY (Cethegus) - Harriet ANDERSSON (Mathaswintha,
fille de Théodoric le Grand) - Orson WELLES (Justinien)
- Sylva KOSCINA (Théodora) - Honor BLACKMAN (Amalaswintha
[Amalasonte], fille de Théodoric le Grand) - Robert HOFFMANN
(Totila) - Michael DUNN (Narsès) - Ingrid BRETT (Julia)
- Lang JEFFRIES (Bélisaire) - Florian PIERSIC (Vitigès
[Witichis]) - Emanoil PETRUT (Téja) - Friedrich VON LEDEBUR
(Hildebrand) - Dieter EPPLER (Thorismund) - Ewa STRÖMBERG
(Rauthgundis) - Adela MARCULESCU (Aspa) - Ion DICHISEANU (Furius)
- Mircea ANGELESCU (Aligern) - Fory ETTERLE.
DISTRIBUTION
AL/ Constantin-Film (sortie à Berlin-Ouest, 15 janvier
1969 au Zoo-Palast).
CH/ Victor Film (Bâle)
BE/ Excelsior (sortie à Bruxelles, 19 juillet 1974)
NOTES
Dans sa version originale, le film est constitué de deux
époques distinctes : Kampf um Rom (1. Teil) et Kampf
um Rom (2. Teil - Der Verrat).
Les versions exportations anglaise et française sont des
versions condensées, ramenées à environ 1
h 30'.
VIDÉOGRAPHIE
Le dernier des Romains, couleur, VHS, version française
(version condensée d'1 h 30', chez VIP. Bonne duplication.
BIBLIOGRAPHIE
Felix DAHN, Ein Kampf um Rom, éd. Werner Dausien
(Hanau/M), 1964.
Article : Laura COSTIN, «Koscina-Welles : împeratii
Bizantului», in Cinema, n° 9 (Bucarest), septembre
1968, pp. 28-29.
|
|

Narsès (Michael Dunn), l'empereur Justinien (Orson
Welles) et l'intrigante Théodora (Sylva Koscina) |
|
SCÉNARIO
1ère partie. (526 de n.E.)
Le puissant Empire romain s'est scindé en deux blocs (395
de n.E.). A Byzance, Justinien et Théodora règnent
sur l'Empire d'Orient et rêvent de récupérer
les bribes disloquées de l'Empire d'Occident. Cet Empire
d'Occident n'existe plus depuis 476. Et Rome elle-même,
depuis 404, a cessé d'être d'être la résidence
des Empereurs, qui lui préférèrent Ravenne...
... Ravenne, dont Théodoric, roi des Ostrogoths (Goths)
a fait sa capitale. Mais cet état de chose ne satisfait
ni les Byzantins, ni Cethegus, le préfet (gouverneur) de
Rome, qui rêve de restaurer la grandeur passée de
l'Urbs. Néanmoins, grâce à l'énergie
du chef barbare, la paix existe dans le région, depuis
32 ans...
Quand Théodoric vient à mourir (526), il exige dans
son testament que son royaume reste intact, mais la volonté
de ses héritiers est autre. Ses deux filles, Amalaswintha
(25)
et Mathaswintha, se battent pour l'héritage. Le conseil
de la Couronne se trompe dans le choix à faire; et Cethegus,
le préfet romain, y voit sa chance. Rusé et perfide,
il intrigue auprès de l'impératrice Théodora,
qu'il gagne à sa cause - et avec elle, les Byzantins. Il
conclut avec eux une alliance contre les Ostrogoths. Sur ces entrefaites,
il complote avec succès à Ravenne, abusant les fidèles
du défunt Théodoric envoyés comme délégués
royaux à Rome, et finit par amener les armées byzantine
et ostrogothe à s'entre-tuer devant les portes - fermées
- de Rome, au cours d'une grande bataille qui s'achève
par la défaite complète de Byzance, dont le généralissime,
Bélisaire, est tué.
|
|
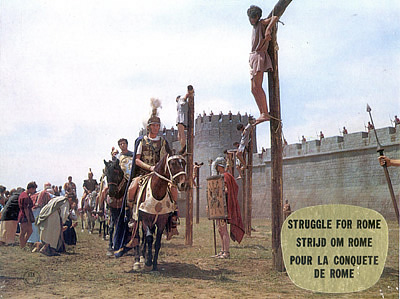
Cethegus a la main lourde pour qui lui résiste |
|
2e partie. Mathaswintha ayant
révélé à Cethegus le plan d'attaque
des Goths, qui ont mis le siège devant Rome, ceux-ci sont
vaincus. Vitigès [Witiches] trouve la mort sur le champ
de bataille. Alors que Mathaswintha veut tuer la femme de Vitigès,
elle est transpercée par le glaive de Téja. Mais
Rauthgundis survit à son mari Vitigès quelques heures
seulement ! Une fois de plus, selon toute apparence, les Goths
ont de la chance. Totila est élu nouveau roi les Goths
et les Romains l'applaudissent. Il fait élire sa Julia
en qualité de «reine des Goths et des Romains».
Entre-temps, le père de Julia, Cethegus, a obtenu de Byzance
que le nain Narsès lève une nouvelle armée
de soixante mille hommes; déjà, elle marche contre
les Goths.
Stratège extraordinaire, Totila réussit à
battre les Romains, plus forts. Toutefois, quand Furius le trahit,
la fortune l'abandonne. Totila est tué, quoique Julia,
qui a revêtu un manteau blanc semblable au sien, ait tenté
de tromper l'ennemi en l'attirant à sa suite. Poursuivie
par son propre père, elle meurt de sa main. Ayant découvert
l'identité de sa victime, Cethegus Cæsarius, «le
Dernier des Romains», se suicidera avec l'aide d'un esclave.
Les débris des Goths se rassemblent sous le commandement
de Téja, leur nouveau roi. Mais Téja, à son
tour, est tué. Narsès laissera partir librement
les Goths qui ont survécu au massacre. L'Italie passe sous
la domination de Byzance. |
| |
|
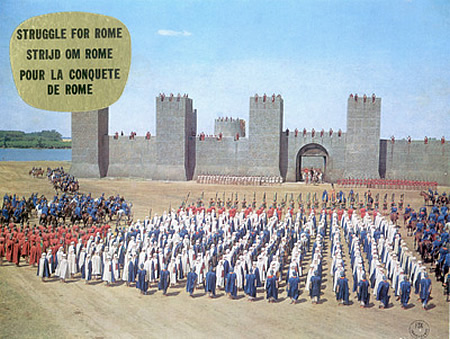
Paru quelques années après la
guerre franco-prussienne, le roman de Felix Dahn célébrait
les grands ancêtres germaniques dont les vertus éclatantes
contrastaient avec la noirceur d'âme des Romains, c'est-à-dire
les Français. L'armée impériale byzantine
de Bélisaire débarquée pour reconquérir
l'Italie ne comptait-elle pas, à côté de
ses fantassins isauriens, une cavalerie constituée de
Huns, Maures et confédérés goths ? Une
composition qui, de Sedan à Diên Biên Phû,
n'était pas sans rappeler celle des armées impériales
françaises.
Ajoutons à propos de ces «portes
de Rome», à proximité du Tibre, que la section
des tours jumelées aurait dû être hémicylindrique
(26)
au lieu de carrée. D'après la configuration du
fleuve et de la porte, il doit s'agir ici de la porta Ostiensis
(ou San Paolo), laquelle aurait dû être entourée
d'édifices caractéristiques, notamment la «pyramide
de Caius Cestius» incluse dans le mur d'Aurélien
|
NOTES :
(1) Custer, l'Homme de l'Ouest
(Custer of the West, R. Siodmak, 1966), tourné
en Espagne avec Robert Shaw dans le rôle du «boy-general»,
le glorieux vaincu de Little Big Horn (25 juin 1876). Malgré
quelques erreurs de scénario dues, sans doute, aux conditions
de tournage, ce fut un belle illustration des fameuses toiles
d'Edgar Paxton et autres J. Leonard Jennewein. - Retour
texte
(2) La vie et les aventures de Jim
Bowie et son fameux couteau avant le fatal siège de mars
1836, ont été évoqués dans La
maîtresse de fer (The Iron Mistress, Gordon
Douglas, 1952), avec Alan Ladd et Virginia Mayo. - Retour
texte
(3) The Alamo vient de faire
l'objet d'un remake par John Lee Hancock (2004), avec
Dennis Quaid, Billy Bob Thornton, Jason Patric et Patrick Wilson.
- Retour texte
(4) Welsche, du francisque
*Walla, désigne - au départ - les Celtes
romanisés, les Gallo-Romains chez qui s'établirent
les conquérants germaniques. Par extension, les cultures
latines. Le mot a survécu dans les ethnonymes Valaques
(Roumanie), Wallon (Belgique) et Walsh [Gallois] (Grande-Bretagne).
Dans Le Mythe aryen, Léon Poliakov rappelle que
le concept impur de «Welschland» s'oppose à
celui - noble, bien entendu - de «Deutschland» !
Le Welschland est l'étranger. En Suisse alémanique,
«Welsches» désigne encore aujourd'hui les
concitoyens francophones. - Retour texte
(5) Gilles NÉLOD, Panorama
du roman historique, Sodi, p. 285. - Retour
texte
(6) Lukacs écrivit son essai
pendant l'hiver 1936-1937 : G. LUKACS, Le roman historique,
Payot, coll. «Petite Bibliothèque», n° 311,
1977 (première trad. fr. : Payot 1965). - Retour
texte
(7) Georg Ebers (1837-1898) et Felix
Dahn (1834-1912) sont les deux cibles préférées
des sarcasmes de Lukacs. - Retour texte
(8) Théodora et Justinien luttant
contre les envahisseurs slaves apparaissent également
dans L'Ancienne Russie (Rus iznachalnaya, U.R.S.S.
- 1985), production Gorki réalisée par Gennady
Vasilyev. - Retour texte
(9) R. Laffont, coll. «Bouquins»,
t. 2, chap. XLI. - Retour texte
(10) Albin Michel, coll. «L'évolution
de l'Humanité - Bibliothèque de synthèse
historique», 1990. - Retour texte
(11) R. GRAVES, Le comte Bélisaire,
1ère éd. française 1966; rééd.
Flammarion, 1987. - Retour texte
(12) Les 300 mercenaires maures de
Bélisaire étaient en fait des cavaliers. - Retour
texte
(13) Marabout, SF, 1972; NéO, n° 70, 1983. - Retour texte
(14) Les Guerriers/Dacii de
Serge Nicolaescu, avec Marie-José Nat, Georges Marchal
et Pierre Brice (1967) et Le Tyran/Columno lui Trajan
de Mircea Dragan, avec Richard Johnson et Antonella Lualdi (1967/68).
- Retour texte
(15) Harald Reinl avait d'abord
été annoncé comme réalisateur (mars
1967), mais la liste des vedettes pressenties - Steward Granger,
Peter Van Eyck, Gina Lollobrigida, Nadja Tiller, Johanna von
Koczian - effraya les banquiers qui exigèrent un cinéaste
plus connu. Un premier script de Wolfgang Reinhardt et des Suisses
Richard Schweizer et Max Haufler, refusé, date déjà
de 1961. - Retour texte
(16) Le Film allemand, n° 16-17, 12 septembre 1968, p. 9. - Retour
texte
(17) Die Welt, 21 décembre
1968. - Retour texte
(18) Süddeutsche Zeitung,
8 février 1969. - Retour texte
(19) Lettre à l'auteur, 24
octobre 1976. - Retour texte
(20) Zoom, n° 7, 8 avril 1971,
p. 15. - Retour texte
(21) Hervé DUMONT, Robert
Siodmak. Le maître du film noir, Lausanne, L'âge
d'homme, 1981, pp. 319-325. - Retour texte
(22) Titre de production italien
(?). - Retour texte
(23) Titre de diffusion internationale.
- Retour texte
(24) Titre traduit (?). - Retour
texte
(25) Exilée dans une petite
île du lac Bolsena, Amalasonte/Amalaswinta mourut étouffée
(ou étranglée ?) dans son bain, le 30 avril 535,
sur l'ordre de son cousin et époux Théodat, que
par son mariage elle avait fait monter sur le trône d'Italie.
- Retour texte
(26) C'est-à-dire arrondies
sur le front extérieur et carrées sur le front
intérieur. - Retour texte
|
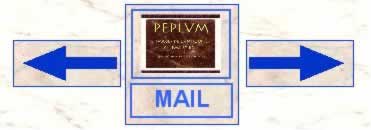
|