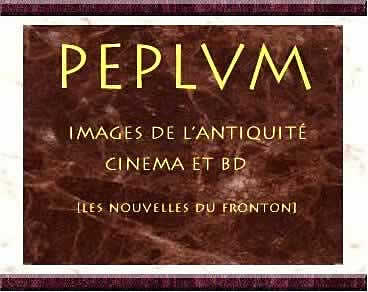 |
| |
| |
La bataille des Thermopyles
(Three Hundred Spartans,
Rudolf Maté, 1961)
Aujourd'hui est un beau jour
pour mourir...
|
|
| |
|
| |
La bataille des Thermopyles
(Three Hundred Spartans,
Rudolf Maté, 1961)
Aujourd'hui est un beau jour pour mourir...
«A Marathon, mon père n'avait lancé
qu'une vague. Moi je déchaîne un océan
!» Une armée d'invasion innombrable déferle
sur la Grèce. Pour s'y opposer, 300 guerriers de Sparte
s'offriront en holocauste ! Pour le taciturne roi Léonidas,
l'exemple vaut mieux que de creux discours politiciens...
Deux projets de remakes du film de Rudolph Maté
avaient été annoncés en 2002, qui semblent
aujourd'hui tombés aux oubliettes.
La sortie en DVD Zone 2 chez Fox Pathé Europa du chef-d'œuvre
de Maté, le 6 avril 2005, est pour nous l'occasion
de ressortir ce dossier naguère publié sur le
défunt Cinérivage.com, revu et augmenté,
et complété de l'iconographie qui s'imposait.
|
|
| La
bataille des Thermopyles
(Three Hundred Spartans, Rudolf Maté,
1961)
Aujourd'hui est un beau jour pour mourir...
| |
Des Lacédémoniens
tombés aux Thermopyles
Le sort fut glorieux, et sublime la mort...
Leur superbe linceul, ni la corruption,
Ni le Temps destructeur ne le pourront flétrir.
SIMONIDE DE CÉOS (556-467 av. n.E.) |
|
|
|
I. Les Guerres Médiques à
l'écran
Deux films se sont attachés à décrire cette
période de l'Histoire de la Grèce antique : La
bataille de Marathon (Jacques Tourneur, 1959) et La bataille
des Thermopyles (Rudolph Maté, 1961), auxquels on pourrait
éventuellement rajouter une adaptation TV des Perses
d'Eschyle pour la R.A.I. signée Vittorio Cottafavi (1975).
Les Guerres médiques furent le grand moment de l'Histoire
grecque. Dans les années '60, ces deux films majeurs -
l'un, italien, tourné en Yougoslavie; l'autre, américain,
réalisé en Grèce - en célébrèrent
la gloire. Au niveau du corpus, c'est relativement peu de volume,
alors que la Guerre de Troie (CLICK
et CLICK), par exemple,
a suscité une véritable pléthore de remakes.
| 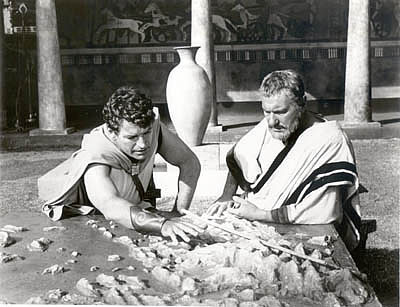
Léonidas
(Richard Egan) et Thémistocle (sir Ralph Richardson)
parlent d'une seule voix, dans le film. Résister.
Défendre la Grèce. Roublard, le politicien
athénien place sa flotte sous le commandement des
Spartiates... qui ne connaissent rien aux choses de la mer
: «Comme ça ton amiral ne gênera pas
le mien !»
En fait, à Salamine, Thémistocle aura quelques
difficultés à faire accepter sa stratégie
par l'«amiral spartiate» Eurybiade qui lèvera
sur lui son bâton de commandement. «Frappe,
mais écoute !» |
Le film
Illustrant le même propos que La bataille de Marathon
- un petit peuple libre et héroïque se dresse contre
la tyrannie asiatique -, La bataille des Thermopyles n'en
est pas moins un film atypique, s'agissant d'une production américaine
tournée en Grèce avec des techniciens italiens,
le cas est unique. Mais, si La bataille de Marathon finit
sur la victoire des Grecs, La bataille des Thermopyles,
après l'écrasement des martyrs, s'achève
elle par un plan sur le monument moderne, non pas celui des Thermopyles
édifié en 1955, mais celui du Soldat Inconnu, à
Athènes. C'est devant cette œuvre des sculpteurs Dimitriadis
et Rok que, place
de la Constitution, (platia Syndagma) les touristes
peuvent assister à la relève de la Garde, les Evzones
au costume si pittoresque, avec leur jupette plissée -
la fustanelle - dont les quatre cents plis symbolisent les 400
années d'esclavage sous le joug turc. C'est alors que se
répercute en écho la promesse d'une victoire finale
: Léonidas le Spartiate se tiendra en esprit aux côtés
de l'Athénien Thémistocle, avec la flotte. A Salamine.
La volonté des morts et celle des vivants tendues vers
un même objectif.
Poème de mort. Poème patriotique. «Tu
vas mourir, roi Léonidas. - Mais la Grèce vivra
!» L'image d'Epinal n'est pas loin, mais ô combien
rafraîchissante. Un rappel de valeurs oubliées...
Le film est admirablement servi par le jeu sobre de l'ancien champion
de judo et déjà vétéran du péplum
Richard Egan (1),
dans le rôle de Léonidas, entouré d'excellents
acteurs comme sir Ralph Richardson dans le rôle de Thémistocle,
le politicien roublard, et de l'actrice grecque Anna Synodinou,
dans celui de la reine de Sparte, Gorgo, énergique mais
en même temps soumise à la volonté des dieux
(«On m'a prédit que les femmes chanteront mon
amour pour toi !»). Une mention toute particulière
pour John Crawford, superbe de puissance dans le rôle du
fruste mais loyal lieutenant de Léonidas, Agathon. Encerclés
de toutes parts, Agathon et Pentheus (Robert Brown), les deux
lochagoï (lieutenants) de Léonidas ne livreront
pas le corps de leur roi tombé. Ils lutteront jusqu'à
la mort pour ses dépouilles, dans la plus pure tradition
des héros d'Homère. La scène n'est pas sans
anticiper celle que filmera Sergueï Bondartchouk neuf ans
plus tard pour Waterloo, lorsque les canons anglais «fusilleront»
à bout portant le dernier carré de la Vieille Garde,
après que le général Cambrone ait lâché
son mot historique. Mais aux Thermopyles, il n'y eut pas de Perse
pour paraphraser l'ultime sommation : «Braves Français,
vous avez fait tout ce que l'honneur exige...»
Pour filmer l'extermination des derniers «Thermopylomaques»
sur le kolônos et figurer ces nuées de flèches
«qui obscurcissaient le ciel» (HDT., VII, 226),
Maté utilisera vingt «bazookas» à air
comprimé, chargés de projectiles jusqu'à
la gueule - obtenant ainsi une telle densité de feu au
départ, qu'à l'arrivée (impact), il lui faudra
recourir à un expédient afin de ne pas massacrer
pour de vrai les figurants du «dernier carré»
grec : la pellicule sera griffée.

Agathon (John Crawford) veille sur le
mur Phocidien,
ultime rempart de la Grèce.
|
|
| |
|

Léonidas (Richard Egan) et son
épouse, la reine Gorgo (Anna Synodinou). «Les
Thermopyles ? Mais c'est loin de Sparte ! - Pour un
Grec, aucun lieu de Grèce n'est éloigné
!» |
|
|
| |
|
Opérateur de talent et réalisateur
de nombreux westerns, Rudolph Maté (2)
n'en était pas à son premier péplum puisqu'en
1957, il avait déjà signé Revak le Rebelle
(Revak, lo schiavo di Cartagine - avec Jack Palance), un
médiocre téléfilm qui fut cependant exploité
en salle. Détail amusant, l'un des protagonistes était
le Spartiate Xanthippe, général mercenaire au service
de Carthage, mais désapprouvant la barbarie «orientale».
La beauté des paysages grecs est admirablement mise en
valeur par la photographie nuancée de Geoffrey Unsworth
(qui plus tard signera les images de Superman, 1978) et
le rythme du film est remarquablement soutenu par une musique
de Manos Hadjidakis (1925-1994) alliant les compositions symphoniques
à des éléments folkloriques hellènes
(bouzoukia). Avec Les Enfants du Pirée (du
film de Jules Dassin Jamais le Dimanche/Never on Sunday,
1960), Hadjidakis fit connaître du grand public les mélodies
populaires grecques, préparant le terrain à Mikis
Théodorakis (Zorba le Grec, Michael Cacoyannis,
1964) et à la déferlante du sirtaki.
Soulignons enfin parmi les scénaristes - George St. George
(également producteur), Ugo Liberatore, Giovanni D'Eramo
et Gian Paolo Callegari - la présence de l'Italien Remiggio
Del Grosso qui, d'après Plutarque et Shakespeare, scénarisera
ensuite quelques épisodes tirés de l'histoire de
la Rome républicaine tel Mucius Scævola et
Coriolano, Eroe senza Patria assez réactionnaires.
Dans ce dernier film, les tribuns de la plèbe - ennemis
de l'aristocrate Coriolan - sont en fait des agents à la
solde des Volsques ennemis. Contrevérité historique
(3)
non dénuée d'arrières-pensées en ces
temps de guerre froide, assurément. Passé à
la réalisation, il signera également une curieuse
séquelle de Quo Vadis ?, Ursus et la Fille des Tartares
: au XIIe s., le héros polonais Ursus
lutte contre l'envahisseur «Tartare», c'est-à-dire
métaphoriquement les Russes.
Conçue dans la même perspective vibrante que The
Alamo (John Wayne, 1960), La bataille des Thermopyles
est plus concise, quoique traitant d'événements
similaires - dans un ancien monastère, une poignée
de patriotes assiégés par un ennemi supérieur
en nombre, sont exterminés après treize jours de
siège. Politisant la campagne publicitaire de son film
sorti à la veille des élections présidentielles
qui allaient porter J.F. Kennedy au pouvoir, John Wayne avait
vu se mobiliser contre lui non seulement ses ennemis idéologiques,
mais aussi ses amis texans. Avec un louable souci de rigueur historique
(le cow-boy hollywoodien était marié à une
hispanique, la péruvienne Pilar), son film saluait la valeur
et l'esprit chevaleresque du général ennemi, le
dictateur Santa-Anna (4).
Rien de tel dans La bataille des Thermopyles où,
a priori, en dépit ou à cause de la référence
classique à l'Antiquité grecque, épouser
une cause aussi lointaine dans le temps et dans l'espace - l'Occident
agressé et victime, l'Orient barbare et impérialiste
- relève du lieu commun.
Il y aurait une relation (5)
à faire entre la production de ce film américain
tourné en Grèce, en 1960, et l'érection en
1955 par la préfecture de Lamia du monument avec statue
en bronze de Léonidas aux Thermopyles, sur l'emplacement
identifié comme le kolônos, le mamelon où
furent exterminés les derniers compagnons de Léonidas,
qui refusaient de livrer le cadavre de leur roi - scène
bien mise en valeur par le film. Cette statue avait été
financée par souscription internationale lancée
par une association de 300 Grecs américains, «Les
Chevaliers des Thermopyles». Comme telle autre de Léonidas
érigée à Sparte-Mistra, elle portait sur
son socle l'inscription Molon labé («Viens
les prendre !»), la réplique de Léonidas-Richard
Egan à Hydarnès, en Grec moderne d'abord, puis en
anglais/français à l'intention des spectateurs.
Pas plus sans doute que ne devait être un hasard la publication
par l'Ecole française d'Athènes des Problèmes
historiques autour de la bataille des Thermopyles (6),
qui sort en même temps que le film auquel il ne fera du
reste (bien sûr) aucune allusion.
|
Molôn labé ! - Viens les prendre
!»
Ces deux statues contemporaines - à gauche, aux Thermopyles
(1955) (phot. M. Eloy); à droite à Sparte
(Mistra) - rappellent à travers l'exemple antique
de Léonidas le «Non» de Metaxas à
Mussolini, en 1940. |
|
| |
Le site historique des Thermopyles
était inutilisable. En effet, les alluvions du Sperchios
ont complètement modifié la configuration des lieux,
étirant sur cinq kilomètres un étroit passage
entre la mer et la montagne où, en -480, en certains points,
un chariot avait juste la place pour passer. En outre, la colline
où périrent les derniers défenseurs grecs,
maintenant surmontée par l'imposant monument commémoratif
de 1955, se détache sur le fond d'un ciel strié
de lignes à haute tension, ce qui n'arrange pas les choses...
Filmée (sauf erreur) dans la région de Marathon,
la production bénéficia, en revanche, du concours
de l'Armée royale hellénique pour la figuration
et, pour les questions de reconstitution, de deux conseillers,
l'un militaire : le major grec Cléanthis Damianos, l'autre
historique : Paul Nord (7).
Aussi peut-on s'étonner de certaines approximations dans
les scènes de bataille. Léonidas, par exemple, défendit
certainement le goulot à l'endroit le plus resserré
et n'eut pas à déployer ses troupes comme on le
voit spectaculairement dans le film. Hérodote note qu'à
la hauteur du mur Phocidien, où le roi de Sparte s'était
retranché, le défilé était large d'environ
un demi-plèthre, soit une quinzaine de mètres (8).
Et le Père de l'Histoire d'ajouter qu'aux deux extrémités
du défilé, soit respectivement à la hauteur
des bourgades d'Alpènoi et d'Anthélé, il
y avait juste assez de place pour le passage d'un char (HDT, VII,
176). La longueur totale du défilé était
d'environ six kilomètres. Dans de telles circonstances,
la supériorité numérique des Perses ne leur
était d'aucun secours, sauf à se gêner mutuellement.
|
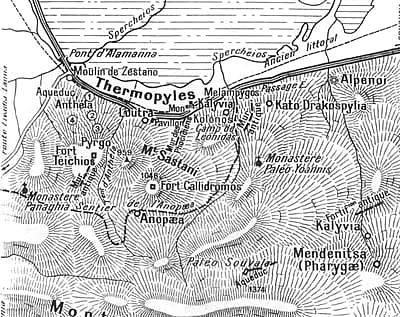
Le défilé des Thermopyles (Extr.
Guide Bleu Grèce, Hachette, 1967). |
|
| |
La tactique de la phalange grecque
reposait sur les files en profondeur et non sur les rangs frontaux,
au contraire du film (nous y reviendrons).
Précisons encore que les Spartiates portaient les cheveux
longs et la barbe, ce qui n'est pas le cas dans le film qui a
cru devoir les «relooker» sans doute pour permettre
au public de mieux s'identifier à eux et à la cause
sacrée de la liberté qu'ils défendaient.
Ceci nous prive de la scène décrite par Hérodote,
où l'on voit les Spartiates - dédaigneux de la proximité
de l'ennemi - paisiblement occupés à soigner leur
coiffure. On sait qu'au moment de la bataille ils se couronnaient
de fleurs, et, après un sacrifice à Arès,
marchaient à l'ennemi au son des flûtes et en chantant
l'air de Castor ou quelque ode de Tyrtée, le poète
national.
| 
Xénophon a évoqué
les phalanges d'Agésilas, roi de Sparte, «toutes
en bronze, toutes en pourpre» (XÉN., Agés.,
II, 7) et, de même, a noté que la vue des manteaux
écarlates et des longs cheveux des hoplites spartiates
suscitait la terreur chez l'ennemi qui les voyait (XÉN.,
Const. Lacéd., X, 3. 8).
Le tacticien Asclépiodote fait la même observation
à propos de la série de rangées de
lances pointées, quand à Eupolis (frag. 359),
il nous conservera le mémorable tableau de Cléon
l'Athénien prenant ses jambes à son cou en
voyant les lambdas sur les boucliers spartiates brillant
dans la plaine. (Tous ces exemples littéraires sont
empruntés à V.D. HANSON, Le modèle
occidental de la guerre, op. cit., p. 138). |
|
| |
Au contraire, le film les montre
affrontant l'ennemi dans un silence impressionnant. Mais, flûtistes
en tête et armés de pied en cap, on les voit traverser
le Péloponnèse - ce qui est peu vraisemblable, puisque
l'on sait que chaque combattant emmenait avec lui un ou plusieurs
goujats pour porter ses armes, lesquelles il ne revêtait
qu'au moment de combattre (9).
Hors ces petites réserves - mais les détails techniques
ont tout de même leur importance -, tout est juste dans
ce film et finement restitué : les anecdotes (la remise
du bouclier : «Reviens
avec lui ou sur lui») le lambda initiale
de «Lakédaimon» sur l'épisème
du bouclier, les cuirasses...
|
Types d'hoplites grecs. A
gauche : Coiffé du classique casque corinthien,
cet hoplite porte un lourd thorax de bronze. Son
bouclier échancré sur les hanches est d'un
modèle archaïque. Statuette de bronze dédiée
à Zeus, trouvée dans le sanctuaire de Dodone
(ca. 500 - Berlin, Antikenmuseum, Staatliche Museen Preussischer
Kulturbesitz) (Extr. P. DUCREY, op. cit.).
A droite : D'un type plus récent, cet hoplite
spartiate porte la linothorax, faite de plusieurs
épaisseurs de lin collées. On notera les cheveux
longs, et aussi la lance - plus longue que celles utilisées
dans le film, mais aussi avec un fer beaucoup plus court
! Son casque à cimier transversal - un officier ?
- est inspiré d'une statuette de bronze du début
du Ve s., probablement de facture laconienne, conservée
au Wadsworth Atheneum (Hartford, Conn.).
(Figurine de plomb peinte par Joseph Katsikis - photogr.
Alexandre Eloy - coll. Michel Eloy.) |
|
| |
On voit se superposer deux types
de panoplies dans le film : déjà archaïque,
le lourd thorax de bronze est peut-être légèrement
anachronique au moment des faits, mais rend bien le caractère
«conservateur» des Lacédémoniens. Les
Thespiens, par contre, portent la linothorax, la cuirasse
de lin renforcé, plus légère et plus moderne,
dont l'emploi, avec l'extension des conflits, va se généraliser
pendant la Guerre du Péloponnèse.
Le message écrit sous la cire des tablettes est dans Hérodote;
l'audacieuse attaque du camp de Xerxès est inspirée
de Diodore de Sicile, quoique niée par les historiens modernes
(Diodore écrivait plus de 400 ans après les faits).
L'équipement des Immortels est copié d'une mosaïque
hellénistique de Pompéi (mais n'eut-il toutefois
pas été plus judicieux de se baser sur la célèbre
frise de Suse ?).
|
A gauche : Les Immortels,
la Garde du Grand Roi dont l'espèce de cagoule est
copiée sur celle des combattants perses de la mosaïque
de Pompéi, La bataille d'Alexandre, copie
d'une peinture d'Apelle.
A droite : Les Immortels dans leur robe de parade,
tels que représentés sur le fameux bas-relief
de Suse... et tels qu'on ne les voit pas dans le film. |
|
| |
Les scénaristes, on l'a vu,
ont choisi de trop bien suivre la thèse lacédémonienne
- rapportée par Hérodote -, flatteuse pour l'orgueil
national grec, des «300 Spartiates». C'est tout juste
si les alliés de Léonidas sont une fois incidemment
mentionnés dans le dialogue : on ne les verra jamais, excepté
les (700) Thespiens de Démophile. En réalité,
les Grecs étaient un peu plus de 7.000 hommes, les Lacédémoniens
eux-mêmes étant, selon Diodore, au nombre de 1.000.
A en croire le cinéaste donc, en dehors de l'arrière-garde
des Thespiens et la présence de la flotte athénienne
sur son flanc, le verrou des Thermopyles ne tint que par la bravoure
des seuls 300 Spartiates ! Omission non dénuée d'arrière-pensées,
si l'on considère Sparte comme l'incarnation par excellence
du militarisme grec («La troisième civilisation
grecque promise [par Ioannis Metaxas, lors du «4 août
1936»] s'inspire sélectivement de Sparte (la
discipline d'Etat), de la Macédoine (l'union politique
de l'hellénisme) et de Byzance (la combinaison d'un Etat
fort et d'un idéal religieux)» [10]),
qui va aboutir à la dictature des Colonels.
 |
|
| |
La tactique de la phalange
Les hoplites combattaient en masse compacte, leurs boucliers se
chevauchant comme des écailles d'un même corps, la
lance brandie par-dessus (comme on peut les admirer sur le vase
de Chigi), et non comme le montre le film, à hauteur de
la taille, entre les boucliers (lesquels étaient
conçus [11]
pour se chevaucher comme des écailles). Or, malgré
le concours d'un conseiller militaire grec, la tactique guerrière
des Spartiates n'est pas conforme à la réalité
archéologique, mais elle «chorégraphie»
et met en évidence la supériorité intellectuelle
et morale des Grecs dont elle souligne le petit nombre.
Imaginons la retransmission d'une «manif» au JT
: un mince cordon de CRS (les Spartiates) contient la masse compacte
et bon enfant des manifestants (les Barbares). Tout repose bien
évidemment sur le consensus tacite de ne pas provoquer
de bagarre. Changeons de scénario : un incident éclate,
une provocation, et la foule jusque-là docile se fait hostile
: le mince cordon casqué, couvert par ses boucliers est
bien vite bousculé, enfoncé. Interviennent alors
les autopompes. Fin du JT. Retour à la vidéo du
film : les Spartiates n'ont pas d'autopompes... et ne semblent
pas en avoir besoin : contre toute attente leur mince cordon résiste
et même repousse l'adversaire. Ils ont même prévu
une de ces «fines ruses de guerre» de derrière
les fagots, si l'on peu dire : feignant être mort, un guerrier
spartiate a dissimulé une torche derrière les débris
d'un char et met le feu à un tracé de paille qui
en s'enflammant crée un mur de flammes suffisant (?) pour
isoler une partie du bloc compact des Perses, les trois ou quatre
premiers rangs qui ont enjambé son corps, et que les Spartiates
peuvent massacrer tranquillement grâce à - dixit
Léonidas (VF) - «notre technique spéciale
du corps à corps».
| 
La cavalerie russe s'est
ébranlée. (...), elle se lance au galop, fonçant
droit sur la ligne fragile des Ecossais, cette fameuse
«mince ligne rouge» passée dans la
mythologie militaire britannique.
(...) Neuf cents cavaliers chargent en avalanche deux lignes
de quelques certaines de fantassins. Fusils levés,
les Highlanders les laissent venir avec leur flegme habituel,
puis les accueillent de trois décharges bien ajustées.
Flottement chez les Russes (...). Les Ecossais [sont] saisis
d'un frisson offensif (...), sir Colin, toujours calme,
doit les retenir : «Le 93e ! Pas tant de zèle
!»
Alain GOUTTMAN, La guerre de Crimée (1853-1856).
La première guerre moderne, Perrin, 2003 |
|
| |
Le film méconnaît délibérément
le principe fondamental de la phalange grecque qui, contre toute
apparence, n'est pas axée sur la rangée frontale
mais les files en profondeur. Les Spartiates combattaient en rang
serrés, formant bloc, leurs boucliers (hoplon) se
chevauchant comme les écailles. Les boucliers ronds du
film, frappés du lambda, ne sont manifestement pas
de ces boucliers d'hoplites dont le diamètre devrait être
égal à la longueur double de l'avant-bras. Or ceux
du film protègent seulement sur toute sa largeur celui
qui le porte, au lieu d'également couvrir son voisin de
gauche (chacun une moitié du bouclier). Quant aux lances,
elles sont - dans le film - tenues à la hauteur de la taille,
au lieu d'être brandies à la hauteur du visage, par
dessus le mur des boucliers.
Une mise en scène ne vise pas non plus à la reconstitution
mais à la signification d'une idée, ici la supériorité
des Grecs, disciplinés et méthodiques, face à
la horde hurlante des barbares venu d'au-delà de l'Hellespont
- les Turcs ? le Pacte de Varsovie ? en fait, plus probablement,
les forces de l'Axe et le fameux «Non» de Metaxas,
le 28 octobre 1940... «Aucun endroit de Grèce
n'est loin de Sparte», répond le lion hellène
à son épouse, quand celle-ci objecte que le défilé
des Thermopyles est une marche lointaine. Mais lorsque, fièrement,
Léonidas rétorque à l'ennemi - en grec moderne
(12)
- Molôn labé («Viens les prendre [mes
armes] !»), inscription qui partout en Grèce figure
sur le socle des statues
dédiées au héros national, comment ne pas
reconnaître dans La bataille des Thermopyles une
fable patriotique grecque (le patron de la Fox est, alors, Spyros
P. Skouras, coïncidence [13]
?) dédiée à la Meghali Idea - la «Grande
Idée» dix-neuvièmiste d'une restauration de
l'Empire byzantin -, qui avait encaissé un terrible revers
à Smyrne en 1921 (14)
et s'apprêtait à en subir un autre à Chypre
(1974) avec l'échec de l'Enosis («rattachement
à la Grèce»).
 |
|
|
Quand l'Histoire se répète
«Nous ne pouvons croire qu'un Etat formidablement armé
de 85 millions d'hommes, qui lutte pour instaurer dans le monde
un ordre nouveau basé, dit-il, sur la morale, se résoudra
à attaquer de flanc une petite nation de 7 millions d'habitants,
qui lutte déjà pour sa liberté contre un
empire de 45 millions d'hommes...»
(Georges VLACHOS, I Kathimerini, 8 mars 1941 - lettre ouverte
à l'archichancelier du Reich, Adolf Hitler)
| 
Ioannis Metaxas (Ithaque,
1871 - Athènes, 1941), l'homme qui dit Ochi,
«Non» au Duce (le 28 octobre 1940, date
historique commémorée en Grèce).
(Extr. de Costa DE LOVERDO, La Grèce au
combat (1940-1941), Calmann-Lévy, 1966.) |
|
| |
| 
Les Dornier nazis survolent
l'Acropole d'Athènes, ajoutant de nouvelles
ruines.
(Extr. «La bataille de Crète»,
Historia magazine (2e Guerre Mondiale) (Tallandier
éd.), n 19, 1968.) |
|
Maîtresses de la Grèce le 1er juin 1941 après
avoir écrasé les Anglo-Grecs dans les montagnes
du nord, les troupes hitlériennes - accourues à
la rescousse de Mussolini défait dans les montagnes du
Pinde - hissèrent le drapeau à croix gammée
sur l'Acropole. Mais le Führer venait, à son insu,
d'enclencher le mécanisme qui allait lui être fatal.
Retardée de cinq semaines, son attaque de l'Union Soviétique
allait confronter au terrible «Général Hiver»
la Wehrmacht partie en tenue d'été.
De son trône installé en haut de cette même
Acropole 2.500 ans auparavant, Xerxès, un mois à
peine après son triomphe aux Thermopyles, allait assister
à l'écrasement de sa flotte à Salamine...
| 
De son trône dressé en quelque
lieu élevé, Xerxès (David Farrar)
assiste à l'anéantissement de ses Immortels,
taillés en pièces par les Spartiates |
|
|
Le Monument contemporain
| 
Un monument en l'honneur
de Léonidas fut inauguré en 1955 par
le roi Paul de Grèce. Orné de bas-reliefs
évoquant la bataille, ce monument de marbre
blanc est sommé d'une statue en bronze du roi
de Sparte, casqué et armé. De l'autre
côté de la route, on peut monter au sommet
du kolônos, théâtre de l'ultime
résistance spartiate, où les Amphictyons
firent graver deux dédicaces. L'une commémorait
la participation des Péloponnésiens
: «C'est ici qu'un jour, quatre mille hommes
venus du Péloponnèse, affrontèrent
trois cents myriades d'ennemis»; l'autre
le sacrifice des Spartiates : «Passant, va
dire à Sparte que nous gisons ici pour obéir
à ses lois» (15)
(HDT., VII, 223-228). (Phot. M. Eloy) |
|
| |
| 
Démophile fils de Diadromès,
chef des 700 Thespiens. (Phot. M. Eloy) |
|
| |
| 
Les Spartiates défendent la
dépouille de Léonidas, leur roi tué.
Détail du monument moderne de 1955. (Phot.
M. Eloy) |
|
|
Suite…
NOTES :
(1) Richard Egan avait incarné
Dardanius, un gladiateur brutal dans Les gladiateurs
de Delmer Daves (1954) et l'empereur perse Assuérus,
dans Esther et le roi de Raoul Walsh (1961). - Retour
texte
(2) Rudolph Maté décédera
le 27 octobre 1964 à Beverly Hills (Californie), peu
après la sortie de La bataille des Thermopyles
sur les écrans européens. - Retour
texte
(3) ... puisque c'est à Coriolan,
justement, qu'il était reproché d'avoir passé
à l'ennemi ! - Retour texte
(4) La
version 2004 d'Alamo par John Lee Hancock - avec
Denis Quaid et Billy Bob Thornton - est moins indulgente et
représente comme un odieux tyran el generalissimo
Antonio Lopez de Santa-Anna ! - Retour texte
(5) La Fox est alors dirigée
par Spyros Skouras, un Gréco-Américain... - Retour
texte
(6) Apostolos DASCALAKIS, Problèmes
historiques autour de la bataille des Thermopyles, De Boccard,
1962. - Retour texte
(7) A ne pas confondre avec le romancier
d'espionnage bien connu, Pierre NORD, auteur e.a. d'un roman
sur le putsch des Colonels, en 1967 : L'été
des Colonels, Le Masque, Lib. Champs Elysées, 1974.
Tiens, tiens... - Retour texte
(8) Un plèthre vaut 27,50 m.
- Retour texte
(9) Rudolph Maté élude
également toutes les références un peu
glauques qui ont fait les délices des romanciers : les
Ilotes, la kryptie, l'exposition des nouveaux-nés, la
flagellation rituelle des enfants, la promiscuité des
jeunes filles, l'échangisme dans un but de procréation,
les castes sociales, le militarisme spartiate - toutes choses
d'ailleurs soumises à controverse, et qui méritent
d'être nuancées; ce qui, bien entendu, ne saurait
constituer l'objet d'un film épique. - Retour
texte
(10) Georges CONTOGEORGIS, Histoire
de la Grèce, Hatier, coll. «Nations d'Europe»,
1992, p. 402. - Retour texte
(11) Le diamètre faisait le
double de la longueur de l'avant-bras, du brassard (porpax)
au centre, à la poignée près du bord (antilabè)
: la partie droite couvrait le porteur du bouclier, la partie
gauche son voisin. - Retour texte
(12) Dans la VAngl comme dans la
VF. La prononciation est moderne, car le bêta y
est prononcé v, et non pas b.
- Retour texte
(13) Le dictionnaire de BESSY &
CHARDANS nous apprend : «Spyros P. Skouras. Prod.
né en 1893 à Skourohorion (Grèce). Emigre
très jeune aux U.S.A. Frère de Charles et Georges
Skouras avec qui il achète un cinéma. Il travaille
ensuite à la Warner, puis à Paramount. Entre en
1931 chez Fox Films. Président de la 20th Century
Fox de 1942 à 1962. Président de la National
Theaters (exploitations pour la Fox) en 1952. Lance en 1953
le Cinemascope grâce à l'Hypergonar du professeur
Chrétien à qui il achète les brevets.»
La dynastie des Skouras est, en fait, une figure de proue du
cinéma hellénique. Ainsi peut-on lire à
propos de son neveu S. Skouras, cofondateur avec Filopimin Finos
des studios de Kalamaki : «Spyros Skouras (Skourohori
1917). Neveu de Spyros P. Skouras. Etudes commerciales à
Athènes. S'occupe depuis 1935 de la distribution et contrôle
plusieurs salles. En 1937 il fonde la société
«Skouras Films» qui représente la 20th Century-Fox
et plusieurs autres sociétés. Spyros Skouras qui
a grandement contribué à l'expansion du bon cinéma
[en Grèce] est président du conseil d'administration
de la Cinémathèque de Grèce depuis sa fondation.
Contrôle trente pour cent des salles de projection grecques
et importe cent cinquante films par an. Depuis 1965, la «Skouras
Films» s'occupe aussi de la production. Associé
à la Sero Amusement Co.» de Los Angeles.»
(Aglaé MITROPOULOS, Découverte du cinéma
grec (préface Henri LANGLOIS), Seghers, coll. Cinéma
Club, 1968, p. 151). - Retour texte
(14) Entre 1912 et 1949 la Grèce
fut près de vingt ans en état de guerre. - Retour
texte
(15) Une troisième stèle,
disparue, était dédiée au devin Mégistias,
qui accompagnait Léonidas - Retour
texte
|
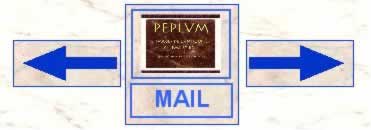
|