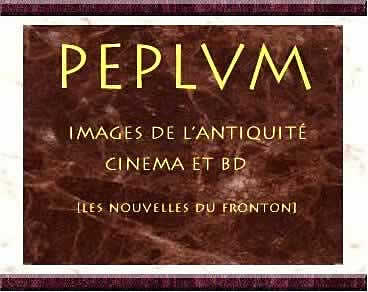 |
| |
| |
Rome
[TV : HBO - BBC]
(Michael Apted, Allen Coulter, Julian Farino, etc. -
EU-GB, 2005)
(page 8/18)
|
|
| |
|
|
| |
POMPÉE (Kenneth
Cranham)
(106-48)
Cn. Pompée est membre du Sénat et consul. Père
de Quintus Pompée (dans le feuilleton) ou, dans l'Histoire,
de Cneius et Sextus Pompeius. Conquérant de nombreux pays,
général de Sylla pendant la guerre civile et la
guerre sociale. Vainqueur de Sertorius, des pirates, de Mithridate,
et même de Spartacus... Conquérant de Jérusalem.
Pompée jouit d'un immense prestige auprès des soldats
et de la population romaine. Kenneth Cranham (Gangster No.
1) interprète Pompée le Grand.
|
| |
| 
Pompée |
|
| |
Général
et homme politique romain, Cneius Pompeius Magnus («le
Grand») était issu d'une illustre famille plébéienne
connue par deux branches : les Rufus (et leur subdivision
les Bithynicus), et les Strabo. Les Pompei Rufi
et Bithynici descendaient de Q. Pompeius, consul en 141,
qui assiégea vainement Numance (140), et qui fut le premier
de la famille à avoir exercé une magistrature curule.
Le père, Cn. Pompeius Strabo
Originaire du Picenum - une terre étrusque autour de Rimini,
largement mélangée de Celtes - Pompée le
Grand était un Strabo. Il était le fils de
Cn. Pompeius Strabo (lui-même fils de Sextus Pompeius, propréteur
de Macédoine en 117, où il périt en combattant
les Celtes) et appartenait à la tribu Clustumina.
Sa mère Lucilia était une fille du sénateur
Manius Lucilius, et il semble qu'une autre Lucilia - une de ses
sœurs - ait épousé un M. Atius Balbus, ce qui
ferait de celle-ci l'arrière-grand-mère d'Octave,
fils d'Atia.
Cn. Pompeius Strabo était un grand propriétaire
du Picenum, cependant que son épouse Lucilia possédait
d'autres terres dans la région de Tarente. Strabo fut questeur
en Sardaigne (105), propréteur en Macédoine (date
?), puis légat du consul P. Rutilius Lupus (90) pendant
la Guerre sociale. Enfin, il devint lui-même consul avec
L. Porcius Cato (le père de Caton
d'Utique), en 89.
Cette année-là, Strabo vainquit les Italiques à
Firmum et à Asculum, dont il fit exécuter les chefs
et officiers avant de raser la ville après en avoir vendu
les habitants à l'encan. Dans son armée devant Asculum,
il y avait les fameux Catilina (CLICK
et CLICK), Cicéron
et Gellius
(Gellius, le consul de 72 qui se laissera battre par Spartacus
!). Toutefois Strabo eut surtout la joie de s'y voir rejoint par
son fils de 17 ans, Cneius - notre Pompée -, qui
venait de prendre la toge virile !
Pompeius Strabo eut droit au Triomphe, à Rome, le 25
décembre 89. L'année suivante, le proconsul Strabo
espérait être désigné pour aller combattre
Mithridate en Asie mineure, mais ce fut Sylla qui fut choisi,
et il eut en outre l'amertume de voir le commandement de ses troupes
conféré à son cousin éloigné
Q. Pompeius Rufus. A son instigation, les légionnaires
massacrèrent leur nouveau général le jour-même
de sa prise de commandement. Alors, le Sénat se vit bien
dans l'obligation de le confirmer dans son commandement lorsque
le marianiste Cinna marcha sur Rome. Un moment, Strabo balança
- hésitant entre son ressentiment contre le Sénat
et sa haine des populares. Les deux Pompée affrontèrent
finalement Sertorius (le lieutenant de Cinna) devant la Porte
Colline; puis Strabo entreprit des négociations avec Cinna...
qui venait d'échouer à le faire assassiner. C'est
à ce moment que la peste l'emporta (ou une autre tentative
d'assassinat réussit-elle ?).
Le peuple romain ulcéré - il le tenait pour responsable
des rigueurs du siège et de l'épidémie -
mit en pièces son cadavre. Marius et Cinna étaient
désormais maîtres de la ville.
Le fils, Cn. Pompeius Magnus
Se défiant de Marius, le jeune Pompée se retira
dans son fief du Picenum. Marius décéda d'une pleurésie
en 86 (17 janvier), dans son septième consulat.
Quand au printemps 83, le conservateur Sylla - retour d'Orient
- débarqua à Brindisium avec 34.000 hommes, Cn.
Pompée prit l'initiative de lever trois légions
parmi ses clients picentins - la tribu
Velina - et se porta au-devant de Sylla, à qui il offrit
son aide. Il n'était pas le seul à en avoir eu l'idée,
mais en tout cas il était à la tête du contingent
le plus important. L'aventure de Pompée le Grand commençait...
La Chronologie ci-dessous reprend les
principales étapes de la carrière de cet ancien
lieutenant de Sylla, qui n'était pas Romain de souche et
- par conséquent - suscitait la méfiance, voire
le mépris des Républicains conservateurs du Sénat.
Sa carrière de soudard est atypique, car Pompée
parvint au consulat sans passer par le cursus honorum,
mais exerça en 77 - dans la guerre contre Sertorius, en
Espagne - la fonction de proconsul... sans l'être (non
pro consule, sed pro consulibus), forçant ensuite la
main du Sénat pour qu'il lui confère le consulat,
conjointement avec Crassus, au lendemain de leur commune victoire
sur Spartacus.
Comme César et avant lui, Pompée
brigua le pouvoir personnel - au dam de Caton-le-Jeune - et joua
la carte du populisme en s'associant avec Crassus et César.
Mais lorsque se disloqua leur triumvirat, il rallia la cause de
ses adversaires politiques d'hier et le «Seigneur de la
Guerre» du Picenum qu'il était se fit le champion
des conservateurs, entraînant dans son sillage des gens
qui avaient eu les meilleures bonnes raisons de se méfier
de lui comme Caton, ou de le haïr comme Brutus (dont il avait
fait assassiner le père marianiste, pendant la précédente
guerre civile). |
| |
| 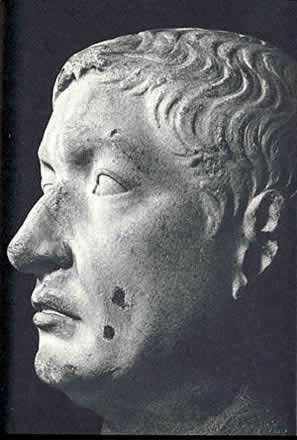
Pompée le
Grand, au Musée du Louvre (ph. Giraudon -
extr. Benoist-Méchin, Cléopâtre
ou le rêve évanoui, Clairefontaine,
1964)..
|

... et au Musée du Capitole
(ph. Anderson - extr. A. Weigall, Cléopâtre,
Payot, 1952) |
|
|
| |
Dans sa saga Les
Maîtres de Rome, Colleen McCullough raconte l'ascension
de Jules César, mais démarre en fait bien avant
sa naissance avec le conflit qui opposa Marius et Sylla. Elle
trace un étonnant portrait de celui-ci qu'elle surnomme
«le Petit Boucher». Quel personnage que cet «homme
nouveau», génie militaire mais nullité politique.
Ce fut une des créatures de Sylla, le conservateur.
Adoncque, Pompée obtint en 55 l'Espagne
(où il a déjà guerroyé contre Sertorius)
pour province, mais préfère rester à Rome
tandis que ses légats l'administrent à sa place.
Il ne bougera plus de Rome jusqu'en 49, quand César ayant
franchi le Rubicon, l'en chassera. Il administre la ville tandis
que ses associés César et Crassus font campagne
qui en Gaule, qui en Syrie. La mort de Julia en 54, puis de Crassus
en 53, vont changer la donne. En 52, l'année où
tombe Alésia, il est consul unique (sine collega).
Un avant-goût du pouvoir absolu ?
Eclipsé par le soleil de César
Romanciers et scénaristes vont s'en donner à cœur
joie pour imaginer les complots ourdis dans l'ombre par Pompée.
Dans Rome (HBO), un agent de Pompée vole une des
aigles de César, espérant par ce sacrilège
démoraliser ses légionnaires.
Jacques «Alix»
Martin, dans sa bande dessinée fameuse, a brodé
pas mal de romans autour du «malfaisant» Pompée
: il embauche des «soldats perdus» mais prêts
à tout, des survivants de l'armée de Crassus (Alix
l'Intrépide, 1948); tandis que César assiège
Alésia, il fabrique des armes secrètes en Egypte
impliquant de la poudre noire explosive (Le Sphinx d'Or,
1951). Dans Les Légions Perdues (1962), c'est l'épée
de Brennus - conservée dans le Capitole - que Pompée
fait voler par ses sbires, pour livrer ce talisman fédérateur
aux barbares germaniques et celtes qui veulent bouter César
hors de Gaule. Et dans Vercingétorix (1985), il
évade de la Mamertine le roi Arverne pour le renvoyer en
Gaule dans l'espoir de priver César de son trophée
lors de son Triomphe. Dans la série Væ Victis
de Mitton et Ramaïoli, ce sont par contre des agents de Crassus
qui remettent des fonds aux barbares pour qu'ils exterminent César
et ses légions. L'idée du «rififi» chez
les triumvirs n'est pas donc nouvelle.
Aucune aigle de César
n'a été volée, historiquement parlant. Mais
César met en évidence la valeur de l'aigle au moins
à deux reprises (CLICK
& CLICK). Comme
l'histoire des quinze cohortes des XIIIe et XIVe légions
de Sabinus et Cotta, massacrées à l'Atuatuca en
essayant de sauver leur aigle, tombe un peu à plat - César
ne disant pas ce qu'il en advint -, les scénaristes de
Rome (HBO) ont rapproché l'épisode de celui
de Pullo et Vorenus, quelques paragraphes plus loin. Les scénaristes
ont donc brodé en situant en 52 des événements
survenus en 54, remplaçant Quintus Cicéron par Marc
Antoine. Et en montrant Pompée dans le rôle du gros
méchant - C.Q.F.D.
«Malgré le caractère
révolutionnaire des débuts de sa carrière,
Pompée était au fond, par opposition à la
plupart de ses contemporains nobles, un homme honnête qui
respectait les lois, note Jean H. Croon en guise de bilan
de la carrière de Pompée. Dans sa vie privée
également, il appliqua des normes inconnues des autres
personnages importants. Il passait pour le plus grand général
de son époque. Ses opinions politiques ont souvent été
comparées à celles d'Auguste. Certes, il dut finalement
céder à César, plus génial, mais aussi
plus impitoyable et plus cynique; ce qui reste d'ailleurs tout
à son honneur» (1).
La mort de Pompée
Telles qu'elles sont rapportées dans Rome (HBO),
les circonstances de la mort de Pompée, en Egypte, sont
globalement exactes, mais avec des nuances.
Essayons de reconstituer les faits avérés.
Après avoir fui le champ de bataille de Pharsale, Pompée
navigua vers Mytilène (Lesbos), où il récupéra
son épouse Cornelia et ses enfants. A Chypre, il réussit
à rassembler quelque 2.000 hommes et fit voile vers l'Egypte.
Des vents contraires l'empêchèrent d'aborder directement
à Alexandrie. Il jeta donc l'ancre devant Péluse
- non loin du cap Kasion -, où l'armée de Ptolémée
XIII guettait l'arrivée de celle de sa sœur Cléopâtre
qui lui contestait le pouvoir. Pompée lui envoya un messager,
pour l'informer de ses difficultés. Les Egyptiens étaient
très ennuyés, se doutant bien que César vainqueur
viendrait leur demander des comptes s'ils aidaient Pompée.
C'est Théodote qui eut l'idée : tuons Pompée,
et offrons sa tête à César en signe d'amitié.
Ainsi, il nous laissera tranquilles !
Ptolémée
envoya son général Achillas et deux centurions romains,
Septimius et Salvius - des officiers des deux légions qu'Aulus
Gabinius, ancien légat de Pompée, avait laissées
à Alexandrie. Achillas s'approcha en barque de la trirème
de Pompée, s'excusant de ne pouvoir venir sur un plus digne
navire à cause des bancs de sable. Il assura Pompée
des bonnes intentions de son souverain et l'invita à passer
à son bord. Rassuré par la présence des deux
vétérans, Pompée embarqua, seulement accompagné
de son affranchi Philippos. Il se plongea dans la lecture de ses
notes, celles du discours qu'il prononcerait lorsqu'il serait
devant Ptolémée. La barque atteignit au rivage,
et Pompée, à la proue, se redressa pour patauger
les derniers mètres dans l'eau. C'est alors que Septimius
lui plongea son glaive dans le dos, tandis que Salvius neutralisait
Philippos. Les hommes d'Achillas tirèrent le corps de Pompée
jusqu'à la grève, le décapitèrent,
et abandonnèrent le cadavre qu'ils avaient dénudé.
Tout cela sous les yeux de Cornelia, qui de la trirème
voyait tout. Personne ne s'intéressant à sa dépouille,
Philippos, avec l'aide d'un autre ancien vétéran
de Pompée qui habitait-là, fit la toilette du mort,
le revêtit de sa propre tunique, le brûla sur la plage
et l'y inhuma. La nuit s'écoula. Alors, le navire conduit
par Lentulus, qui amenait les 2.000 gardes du corps de Pompée,
arriva sur les lieux. Et Lentulus s'inquièta : «De
qui est ce bûcher ?»
Dans son poème épique La
Pharsale, Lucain fait une relation assez trash de la
décapitation de Pompée. «Cependant Magnus,
sous les coups sonores frappant son dos et sa poitrine, avait
conservé la noble dignité de sa beauté auguste;
son visage ne marquait que de l'irritation contre les dieux; les
derniers instants n'avaient rien altéré de l'expression
ni des traits du héros; c'est le témoignage de ceux
qui virent sa tête tranchée. Car le cruel Septimius
invente, dans l'accomplissement même du crime, un crime
plus grand encore : il arrache le voile qui couvrait la face auguste
de Magnus expirant, il saisit la tête qui palpite encore
et place en travers sur un banc de rameur le cou qui s'affaisse.
Alors il tranche muscles et veines, il brise les vertèbres,
longuement; ce n'était pas encore un art de couper une
tête d'un coup circulaire de l'épée. Mais
dès que la tête tombe séparée du tronc,
le satellite du roi de Pharos revendique le droit de la porter
de sa main. Romain dégénéré, soldat
bon pour les seconds rôles, ton épée sacrilège
tranche l'auguste tête d'un Pompée, pour qu'un autre
la porte ? Ô destin de la dernière ignominie! Pour
qu'un enfant impie reconnaisse Magnus, cette chevelure hérissée,
objet de la vénération des rois, ornement d'un front
généreux, une main la saisit et, sur une lance de
Pharos, tandis que la face vit encore et que des râles agitent
la bouche en un dernier murmure, tandis que les yeux encore dévoilés
se figent, on plante cette tête qui, commandant la guerre,
chassait la paix du monde; c'est elle qui agitait les tribunaux,
le Champ de Mars, la tribune; c'est sur ces traits, ô Fortune
de Rome, que tu te plaisais à te contempler. Ce n'est même
pas assez pour l'infâme tyran d'avoir vu ce spectacle, il
veut qu'il reste un témoignage du crime. Alors, par un
art maudit, on enlève le pus de la tête, on vide
la cervelle, on sèche la peau, et, quand on en a épuisé
toute l'humeur corrompue, on y verse un suc qui raffermit la face»
(LUCAIN, La Pharsale, VIII, 663-691).
L'anneau et la tête de Pompée
seront remis à César, qui fera rechercher sa sépulture.
Selon les uns, César renvoya à son épouse
Cornelia la tête embaumée de son mari; selon d'autres
ce furent ses cendres qu'il envoya, la tête étant
inhumée en Egypte.
César pleura l'assassinat de son ancien
gendre. Regret familial ? Conviction que seul un Romain, non un
barbare, avait de droit de disposer de la vie d'un autre citoyen
romain, a fortiori un (pro-)consul romain ? Ou déception
politique de n'avoir pu négocier avec le vaincu le dépôt
des armes par ses partisans... ? Un peu des trois, sans doute.
Car César n'en avait clairement pas fini avec la guerre
civile, qu'il allait devoir continuer en Afrique et en Espagne... |
|
| Chronologie de Pompée |
| |
| 106 |
— |
(29 septembre [calendrier préjulien]) Naissance de
Cn. Pompeius. |
| 89 |
— |
[Pompée a 17 ans] Venant de prendre la toge virile,
il participe au siège d'Asculum, aux côtés
de son père Pompeius Strabo. |
| 88 |
— |
[Pompée a 18 ans] Le choix d'un commandant en chef
pour la guerre contre Mithridate oppose Marius et Sylla (ce
dernier l'emporte), et déclenche une nouvelle guerre
civile. |
| 88-86 |
— |
En Grèce, Sylla assiège et pille Athènes.
Il vainc Mithridate à deux reprises, et les deux parties
signent le «Traité de Dardanos».
Le vainqueur ramène de Grèce le butin de ses
pillages, dont un des transports - la «galère
de Madhia», sur la côte tunisienne - sera fouillée
par le Cdt Cousteau dans les années 1950'. |
| 87 |
— |
[Pompée a 19 ans] Marius profite de l'absence de
Sylla pour proscrire tous ses partisans. |
| 86 |
— |
[Pompée a 20 ans] (17 janvier) Caius Marius décède
d'une pleurésie. |
| 83 |
— |
[Pompée a 23 ans] (Printemps) Sylla - retour de
la Guerre de Mithridate - débarque à Brindisium
avec 34.000 hommes. Pompée le rejoint avec trois légions. |
| 82 |
— |
[Pompée a 24 ans] (1er novembre) Bataille de la Porte
Colline, à Rome. Le jeune Pompée est toujours
aux côtés de son père.
(Décembre) Sylla dictateur. Pompée en Sicile,
où il vainc et tue Papirius Carbo. |
| 81 |
— |
[Pompée a 25 ans] On lui (il se) décerne le
surnom de Magnus - «Le Grand». Il passe
en Afrique pour exterminer les derniers partisans de Marius. |
| 78 |
— |
[Pompée a 28 ans] Mort de Sylla. |
| 77 |
— |
[Pompée a 29 ans] Pompée en Espagne - proconsul
faisant fonction (non pro consule, sed pro consulibus)
car il n'avait jamais suivi les étapes du cursus
honorum - pour combattre Sertorius. |
| 71 |
— |
[Pompée a 35 ans] Sertorius mort, Pompée est
rappelé pour mettre fin à la guerre contre Spartacus. |
| 70 |
— |
[Pompée a 36 ans] Consuls : Cn. Pompeius Magnus
I & M. Licinius Crassus I. Pompée et Crassus,
dont les armées campent devant Rome, sont tous deux
élevés au consulat malgré l'opposition
du Sénat. Des rangs des optimates, ils passent
alors à ceux des populares et abolissent la
plupart des lois de Sylla. |
| 67 |
— |
[Pompée a 39 ans] Pompée reçoit un
imperium absolu pour mettre fin à la piraterie;
il y réussit en 3 mois. |
| 66 |
— |
[Pompée a 40 ans] Sur la proposition de Manilius,
il obtient ce même imperium illimité contre
Mithridate.
Après une expédition victorieuse contre ce roi,
il soumet à peu près tout le Proche-Orient (En
63, il assiège et conquiert Jérusalem).
|
| 62 |
— |
[Pompée a 44 ans] Retour à Rome, il démobilise
son armée, ce qui est conforme aux lois, mais, en agissant
ainsi il laisse échapper son plus important instrument
de puissance. Dès lors, le Sénat ose lui tenir
tête, refuse la ratification de sa politique en Orient
et s'oppose également à ce que des terres soient
données à ses vétérans, ce qui
incite Pompée à rechercher l'appui de Crassus
et de César. |
| 60 |
— |
[Pompée a 46 ans] Pompée, Crassus et César
forment le premier triumvirat - une entente secrète. |
| 59 |
— |
[Pompée a 47 ans] Le consul César approuve
la demande de Pompée, à l'insu du Sénat. |
| 58 |
— |
[Pompée a 48 ans] César proconsul d'Illyrie
et des Gaules cisalpine et transalpine. Pompée reste
à Rome. |
| 56 |
— |
[Pompée a 50 ans] Accords de Lucques. Pompée
épouse Julia, fille de Jules César (cf. téléfilm
d'Uli Edel, Jules
César, avec Jeremy Sisto). |
| 55 |
— |
[Pompée a 51 ans] Consuls : Cn. Pompeius Magnus
II & M. Licinius Crassus II. Il soutient de plus en
plus les optimates. |
| 54 |
— |
[Pompée a 52 ans] (septembre) Son épouse Julia,
fille de César, meurt en couches.
(Dans le téléfilm
d'Uli Edel, Jules
César, comme dans la série HBO, pour
des raisons dramatiques César est informé du
décès de sa fille alors qu'il vient de réduire
Alésia (automne 52), mais en réalité
elle avait rendu l'âme deux ans plus tôt, consommant
à ce moment déjà la rupture entre Pompée
et son père.) |
| 53 |
— |
[Pompée a 53 ans] Ayant décliné une
union avec Octavia,
Pompée convole pour la cinquième fois avec Cornelia
Metella, fille de Metellus
Scipion. |
| 52 |
— |
[Pompée a 54 ans] Consul : Cn. Pompeius Magnus
III. (Les optimates l'ont fait nommer consul sine collega
et il le restera pendant huit mois, puis s'associera comme
coconsul son beau-père C. Cæcilius Metellus Scipio.) |
| 51 |
— |
[Pompée a 55 ans] Pompée a obtenu l'Espagne
comme province proconsulaire, mais préfère demeurer
à Rome, la laissant gouverner par ses légats
(Varron en Hispania Ulterior, Afranius et Petreius
en Hispania Citerior). |
| 49 |
— |
[Pompée a 57 ans] (Pour la guerre civile de 49 v.
«César»). |
| 48 |
— |
[Pompée a 58 ans] (9 août [calendrier julien
: 29 juin ou 7 juin]) Bataille de Pharsale. Après la
bataille, il s'enfuit vers l'Egypte...
(28 septembre [calendrier julien : 16 août ou 25 juillet])
... où il est assassiné dès son débarquement.
(Steven Saylor, Le
jugement de César.) |
|
|
PTOLÉMÉE
XIII DIONYSIOS (Scott Chisholm)
(63-47)
Il devait avoir quinze ans lorsque Pompée, puis César
sur ses traces, débarquèrent en Egypte. Rome
(HBO) le présente comme un sale gamin caractériel,
idiot, obèse et maquillé comme un Comanche sur le
sentier de la guerre.
Son père, Ptolémée XII Aulète («le
joueur de flûte») avait connu une existence mouvementée.
Né en 110, l'Aulète était monté sur
le trône d'Egypte en 65, après l'expulsion de Ptolémée
Alexandre II qui, en mourant, avait par testament légué
l'Egypte aux Romains. |
| |
| 
Ptolémée
XIII Dionysios (ou, en français, «Denys»)
était encore un enfant lorsqu'il rencontra César,
mais savait déjà bien lever le coude, d'où
son surnom. On a rarement tracé de lui un portrait
flatteur. Steven Saylor, dans Le
jugement de César, est une agréable
exception
|
|
|
Le père, Ptolémée
XII
Rome suspecta sa légitimité, mais Aulète -
qui était un homme «généreux» -
sut s'assurer des appuis au Sénat. Sa cruauté, ses
débauches, son incurie (il laissa les Romains annexer Chypre
sans réagir) firent se révolter les Alexandrins qui
placèrent sur le trône sa fille aînée
Bérénice, laquelle régna de 58 à 55.
Pendant ce temps, Aulète vivait réfugié à
Rome, où il gagna la sympathie intéressée de
César et Pompée. Ayant déjoué la tentative
d'une ambassade alexandrine de cent notables venus exposer au Sénat
leurs raisons (il en corrompit une partie, fit égorger les
autres [2]),
et finit par se faire rétablir sur son trône par une
armée romaine conduite par Aulus Gabinius (et Marc Antoine,
préfet de cavalerie). Sitôt reprises les rênes
du pouvoir, il fit mettre à mort sa fille usurpatrice, Bérénice.
Quand il mourut en 51, il laissait quatre enfants, dont deux (Cléopâtre
VII et Ptolémée XIII) s'épouseraient et se
partageraient la couronne : |
| — |
Cléopâtre VII Philopator (68-30) (dix-huit
ans*); |
| — |
Arsinoé, sa sœur cadette et détestée; |
| — |
Ptolémée XIII Dionysios (63-47) (onze
ou dix ans*); |
| — |
Ptolémée XIV le Jeune (59-44/43) (sept ans*). |
| |
|
| |
* En 50 av. n.E. |
|
|
Le fils, Ptolémée
XIII
Cléopâtre épousa donc à dix-huit ans
son frère Ptolémée - surnommé «Dionysios»,
à cause de sa propension pour le contenu des amphores.
Agé d'une dizaine d'années, celui-ci était
totalement dominé par ses eunuques Pothin, Théodote
et Achillas. En total désaccord politique avec les objectifs
de ces derniers - qui voulaient être pharaons à la
place de la pharaonne -, Cléopâtre se réfugia
en Syrie où elle leva des troupes pour reconquérir
son trône.
César étant entre-temps débarqué à
Alexandrie, la petite futée eut l'idée de s'introduire
dans la ville et de s'adresser directement à lui : elle
avait alors vingt ans accomplis.
Ptolémée XIII, jeune général
de quinze ans, se trouvait avec son armée à Péluse,
en vue de barrer la route à sa sœur, quand, non loin
de là, aborda Pompée (28 septembre 48).
Quatre jours plus tard, César accosta à... Alexandrie
(2 octobre 48). Ce n'est donc pas lui, mais son cadet que rencontra
César ? Le Romain n'y alla pas par quatre chemins, expulsant
notamment Arsinoé de ses appartements... sur la suggestion
de Cléopâtre.
Ptolémée XIII ne noya dans le Nil pendant la «guerre
d'Alexandrie», au cours de laquelle son armée égyptienne
tenta vainement de déloger César du palais royal.
Plus tard, sur le conseil de César,
Cléopâtre épousa son second frère,
Ptolémée XIV, que le dictateur romain avait d'abord
établi «roi de Chypre». Ptolémée
XIV régna aux côtés de sa sœur de 47
à 43. Finalement, celle-ci le fit empoisonner : il n'avait
même pas quinze ans.
Steven Saylor, dans son roman Le
jugement de César, a fait une peinture de Ptolémée
XIII diamétralement opposée à celle proposée
par Rome (HBO).
Nota Bene : Selon les décomptes
des historiens modernes - certains Ptolémées ayant
été rois de Cyrénaïque ou de Chypre
- on trouvera, d'un auteur à l'autre, certaines discordances.
Ptolémée Aulète, le papa, peut selon les
auteurs être XI, XII ou XIII (!). Donc, le frère
et premier époux de Cléopâtre sera Ptolémée
XII-XIII-XIV, et son second mari et frère lui aussi,
Ptolémée XIII-XIV-XV.
|
|
SERVILIA (Lindsay
Duncan)
(née en 100 (?)-... [3])
Mère de Brutus. Ancienne maîtresse de César.
Une aristocrate républicaine à la fois sophistiquée,
élégante et subtile. Elle considère la plébéienne
Atia comme socialement inférieure, au grand dam de cette
dernière ! Lindsay Duncan (Under the Tuscan Sun, Traffik)
incarne «Servilia des Junii».
|
| |
| 
Servilia |
|
|
Fille de Q. Servilius Cæpio,
Servilia Cæpionis était la sœur - ou
plus exactement la demi-sœur - de Caton
d'Utique, l'opposant à César le plus acharné.
Malgré la haine viscérale que ce farouche républicain
nourrissait à l'égard de l'ambitieux, ou peut-être
à cause d'elle, elle aima César avec passion.
Elle avait épousé en premières noces le marianiste
M. Junius Brutus,
que Pompée - qui roulait pour Sylla - contraignit à
la reddition, puis fit assassiner (son fils Brutus nourrit longtemps
de la haine pour Pompée, avant de rallier le camp de ce
dernier).
En secondes noces, elle se maria avec le consul de 62, D. Junius
Silanus, un homme dénué d'énergie, qui
décéda peu de temps après.
Lors de la conjuration de Catilina, alors
qu'au Sénat on délibérait du châtiment
à réserver à ses complices, elle envoya un
billet doux à son amant, qui lui fut remis en pleine Curie.
Croyant que ce message contenait des révélations
sur les conjurés, Caton apostropha César l'invitant
à en faire une lecture publique. Sarcastique, César
le lui donna aussitôt. Et le grave stoïcien ne l'eut
pas plus tôt lu, qu'il le lui rendit aussitôt en maugréant,
dépité : «Tiens, ivrogne !» (4).
Cette liaison de 63 a fait croire que César
était le père de Brutus,
mais la chronologie
semble s'y opposer.
Après la saignée des guerres
puniques, les guerres civiles avaient elles aussi amplement moissonné
les grandes familles patriciennes, achevant de décimer
l'oligarchie sénatoriale. Les principaux conservateurs
opposants à César (qui, lui, était bien patricien)
appartenaient tous à la noblesse plébéienne,
voire aux «hommes nouveaux». Mieux née (5)
que son demi-frère utérin, Servilia vouait à
Caton - dont elle redoutait l'influence sur son fils Brutus -
un mépris d'aristocrate. Elle nourrissait pour son fils
Brutus une dévotion fanatique doublé de grandes
ambitions politiques.
On connaît rarement les pensées profondes, les motivations
intimes des personnages historiques, particulièrement ceux
de second ordre comme Servilia. En bonne romancière, Colleen
McCullough fait son lit dans ces zones d'ombre, imaginant un montage
patrimonial : Brutus hériterait de son oncle Caton, si
son oncle Cæpio disparaissait. C'est pourquoi Servilia fait
assassiner ce dernier, son propre frère, lors d'un voyage
en Grèce (en réalité, on sait seulement qu'il
y mourut).
De son premier mariage avec M. Junius Brutus
(mort en 77), elle eut donc ce fils nommé lui aussi M.
Junius Brutus (85-42 av. n.E.) - «notre» Brutus !
Remariée avec Decimus Junius Silanus, elle eut trois
filles : trois Junia qui épousèrent respectivement
P. Servilius Vatia Isauricus, le consul de 48 qui offrit
la dictature à César, M. Æmilius Lepidus,
le triumvir qui avait été le maître de cavalerie
du dictateur, et C.
Cassius Longinus, un de ses assassins.
On prête à César la manie de systématiquement
cocufier ses ennemis politiques, manière peut-être
d'obtenir leurs confidences sur l'oreiller... Pourtant le consul
de 62, D. Junius Silanus, le mari de Servilia, n'en était
pas un. Le coup de foudre, alors ? En tout cas son fils né
d'un premier lit (6),
M. Junius Silanus fut légat de César en Gaule :
c'est lui qui avec C. Antistius Reginus et T. Sextius, fin 54,
recrute deux nouvelles légions (XIV et XV) pour remplacer
des quinze cohortes perdues de Sabinus et Cotta.
Lors de son premier consulat (en 59), César
offrit à Servilia une perle d'une valeur de six millions
de sesterces (SUÉT., Cæs., L). Guère
regardante, Servilia profita de la débâcle de ses
amis politiques, les optimates qui avaient embrassé
le parti de Pompée. «Sous ce rapport : ramasser
le plus d'argent possible, César se montra inexorable,
ne faisant pas grâce même à ses collaborateurs
les plus proches. Antoine ne fut pas dispensé de verser
dans les caisses de l'Etat le prix de ses acquisitions, note
Gérard Walter, qui ajoute : Il est vrai que Servilia
put se faire adjuger, au plus bas prix, des immenses et magnifiques
propriétés, mais Cicéron insinue que c'était
une compensation offerte par César à sa vieille
maîtresse, qui avait entrepris de lui procurer les faveurs
de sa propre fille (7).»
Comprenne les femmes qui pourra, mais bien naïf qui s'y fie
dit la sagesse populaire. Tout semble bien fonctionner entre César
et Servilia, dont Rome (HBO) nous révèle
ici une facette inattendue.
Au moment de la bataille de Pharsale, Servilia
semble encore suffisamment en bons termes avec César -
qui l'a considérablement enrichie, nous venons de le voir
- pour avoir avec lui les échanges épistolaires.
Bien sûr, elle en profite pour plaider l'indulgence pour
son fils Brutus. Avec succès.
Mais il est vrai qu'«après
l'assassinat de César, elle reste en contact avec Brutus
et Cassius. Nous ne savons plus rien d'elle après Philippes»,
conclut Luciano Canfora (8).
A propos de Caton et Servilia
Au temps de la guerre contre les Cimbres (109-101) vivaient à
Rome Q. Servilius Cæpio et M. Livius Drusus.
Q. Servilius Cæpio était le fils du consul 106 qui,
ayant pillé l'or d'un Temple à Tolosa (Toulouse),
n'éprouva ensuite que des revers contre Cimbres et Teutons.
Aussi, au sortir de sa charge, fut-il traîné en justice
et condamné à l'exil par ses pairs du Sénat.
M. Livius Drusus était, lui, le fils du consul de 112
qui au forum avait combattu les Gracques en neutralisant leur
programme de réformes par un autre programme de réformes
approuvées - elles - par le Sénat.
Tribun de la plèbe, Drusus junior fut assassiné
en 91, après avoir proposé une nouvelle loi agraire.
Q. Servilius Cæpio avait une sœur,
Servilia Cæpionis, et M. Livius Drusus en avait également
une, nommée comme il se doit Livia Drusa. Les deux hommes
épousèrent chacun la sœur de l'autre. Petite-fille
de consuls, Servilia naquit donc des œuvres de Servilius
et Livia Drusa, laquelle Livia, devenue veuve, plus tard se remaria
avec M. Porcius Cato Salonianus (petit-fils de Caton
le Censeur), et lui donna deux enfants : un fils, Caton
le Jeune (Caton d'Utique) et une fille, Porcia.
Servilia et Caton étaient donc frère et sœur
utérins.
Par parenthèses, Caton le Jeune eut lui aussi une fille
nommée, cela va sans dire, Porcia (ou Portia), qui épousa
son cousin Brutus, le fils «tyrannicide» de Servilia.
Apprenant la mort de son mari à Philippes, Porcia se suicida
- dit-on - en avalant... des charbons ardents.
|
| |
| 
Rome
(HBO) rajoute quelques épices au ragoût en
imaginant une idylle lesbienne entre Servilia (à
gauche) et Octavia (à droite)
|
|
|
| La Servilia de Rome
La minisérie Rome (HBO) fait d'elle un de ses
ressorts dramatiques majeurs. C'est la femme amoureuse, la maîtresse
vieillissante (9),
blessée dans son amour propre, ses sentiments, sa chair
qui se fane... Et peut-être aussi dans ses convictions politiques
encore qu'à notre avis, ses convictions elle les avait
surtout entre ses jambes, comme la môme Piaf de l'Hymne
à l'Amour («Je renierais ma Patrie, je renierais
mes amis... si tu me le demandais !»). La Servilia historique
ne semble pas avoir joué le rôle politique que lui
attribue la minisérie HBO, ce qui devait la mettre peu
ou prou à l'abri des médisances et des calomnies.
Sans doute cette matrone aussi effacée que peu farouche
aurait-elle pu accorder ses faveurs à la moitié
du Sénat sans que quiconque y eut trouvé à
redire (sauf son mari, ça va de soi). Tandis qu'il suffisait
à Clodia [le modèle de son ennemie Atia, dans la
minisérie HBO] de jeter un regard complice à son
frère qui, lui, avait beaucoup d'ennemis, pour que jaillisse
l'injurieuse insinuation d'entretenir avec sa sœur des relations
incestueuses.
Un personnage comme Servilia dont, finalement, on sait si peu
de choses, est évidemment une réelle bénédiction
pour des scénaristes. Servilia est le parfait contrepoids
d'Atia, égocentrique et méchante.
|
| |
| 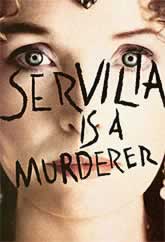
«Servilia est une meurtrière» |
|
|
Servilia est pathétique.
Au cours d'un impressionnant rituel de defixio (CLICK
& CLICK) elle
recourt d'abord à la magie noire pour détruire et
son amant infidèle, et sa maudite armée conquérante.
Ensuite, elle offre son corps à la malheureuse Octavie
pour mieux la manipuler, puis elle la pousse à une relation
incestueuse avec son propre frère. Finalement, elle rassemble
autour d'elle les derniers survivants du clan de Pompée
et de Caton, et organise le complot visant à assassiner
César. Et elle met la pression sur son fils Brutus - qui
est tout, sauf un politique fanatique - qu'elle réussira
à compromettre grâce à toute une campagne
médiatique (graffiti, libelles circulant sous le manteau...).
C'est une femme amoureuse, et qui se venge. Quelque part, il y
a en elle de l'héroïne de tragédie qui peut
rivaliser avec les héroïnes germaniques des Nibelungen,
comme Brünnhilde
laquelle après avoir fait périr l'homme qu'elle
aime - Siegfried
-, se précipite dans son bûcher.
Dans ses Maîtres de Rome, la
romancière Colleen McCullough a fait de Servilia le type
de l'aristocrate romaine dure et intelligente, maîtresse
de sa vie et de son corps. «Elle a porté un jugement
parfaitement exact sur les rumeurs propagées par Bibulus»,
dit César. «(...) De toutes les femmes que je connais
[c'est] celle qui [a] la plus forte tête politique»,
et d'ajouter quelques lignes plus loin, par l'organe d'Aurelia,
mère de César : «Ne te laisse pas emporter
par tes sentiments. Il n'y a rien de commun entre Servilia et
feu ton épouse [Cinnilla], qui était la femme la
plus douce du monde. Ce qui n'est pas le cas de Servilia, qui
est aussi froide et dure que du marbre.» Servilia rabroue
son demi-frère Caton
le Jeune, dont le père avait dans les veines quelques
gouttes de sang d'une esclave affranchie, et dont elle redoute
l'influence sur son fils Brutus : «Va-t'en Caton. (...)
Nous n'avons pas le même père - ce dont je remercie
les dieux ! - mais nous avons au moins la même obstination.
Et je suis plus intelligente que toi, ajouta-t-elle en ronronnant.
En fait, je le suis plus que n'importe lequel de mes demi-frères.»
Petite et brune, le cheveux lisse, physiquement - dans le roman
de McCullough - elle ne ressemble pas vraiment à la châtain
et bouclée Lindsay Duncan de la minisérie HBO; pourtant
on a un peu l'impression que les pages de la romancière
néo-zélandaise ont dû arriver sous les yeux
du scénariste HBO, car à défaut de chercher
la perte de César par tous les moyens magiques ou politiques,
elle est capable de la plus grande cruauté : «Elle
est dure avec ses esclaves. (...) Elle ne dédaigne pas
les crucifier quand elle pense qu'ils ont besoin d'une bonne leçon.
Dans le jardin, sous les yeux de tous. Enfin, elle les fait fouetter
avant, ce qu'il fait qu'ils ne tiennent pas trop longtemps (10).»
Et d'insister : «Une femme complexe, dissimulée,
un empilement de fer, de marbre, de basalte, d'adamas. Guère
sympathique, ni très féminine, en dépit de
son opulente poitrine. Il pourrait s'avérer désastreux
de lui tourner le dos, car elle lui semblait avoir deux visages,
comme Janus : un pour voir où elle allait, l'autre pour
découvrir qui la suivait. Un monstre parfait» (11).
En ce qui concerne Brutus, la chronologie
admise semblant s'opposer à la paternité de César,
la romancière Colleen McCullough s'en tire par une pirouette
: Brutus (17 ans) aurait été fiancé à
Julia (8 ans), qui plus tard épousera Pompée. En
outre, César - amant de Servilia - aurait été
le père de la troisième fille qu'elle donna à
son second mari Silanus. Ce qui justifierait le sentiment «paternel»
que nourrit César vis-à-vis de son futur gendre,
par ailleurs orphelin de père. Astucieux. Astucieux, mais
peu probable si l'on ajoute foi au ragot colporté par Suétone
(SUÉT., Cæs., L) selon lequel Servilia, en
digne mère-maquerelle aurait poussé dans le lit
de César sa fille Tertia, ce qui aurait constitué
- dans le raisonnement de McCullough - un inceste délibéré.
Mais ici, nous entrons dans la logique de Rome (HBO) qui
en remet une couche en montrant Servilia poussant Octavie dans
les bras de son frère Octave, afin d'obtenir certaines
confidences. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, non ?
En ce qui concerne la minisérie HBO,
où Servilia semble affranchie de toute puissance maritale,
il est impossible de déterminer si elle avait encore un
mari dans sa vie en 52 ou en 45-44... |
| Suite… |
NOTES :
(1) J. H. CROON, Encyclopédie
de l'Antiquité classique, Sequoia, 1962, s.v. «Pompée».
- Retour texte
(2) Cet épisode a inspiré
Steven SAYLOR, Un
Egyptien dans la ville. - Retour texte
(3) On n'entend plus parler d'elle après
-42. - Retour texte
(4) Bel exemple d'invective politique,
car César était justement connu pour sa sobriété.
Mais le principe même de l'injure n'est-il pas - précisément
- de gratifier autrui de compliments aussi choisis qu'immérités
(inverti, cocu, ivrogne, adultère, incestueux...) ? - Retour
texte
(5) Deux familles romaines portèrent
le nom de gens Servilia; l'une était patricienne
et l'autre plébéienne. Les Priscus et les
Cæpio étaient les principales branches de
la patricienne (quelques-uns d'entre eux portèrent le surnom
d'Ahala ou d'Axilla). Toutefois, de par son mariage
avec un Junius Brutus plébéien, Servilia était
devenue elle-même plébéienne. Pour autant,
en perdit-elle sa morgue aristocratique ?
Les branches des Servilii plébéiens se nommaient
Casca, Rullus et Vatia. - Retour
texte
(6) Napoléon le dit fils de Servilia
et frère utérin de Brutus (NAPOLÉON III,
La Guerre des Gaules de César, rééd.
Errance, p. 281). Mais Servilia a épousé Silanus
entre 77 et 63; donc le légat de César aurait eu,
fin 54, entre 17 et 22 ans. Un peu jeune, tout de même,
pour être légat. Nous pensons donc que M. Silanus
est, forcément, né d'un lit antérieur, et
Brutus seulement son beau-frère. - Retour
texte
(7) G. WALTER, César,
Marabout Université, n 49, 1964, p. 364. - Retour
texte
(8) L. CANFORA, César, le
dictateur démocrate (1998), Flammarion, coll. «Grandes
Biographies», 2001, p. 446. - Retour
texte
(9) Elle a le même âge que
César, étant née la même année
(?). - Retour texte
(10) Dans le précédent
tome, elle est jalouse du trop grand attachement que la nourrice
gauloise voue à son fils, Brutus. Alors Servilia se saisit
de la première peccadille (l'esclave a par mégarde
laissé tomber le bébé - pour la faire mettre
à mort dans les cruels tourments ci-dessus décrits.
- Retour texte
(11) C. McCULLOUGH, Jules
César, la Violence et la Passion, «Les Maîtres
de Rome»/5, pp. 29, 30, 35, 40, 53. - Retour
texte
|
| |
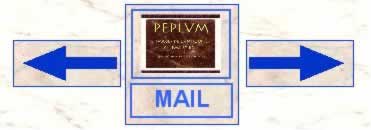 |
|