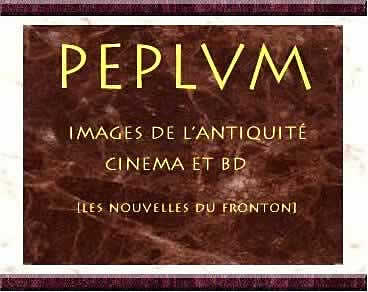
|
| |
| |
Die Hermannsschlacht
(La bataille d'Arminius)
[Ch. DECKERT, H. KIESEL, Ch. KÖSTER,
St. MISCHER, C. VÖLKER - AL, 1993/95]
Page 1/8
|
|
|
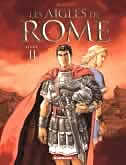
Arminius en BD. Gagnez un album
des Aigles de
Rome (Enrico Marini) en participant au concours. |
|
|
|
Die Hermannsschlacht
(La bataille d'Arminius)
[Ch. DECKERT, H. KIESEL, Ch. KÖSTER,
St. MISCHER, C. VÖLKER - AL, 1993/95]
|
| |
|
| |
I. L'Aventure est dans
la Forêt...
DIE HERMANNSSCHLACHT (1993-1994)
Die
Hermannsschlacht est un film inclassable. On
pourrait parler d'art minimaliste, si dans le générique
de fin - clin d'œil aux superproductions - la liste des
acteurs récurrents et des figurants occasionnels ne
durait pas dix minutes... Film expérimental, film d'art
et essai ou farce d'étudiants ? Mais film poétique
aussi, puisque centré sur la vision comparée
de deux grands poètes allemands du XIXe s., Kleist
(Penthésilée, 1808; La Marquise d'O,
1810) et Grabbe
(Napoléon ou les Cent-Jours, 1831; Hannibal,
1835).
Complètement décalé, le film rappelle un
peu Astérix, dont on sait le succès outre-Rhin.
Il se veut aussi être un hommage aux «péplums»
italiens des années soixante. Du reste l'un d'eux, Il
Massacro della Foresta Nera / Hermann der Cherusker (Die Schlacht
im Teutoburger Wald) (Ferdy Baldwyn [= Ferdinando Baldi],
1967), coproduit avec l'Allemagne, avait déjà traité
du même sujet : la victoire du Germain Arminius sur les
trois légions du propréteur romain P. Quintilius
Varus, point nodal de l'Histoire comme l'a définit J.F.C.
Fuller (1),
mais qu'Heiner Müller considérait à tort comme
«un incident sans conséquence aux frontières
de l'Empire romain [que Kleist prit] comme mythe national»
(2).
Après ce désastre militaire, les Romains renonceront
définitivement à reporter sur l'Elbe la frontière
de leur empire, qui demeurera sur le Rhin. Il s'agissait surtout
pour les concepteurs du film - Christian Deckert, Hartmut Kiesel,
Christoph Köster, Stefan Mischer et Cornelius Völker
- de confronter deux chefs-d'œuvre de la littérature
allemande du XIXe s., celui d'Heinrich
von Kleist (18 octobre 1777-21 novembre 1811) et celui de
Christian Dietrich
Grabbe (né et décédé à
Detmold (3)
précisément, 1801-1836).
|
| |
| |
| |
La bataille d'Hermann (1993/95)
brosse en larges traits le conflit entre les conquérants
romains et les tribus germaniques, et la confrontation finale
entre Varus et Arminius (Hermann), le premier héros de
l'Histoire allemande. Jouant sur les anachronismes, la mise en
scène du film fut pour ses auteurs «une grande expérimentation»,
qui nécessita la création de costumes utilisant
des fourrures et des grosses toiles tant bien que mal ficelées.
Les soldats se battent avec des épées-jouets en
plastique et des boucliers de contre-plaqué. Les légionnaires
romains portent des armures en carton ondulé et sont coiffés
de casques de papier d'aluminium; survient alors un car de touristes
contemporains qui débarquent sur le champ de bataille.
L'un d'eux interroge Varus pour savoir si c'est bien ici qu'a
eu lieu la bataille. D'un air dégoûté, le
général romain lui montre du doigt l'Hermannsdenkmal
qui surplombe la forêt, référence indiscutable
! Tous détails bizarres qui donnent au film un caractère
satirique. Ben Hur de Prisunic assurément, La
bataille d'Hermann donne à voir des images jamais vues
dans une production hollywoodienne. La caméra nous convie
également à assister à une discussion imaginaire
entre deux poètes classiques allemands, Heinrich von Kleist
et Christian Dietrich Grabbe lesquels ont tous deux écrit
pour le théâtre une Hermannschlacht, respectivement
en 1809 et 1836.
Kleist en tira un grand drame héroïque et, surtout,
patriotique, destiné à soulever l'Allemagne contre
Napoléon où Arminius-Hermann apparaissait comme
le Vercingétorix
allemand (4).
|
| |
|
|
|
1. Arminius dans la littérature allemande,
avant Kleist
1.1. Liberté religieuse
A vrai dire, Kleist n'a pas lui-même exhumé Arminius
des pages de Tacite. Avant lui, plusieurs érudits poètes
allemands lui avaient déjà consacré leur
attention. Le premier semble avoir été l'humaniste
Ulrich von Hutten (1488-1523), dans un dialogue en latin
(Arminius, 1523 [5]).
Ami d'Erasme, von Hutten avait soutenu Reuchlin dans la polémique
qui l'opposait aux Dominicains. Dans Arminius, imitant
la forme dialoguée des écrits théoriques
et polémiques des humanistes italiens, Hutten exalte en
son héros «le plus libre, le plus invincible,
le plus allemand des hommes», pour soulever la conscience
nationale germanique contre la suprématie de Rome. «Le
vainqueur de Teuteberg est représenté comme le premier
héros germanique qui ait vaincu l'armée impériale
et secoué la tyrannie romaine, note le Laffont-Bompiani
(6).
Naturellement, l'auteur, paladin et héraut de la Réforme,
utilise cette victoire pour des fins politico-religieuses, comptant
qu'une réaction du sentiment national succéderait
à la révolte de Luther contre l'Eglise romaine.»
1.2. Le Siècle des Lumières
et des Encyclopédistes
Créateur, avec son rival Gryphus, de la tragédie
de l'époque baroque, Daniel Kaspar von Lohenstein
(1635-1683) écrivit un roman demeuré inachevé,
intitulé Arminius und Thusnelda, ou plus exactement
Le magnanime chevalier Arminius ou Hermann, ou Le courageux
défenseur de la liberté allemande, et, à
ses côtés, sa Sérénissime Thusnelda,
dans une symbolique histoire d'amour et d'héroïsme,
exposée en deux parties et ornée de belles gravures,
pour la gloire de la patrie, de la noblesse allemande et de sa
glorieuse descendance, publié en 1690, après
sa mort. En trois mille pages grand format, l'auteur y «accumule,
en vrac, tout ce qu'il est possible d'introduire d'aventures chevaleresques,
d'héroïsmes classiques, de découvertes géographiques,
de notions de médecine, de morale, de politique, d'histoire,
de mythologie, d'allégories, résume le Laffont-Bompiani.
La figure d'Arminius, héros de la fameuse bataille qui
endigua l'avance des Romains, symbolise l'empereur Léopold.
L'auteur a voulu faire non seulement un roman d'amour, mais une
histoire générale de l'Allemagne, et aussi et surtout,
selon le précepte d'Opitz, une œuvre utile, tout au
moins pour le goût de son temps, qui éduquât
politiquement la nation allemande et affirmât ses droits
face aux prétentions de la France de Louis XIV. Lohenstein
voulait créer une œuvre aussi vaste que possible.
Dans ce dessein, il rassembla de longues expositions historiques
(toutes les vicissitudes des Habsbourg et les dernières
guerres de religion), des événements datant du temps
des Romains, des faits concernant l'Arménie et la Thrace,
reliant ensemble tous ces matériaux en une sorte d'encyclopédie
qui, dans son intention, devait être l'histoire primordiale
et générale du peuple germanique. Ce dont Lohenstein
a véritablement horreur, c'est de la simplicité,
et son roman correspondait si bien avec le mauvais goût
de l'époque qu'il fut non seulement admiré par ses
contemporains, mais pris comme modèle.»
1.3. Mélodrames
patriotiques
Au siècle suivant, le sujet fut repris dans le drame Arminius
[Hermann] du poète et essayiste shakespearien Johann
Elias Schlegel (1718-1749), paru en 1743. «Le principal
centre d'intérêt n'est pas constitué par la
personne d'Arminius, mais par celle de Thusnelda, qui est aimée
secrètement par Flavius (7),
frère d'Arminius. A cause de son amour inavouable et de
sa faiblesse, Flavius fait figure de traître, tandis que
Thusnelda qui garde sa fidélité à Arminius,
incarne la liberté de la patrie. C'est de ce drame que
s'inspira Klopstock - plutôt que du médiocre petit
poème Arminius [Hermann] (1751) de Christoph
Martin Wieland (1733-1813) - quand il voulut composer sa
célèbre trilogie.»
1.4. La quête des origines...
Ensuite, le dramaturge Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803),
le «poète de la religion et de la patrie»,
consacra au prince chérusque une trilogie significative,
La bataille d'Arminius (1769), Arminius et les Princes
(1784) et La mort d'Arminius (1787), appelés «bardits»
par l'auteur. «Ils traduisent la naissance, dans l'âme
de Klopstock, de ce sentiment patriotique qu'il ressentit à
la lecture des Eddas et d'Ossian, en 1764 et 1765
- deux grands événements dans le monde littéraire
nordique. La découverte de la poésie germanique
autochtone et de la poésie ossianique, exalta le poète
qui crut, comme beaucoup d'hommes de son temps, à l'existence
des «bardes» à l'époque d'Arminius.
Il voulut ainsi remonter à ces temps archaïques en
créant une série de drames et de poésies
(Hermann, 1767), dans une atmosphère purement germanique.
La tentative était hardie, mais elle devait aboutir à
un échec.
Le premier drame, La bataille d'Arminius [Hermannsschlacht],
fut écrit en 1769. L'intrigue est renouvelée
de celle de l'Arminius de Schlegel avec quelques légères
différences : le lieu de l'action n'est plus la forêt
de Teutberg, mais une gorge du Harz (8);
Flavius, le frère d'Arminius, est le traître, tandis
que Siegmond, fils de Ségeste, est le héros qui
aide Arminius à vaincre les Romains; Thusnelda est déjà
l'épouse d'Arminius. L'action humaine se déroule
sur un fond de paganisme où, en même temps que Wotan,
on trouve également les dieux grecs. Les chants des bardes
qui accompagnent l'action sont suggestifs, mais sans spontanéité
aucune. Le nouveau barde Klopstock ne pouvait effacer quinze siècles
de latinité avec ce drame impossible à représenter,
que Schiller a traité de «froid, insipide, grotesque,
sans vie et sans vérité». Cependant, cette
tentative, si on laisse de côté les parties lyriques
qui constituent le meilleur de l'œuvre, eut le mérite
de donner naissance à toute une série d'études
sur l'antique littérature populaire germanique»
(9).
Poète épique chrétien (la Messiade,
1748-1777) dont l'exaltation lyrique et le mysticisme était
en phase avec la ferveur piétiste de son temps, Klopstock
«sut cependant rester cosmopolite et, comme tant d'écrivains
et philosophes allemands, salua la Révolution française
et devint citoyen d'honneur de la République (1792), mais
condamna les excès de la Terreur», précise
le Petit Robert.
«Le second drame, Arminius et les Princes [Hermann
und die Fürsten], composé en 1784, est peut-être
le moins important de la trilogie. Alors qu'Arminius voudrait
attendre un moment plus propice pour attaquer les Romains, les
princes teutons, jaloux de lui, le contraignent à livrer
bataille immédiatement. Arminius est vaincu par les Romains
et son propre fils, Theude, échappe à l'emprisonnement
auquel ne peut se soustraire le chef de Druides, Brenn. L'action
s'accompagne de nombreux chœurs de bardes, de spectres, d'ombres
et de personnages symboliques.
Dans le troisième drame : La mort d'Arminius [Hermanns
Tod], composé en 1787, Arminius, trahi par les princes
germaniques, jaloux de sa puissance, est vaincu. Lorsque Thusnelda
revient de la prison romaine et apprend cette nouvelle, elle s'incline
avec résignation devant le destin; son fils Theude est
tué, et à l'annonce de la mort d'Arminius, Thusnelda
meurt à son tour. Toute la tragédie est dominée
par le fatalisme germanique et s'accompagne de la représentation
d'un Walhalla influencé par le paganisme nordique»
(10). |
|
|
2. Heinrich von Kleist (1777-1811)
Au XIXe s., le réveil de la conscience nationale suscité
par la Révolution française, le Romantisme et les
guerres napoléoniennes inspirent des œuvres nouvelles.
La première est La bataille d'Arminius (Die Hermannsschlacht)
d'Heinrich
von Kleist au patriotisme rebelle (1809). Sa trame suit approximativement
celle de Klopstock, «toutefois l'auteur abandonne certains
thèmes dramatiques (comme le conflit entre Arminius et
Marbod), et alourdit son œuvre d'un certain nombre d'anachronismes
: enfin de fréquentes naïvetés s'y font jour
: c'est ainsi qu'Arminius et Thusnelda témoignent d'un
romantisme exagérément sentimental (ils se donnent
entre eux des diminutifs petits-bourgeois comme «Thusneldina»
ou «mon petit cœur», etc.)» (11).
|
| |
|
| |
| Issu d'une famille de l'aristocratie
militaire prussienne, H. von Kleist a déjà pas mal
roulé sa bosse, notamment en France et en Suisse, lorsqu'il
entreprend la rédaction de La bataille d'Arminius.
C'est qu'à l'âge de quinze ans, il a participé
au siège de Mayence et, en 1803, a même envisagé
de s'enrôler dans la Grande Armée pour participer
à l'invasion de l'Angleterre. Mais les Français
refusent d'incorporer cet individu agité, admirateur enthousiaste
de Rousseau et de Kant, mais que guette le déséquilibre
mental. De retour chez lui, il réussit en 1805 à
intégrer l'administration prussienne comme surnuméraire
et écrit pour le théâtre (La cruche cassée,
1802; Amphitryon, 1807; La marquise d'O, 1810),
ainsi qu'un roman (Michael Kohlaas, 1805). C'est alors
que Napoléon écrase les Prussiens à Iéna
(octobre 1806). En janvier 1807, il est arrêté par
les autorités françaises qui le soupçonnent
d'espionnage; il n'est libéré qu'en juillet, après
la signature du traité de Tilsit.
L'année 1808 le voit attaquer la rédaction de La
bataille d'Arminius qui lui prendra deux années. Deux
années pendant lesquelles on commence à parler des
premiers succès de la guérilla espagnole contre
les troupes napoléoniennes, tandis qu'en Prusse le baron
vom Stein, premier ministre, mène un double jeu. Un courrier
saisi par les autorités françaises (août 1808)
et rendu public (septembre 1808), révèle que vom
Stein intriguait pour conclure avec l'Autriche une alliance secrète,
tandis que lui-même signait avec l'occupant un traité
de pure forme au nom de la Prusse. En sous-main, dans l'attente
d'une occasion favorable pour prendre à revers les troupes
françaises, il organiserait des groupes susceptibles de
mener l'insurrection.
Or cette stratégie est exactement celle prônée
par Arminius (12).
«L'analogie historique est limpide, note J. Jourdeuil.
Les Français napoléoniens sont représentés
par les Romains de Varus, et les Allemands, dans leur diversité
(Prussiens, Autrichiens, Bavarois, Rhénans) le sont par
Marbod, Hermann et les princes. Mais l'analogie s'arrête
là : impossible d'affirmer qu'Arminius-Hermann ce serait
la Prusse et Marbod l'Autriche ou l'inverse. La pièce de
Kleist échappe à la géopolitique des années
1806-1812, tout comme elle échappe à l'historique
authentique de la bataille de Teutoburg en IX après J.-C.
La poésie prend le relais, ou plus exactement, elle prend
son envol à partir de ce double tremplin historique : les
Romains et les Germains au temps d'Auguste, les Français
et les Allemands au temps de Napoléon» (13).
Si Kleist partage l'aspiration nationale de ses contemporains,
il se démarque dans le même temps des naïvetés
d'un nationalisme élémentaire; ses héros
problématiques, Hermann ou Thusnelda - tout comme Hombourg
ou Penthésilée - sont et ne sont pas héroïques;
ils font bien plus penser à ceux de Dostoïevski.
Dans son édition de la pièce, le metteur en scène
français Jean Jourdheuil atténue le caractère
anti-napoléonien (n'oublions pas qu'après La
bataille d'Arminius, Kleist enchaîna avec le violent
pamphlet anti-français Le catéchisme des Allemands)
: selon lui, Kleist «pense en poète (...)
[et] s'inscrit en faux contre les naïvetés d'un
nationalisme élémentaire» (14).
Il compose des œuvres «qui font l'anatomie du nationalisme
allemand, qui le radiographient à sa naissance. Il nous
montre sa naissance sous de funestes auspices et sa figure grimaçante.
Le happy end de La Bataille d'Arminius n'est pas
gai» (15). L'Arminius
kleistien s'oppose au limpide héros schillérien
- type Guillaume Tell - qui combat pour le triomphe de la liberté.
Au contraire de Schiller, Kleist n'est pas «enclin à
embellir les héros et à les «moraliser».
Arminius-Hermann est certes un libérateur de l'Allemagne,
mais c'est un personnage extrêmement problématique,
où éléments positifs et négatifs sont
intimement mêlés. (...) chez Hermann coexistent des
aspects lumineux et noirs, il est à la fois un héros
et un menteur, un génie et un traître» (16).
Le portrait que Kleist dresse d'Arminius est celui d'un terroriste
implacable, d'un manipulateur sans scrupules, obsédé
«à la fois par sa lutte tortueuse contre les Romains,
dont il a lui-même tramé le plan, et par la question
de la fidélité de sa femme» (17)
dont il se sert pour tromper l'ambassadeur romain Ventidius Carbo.
Pour le chef germain, les «gentils» romains - car
il y en a - sont pires encore que les «méchants»,
car ils détournent les patriotes du droit chemin. Quand
aux «méchants» romains, il désespère
qu'ils ne commettent davantage de crimes, afin de davantage soulever
contre eux la population. Arminius pardonnait aux frères
allemands, Wolf prince des Cattes, Thuiskomar prince des Sicambres,
Dagobert prince des Marses, Selgar prince des Bructères,
et même aux ex-alliés des Romains comme Fust prince
des Cimbres et Gueltar prince des Nerviens, qui ont rallié
son camp et en dépit du fait qu'autrefois fervents collaborateurs
des Romains ceux-ci avaient, dans leurs exactions, souvent été
pires que l'envahisseur latin. L'heure était au pardon.
Etonnants cette lucidité et ce pessimisme, ce pragmatisme
dans une pièce de théâtre écrite en
1808-1809, une époque où l'on aime idéaliser
les héros. En revanche, il condamne à mort le chef
des Ubiens, Aristan. Le seul qui n'ait pas trahi ses amis romains.
Mais pourquoi Aristan se serait-il rallié à la cause
d'une Germanie qui n'avait jamais existé et qu'Arminius
venait d'inventer ex nihilo ? Comme roi des Ubiens et,
donc, chef d'un Etat souverain, Aristan négocie avec qui
il lui plaît. Dans son fantasme, Arminius est imperméable
à cette logique. Dans l'ordre nouveau qu'a instauré
le nouveau chef des Germains, son individualisme coûtera
sa tête à Aristan...
Amateur d'images fortes et sanglantes, Kleist fera passer Thusnelda
du statut de coquette flattée par un soupirant romain,
l'ambassadeur Ventidius Carbo, à celui d'horrible mégère
lorsqu'elle se découvrira trahie (18)
: elle livrera le galant romain aux griffes d'une féroce
ourse noire qui le mettra en pièces (acte V, sc. 18). Et
lorsque le forgeron Teuthold, tuera sa fille unique, Hally, apprenant
qu'elle a été violée par des légionnaires
romains, Arminius lui commandera d'en dépecer le cadavre
en quinze morceaux (19)
qu'il fait porter aux quinze tribus germaniques qu'il entend rallier
à sa cause (acte IV, sc. 6). |
|
3. Christian Dietrich Grabbe (1801-1836)
|
Natif de Detmold où
plus tard sera érigé l'Hermannsdenkmal,
Christian
Dietrich Grabbe est, avec Georg Büchner,
l'auteur dramatique allemand le plus important de
la période antérieure à la révolution
de 1848. Fils d'un gardien de prison, il restera profondément
marqué par le contexte carcéral où
avait baigné son enfance. Die Hermannsschlacht
fut sa dernière œuvre. Il mourut avant
de pouvoir la publier, la laissant du reste inachevée.
Divorcé d'avec Louise Clostermeier (1832),
Grabbe vécut ses dernières années
solitaire et ravagé par la syphilis. «A
moins que ce ne soit l'alcoolisme qui raccourcit son
existence, ce que l'on peut voir dans le film»,
précise le réalisateur Stefan Mischer.
Dans une de ses comédies, Raillerie, satire,
ironie et signification cachée, l'auteur
caustique n'hésitait pas à se mettre
lui-même en scène avec un rare sens de
l'auto-dérision : «C'est le Grabbe
maudit, comme on devrait l'appeler en réalité,
le crabe nain, l'auteur de la pièce ! Il est
bête comme un pied et fustige tous les écrivains
alors qu'il n'est lui-même bon à rien.
Il a les jambes arquées, les yeux qui louchent
et un visage simiesque totalement inexpressif !»
Représentée en 1838, deux ans après
sa mort, La Bataille d'Arminius «se ressent
du nouveau climat intellectuel qui caractérise
l'Allemagne de son temps : elle met en scène
un Arminius qui fait la guerre contre les Romains
avec des déguisements et des ruses, et une
Thusnelda qui, dans ses attitudes héroïques,
a l'air d'une rude campagnarde. On y représente
la bataille dans la forêt de Teutberg; l'épilogue
se passe à Rome, au lit de mort d'Auguste,
lequel proclame la divinité de Jésus-Christ»
(Laffont-Bompiani). |
| |
|
| 
Christian Dietrich Grabbe
(Source : Encarta) |
|
|
Grabbe fait annoncer par Auguste
la venue de temps nouveaux, la venue de Jésus-Christ. Le
film de 1995 emprunte sa chute à Grabbe, auteur qui a la
nette préférence de ce groupe de jeunes cinéastes,
plutôt que Kleist. Virgile avait annoncé un Age d'Or
romain autour de la figure charismatique de l'Empereur Auguste
qui avait mis fin aux guerres civiles - on a même parlé
de «messianisme augustéen». Le siècle
d'Auguste, inaugurant la Pax Romana. Aussi le brutal Tibère
suggérera vainement à l'empereur d'informer Ponce
Pilate (20)
de ce que, dans sa province, est né un Messie qu'il lui
faut immédiatement faire mettre à mort. Mais Auguste
ne supporte pas cette idée cruelle. L'Empereur romain est
convaincu qu'un martyr est plus dangereux pour Rome qu'un Messie
vivant.
Comme le drame de Grabbe, le film de 1995 s'achèvera donc
sur la merveilleuse vision de la Vierge à l'Enfant : une
ère nouvelle s'annonce pour le peuple allemand libéré
et élu de Dieu...
«Divers exégètes (21)
ont montré que Grabbe souhaitait souligner l'importance
mondiale des ces deux événements historiques. Mais
aussi que, bien loin de glorifier le vainqueur des Romains, Grabbe
concluait que Jésus était plus important pour notre
histoire qu'Arminus, explique Stefan Mischer, un des réalisateurs,
également interprète du rôle-titre. Comme
Hegel, Grabbe s'intéresse plutôt au rôle du
héros et à son importance pour l'histoire mondiale.»
Les héros, écrit Hegel, «n'ont pas puisé
leurs fins et leur vocation dans le cours des choses consacré
par le système paisible et ordonné du régime.
Leur justification n'est pas dans l'ordre existant, mais ils la
tirent d'une autre source. C'est l'Esprit caché, encore
souterrain, qui n'est pas encore parvenu à une existence
actuelle, mais qui frappe contre le monde actuel parce qu'il le
tient par une écorce qui ne convient pas au noyau qu'elle
porte» (22).
|
| |
|
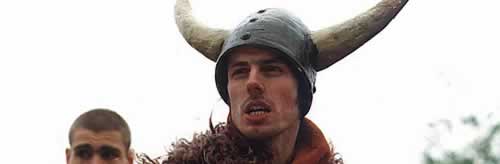
Le coréalisateur de Die Hermannsschlacht,
Stefan Mischer, également interprète d'un
Arminius déjanté !
(© Schlossfilm DVD Verleih)
|
|
| |
L'Hermannsschlacht de Grabbe
est un hymne plein de visions merveilleuses sur la patrie du poète.
«Le thème patriotique cède le pas à
une poésie philosophique ambitieuse et grandiose, qui prétend
interpréter les événements de l'histoire,
précisera encore le Laffont-Bompiani. Mais le résultat
est confus et chaotique.» Pour le coréalisateur
du film de 1995, Stefan Mischer (23),
«Grabbe est moins nationaliste [que Kleist]. Il
s'intéresse plutôt à la psychologie d'Arminius.
Le rôle de Marbod, qui a soutenu Arminius durant la bataille,
et l'alliance des peuples germaniques ne l'intéressent
guère. Sa pièce de théâtre est plus
subtile et pleine d'ironie.» Selon Werner Broer (24),
Grabbe n'idéalisait pas les tribus germaniques. Il s'intéressait
plutôt aux défis auxquels devait répondre
Arminius, qui éprouvait des problèmes avec la mobilisation
des guerriers. Après la bataille dans la Forêt de
Teutberg, les combattants ne voulurent point suivre Arminius jusqu'aux
bords du Rhin pour en finir une fois pour toutes avec les Romains.
Dans sa version dramatique, après le suicide de Varus,
le héros proposait d'attaquer les fortifications qui se
dressaient là-bas, et qui demeuraient une menace pour la
Germanie. Toutefois ses guerriers ne souhaitaient que fêter
leur victoire chez Thusnelda, qui invitait tout le monde à
de grandes festivités.
Une grande qualité de Grabbe réside dans son empathie
pour la sensibilité populaire.
«Ce qui fascine également les cinéastes,
dit encore Stefan Mischer, c'est que des décennies avant
Cabiria et le premier Ben Hur, Grabbe expérimente
la mobilisation d'un grand nombre de figurants dans son spectacle.
Et il change de scènes très souvent, comme dans
un découpage de film. Sa scénographie est extravagante.
C'est sans doute la raison pour laquelle son drame n'est guère
représenté au théâtre.»
Malgré ses échecs à la scène, Grabbe
et sa conception du théâtre ont sans conteste influencé
les écoles naturaliste et expressionniste (25).
|
| |
|
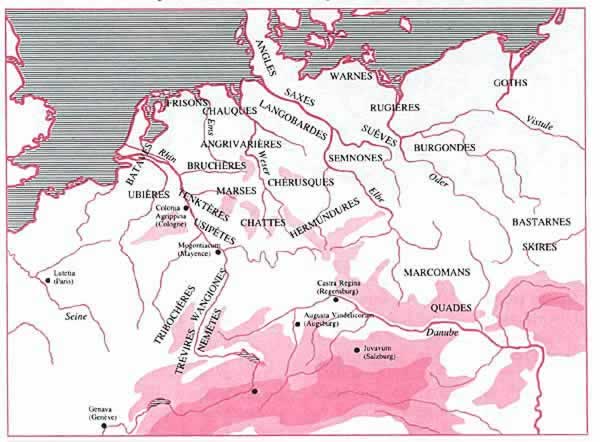
Les principales tribus germaniques au Ier
s. de n.E.
|
|
| |
| Suite… |
NOTES :
(1) J.F.C. FULLER, Les batailles
décisives du monde occidental (1958) (présent.
Gérard Chaliand), Berger-Levrault, coll. «Stratégies»,
1980, 3 vols, t. I, pp. 119-131. - Retour
texte
(2) H. MÜLLER, discours prononcé
lors de la réception du prix Kleist en novembre 1990,
in H. von KLEIST, La bataille d'Arminius, Paris, Editions
Théatrales Nanterre Amandiers, 1995, p. 135. - Retour
texte
(3) Au XIXe s., Detmold était
considérée comme le lieu de la défaite
du propréteur Varus. De 1838 à 1875 on y érigea
un monument commémoratif grandiose, l'Hermannssdenkmal.
- Retour texte
(4) Avec un demi-siècle d'avance
sur Napoléon III. Pour une comparaison entre l'attitude
respective des statue commémoratives de Vercingétorix
et d'Arminius, voyez le site France-Allemagne : mémoires
partagées. - Retour texte
(5) Trad. fr. Liseux, 1877. - Retour
texte
(6) LAFFONT-BOMPIANI, Dictionnaires
des œuvres, Robert Laffont, 1954, rééd.
1981. - Retour texte
(7) Ce Flavius, ou plutôt Flavus
«le Blond», qui restera fidèle aux Romains,
est mentionné par Tacite. - Retour
texte
(8) Le Harz est un massif montagneux
entre l'Elbe et la Weser. - Retour texte
(9) LAFFONT-BOMPIANI, op. cit.
- Retour texte
(10) LAFFONT-BOMPIANI, op. cit.
Trad. fr. Imprimerie Soulier, 1843. - Retour
texte
(11) LAFFONT-BOMPIANI, op. cit.
Trad. fr. Aubier, 1931. Nouvelle trad. fr. Jean-Louis Besson
& Jean Jourdheuil, Paris, Editions théâtrales
Nanterre-Amandiers, 1995. - Retour texte
(12) Cf. Richard SAMUEL, «Kleists
Hermannsschlacht und der Freiherr vom Stein», in
Jahrbuch der Schillergesellschaft V, 1961, p. 64-101
- cité par Jean-Louis BESSON in H. von KLEIST, La
bataille d'Arminius, Paris, Editions Théatrales Nanterre
Amandiers, 1995, p. 139. - Retour texte
(13) J. JOURHEUIL, «Un objet
dramatique non stabilisé», in H. von KLEIST, La
bataille d'Arminius, Op. cit., p. 128. - Retour
texte
(14) J. JOURHEUIL, in H. von KLEIST,
La bataille d'Arminius, Ibidem. - Retour
texte
(15) J. JOURHEUIL, in H. von KLEIST,
La bataille d'Arminius, Ibidem. - Retour
texte
(16) J. JOURHEUIL, in H. von KLEIST,
La bataille d'Arminius, Op. cit., pp. 126-127. - Retour
texte
(17) J. JOURHEUIL, in H. von KLEIST,
La bataille d'Arminius, Op. cit., p. 127. - Retour
texte
(18) Ventidius avait réclamé
de Thusnelda une boucle de ses cheveux comme gage d'amour (intrigue
qu'Arminius, sans scrupules, favorisait pour mieux duper les
Romains); en réalité c'était un échantillon
de la perruque qu'il comptait offrir à l'impératrice
Livia, une fois les Germains soumis... - Retour
texte
(19) Allusion à Juges,
19 : 29 sqq. : le lévite dont les Benjamites de
Gabaa violèrent la concubine, tua celle-ci et découpa
son corps en douze parts qu'il envoya aux douze tribus d'Israël
afin qu'elles punissent la ville infâme. Von Kleist, bien
entendu, voit la race allemande comme un «Peuple Elu».
- Retour texte
(20) Et, dans la pièce de
Grabbe, aussi Hérode.
Dans ses Mémoires de Ponce Pilate, Anne Bernet
fait de ce dernier - alors tout débutant dans la carrière
des honneurs - un survivant de la bataille de Teutberg, première
étape d'un parcours spirituel qui le verrait se convertir
et mourir en martyr.
Il nous plaît d'imaginer que cette idée lui était
peut-être venue de Grabbe. Le délire qui consiste,
pour le pieux poète allemand, à imaginer qu'Auguste
et Tibère avaient eu connaissance de la naissance du
Christ dès 9 de n.E. (le pauvre enfant ne devait guère
alors débattre de théologie qu'avec les rabbins
de sa petite synagogue de Nazareth), ou que Ponce Pilate y était
déjà en fonction comme procurateur relève,
bien entendu, de la license poétique. - Retour
texte
(21) Cf. D. BRÜGGEMANN,
«Fortwährende Schlacht mit abwechselndem Glück.
Grabbes letztes Drama «Hermannsschlacht» u. die
Realität des Realitätslosen», Grabbe-Jahrbuch.,
3, 1984, S9-40; J.A. BOOKER, The mayor Hermannsschlacht
Dramas, Diss. Lincoln, Univ. of Nebraska 1975 - cités
par St. MISCHER. - Retour texte
(22) G.W.F. HEGEL, Introduction
à la Philosophie de l'Histoire. - Retour
texte
(23) Cf. H.W. NIESCHMIDT,
Grabbes letztes Geschichtsdrama, 1977. - cité
par St. MISCHER. - Retour texte
(24) Werner Broer, philologue et
senior-président de la Société
Grabbe à Detmold. Cf. interview de W. Broer
dans un supplément du DVD Hermannsschlacht. -
Retour texte
(25) Cf. ENCARTA.
- Retour texte
|
| |
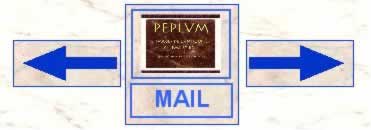 |
|