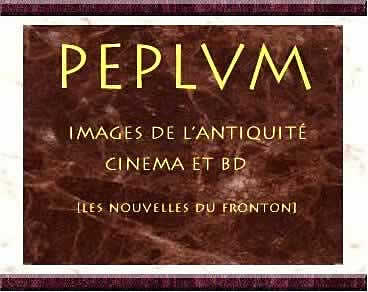 |
| |
| |
Le Chevalier Blanc
Sigfrido - La Leggenda dei Nibelunghi
(Giacomo Gentilomo,
IT - 1958)
|
|
| |
|
|
|
| |
«Nacht und Nebel, niemand gleich»(1)
En 1957, Giacomo Gentilomo compte déjà à
son actif quelques films axés sur le réalisme social.
Ayant fait une partie de ses études en Allemagne, il décide
de porter à l'écran une nouvelle version - en couleur
et sonore - d'un film qui l'a particulièrement impressionné,
Les Nibelungen, double hommage à Fritz Lang et à
Richard Wagner. Ce dernier alimente la bande son par de larges
extraits de sa tétralogie tandis que l'autre se voit fréquemment
cité par de nombreux clins d'œil cinématographiques.
Nombre de scènes comme le combat contre le dragon ou celle
de la source où Siegfried est assassiné ont été
reconstituées en studio, avec des racines et des pierres
moussues qui composent autant de petits tableaux maniéristes,
véritables chromos contrastant avec la froide sobriété
du château de Worms et ses édifices, dont le dépouillement
et la géométrie lorgne vers la version
de 1924.
Résumant en une heure et demie une matière que
d'autres réalisateurs traitèrent en quatre, Gentilomo
élague largement son sujet : point de prologue sur la responsabilité
des dieux et la malédiction originale de l'Anneau, ni les
déboires de Siegmund et Sieglinde, ici réduits à
l'essentiel. Comme Wagner, Gentilomo laisse également de
côté «La Vengeance de Krimhilde» dont
Fritz Lang puis Harald Reinl avaient fait le sujet du second volet
de leur diptyque. Il évite également les détails
scabreux comme le déroulement de la nuit de noces, où
l'époux Gunther se fait «aider» pour posséder
sa femme. Et en une seule réplique, Gentilomo élude
la préalable rencontre de Siegfried
et Brunhilde dans
le cercle de flammes : rien d'ambigu chez Siegfried, qui est l'homme
d'une seule femme, pour laquelle il a occis le dragon et s'est
emparé du trésor, ainsi qu'Albéric
le lui a conseillé : «Et ainsi tu conquerra Krimhilde,
la femme que tout le monde voudrait avoir.» Quoique
courtisée par le sinistre Hagen,
qui la laisse indifférente, Krimhilde
ne désire pas se marier, jusqu'à ce que le blond
héros apparaisse : «Il faut lui pardonner. C'est
un rusé fripon, libre comme un poulain, et qui ne craint
ni brides ni fouet.» Ce n'est que plus tard qu'elle
aura la révélation de son amour, quand Siegfried
demandera sa main à son frère.
Après les hors-d'œuvre obligés que constituent
les épisodes du dragon, du tournois à Worms et de
l'expédition en Islande, Le Chevalier Blanc se recentre
sur l'intrigue de palais. Un héros innocent manipulé
par un roi incapable, lequel trop facilement s'en remet aux conseils
d'un «dévoué» ministre : un félon
pour qui la raison d'Etat est la meilleure, surtout s'il y trouve
son compte. Et la réaction d'une femme bafouée,
blessée dans son amour propre de reine, comme dans ses
sentiments de femme. Au premier coup d'œil, Brunhilde a jaugé
Gunther et Siegfried
et su qui elle aimait. Qui aimerait s'entendre distiller à
l'oreille, comme le fait Hagen : «Tu as été
(pour Siegfried) la monnaie qui lui a procuré Krimhilde»
? Krimhilde, une petite oie blanche qui a le front de se rebiffer;
la sœur d'un roi méprisable. Et l'épouse jalousée
de ce héros trop pur et trop naïf qui l'a doublement
déshonorée, d'abord par sa trouble complaisance
de vassal, ensuite par son «indiscrétion»...
Venu du théâtre, le blond Sebastian Fischer campe
le héros demi-nu, de blanc vêtu - candide dans tous
les sens du terme - opposé au noir Hagen, qui pas un seul
instant ne se départit de sa cotte de mailles. Les couleurs
définissent les personnages : les tons pastels pour Krimhilde,
le rouge vif ou le violet pour Brunhilde, le bleu pour l'indécis
et faible roi Gunther («Et à présent je
suis à tes pieds. Non pas un roi, mais un esclave»).
Il faut saluer l'éditeur DVD Artus
Film d'avoir ressuscité ce film oublié - oublié
et largement enterré depuis la majestueuse version de 1966
signée par Harald Reinl, plus connue des amateurs de cinéma
épique.
Le Chevalier Blanc, visa de censure n 1.891 (1958), s'inscrit
aux origines du cinéma historico-mythologique italien de
l'après-guerre. Il a été tourné directement
dans la foulée des Fatiche di Ercole, visa de censure
n 1.855 (2)
(1958), dans les mêmes extérieurs comme les cascades
de Monte Gelato et aussi, notamment, la fameuse grotte où
Antéa, reine des Amazones (Le Fatiche di Ercole)
puis Omphale reine de Lydie (Ercole e la Regina di Lidia)
avaient leur palais troglodyte. Quant au drakkar qui conduit les
Burgondes en Islande, c'est le même bateau remaquillé
que la nef Argo dans les deux «Hercule» de
P. Francisci.
Après un démarrage très kitsch filmé
dans une forêt de Lombardie par Piero Pierotti et où
l'on voit le blond héros germanique gambader dans les fougères
puis, émule du bon sauvage Tarzan, jouer avec un ours (3),
le film de Gentilomo vire au tragico-lyrique lorsqu'il aborde
le domaine burgonde et les thèmes folklorico-populaires
autour de la reine d'Islande Brunehilde,
cette vierge guerrière que - sauf Siegfried, bien sûr
- nul mortel, fut-il le puissant roi des Burgondes lui-même,
ne peut soumettre tant qu'elle conservera sa virginité.
Mais comment la lui ravir ? C'est ce à quoi va s'employer
le naïf et serviable héros de la forêt, mettant
sans le vouloir le doigt dans un engrenage qui va le conduire
à sa perte.
C'est qu'on l'oublie trop souvent : la Chanson des Nibelungs
est l'histoire d'une malédiction. «Siegfried a
commis par traîtrise un double assassinat crapuleux
(4)
- note Jean Amsler (5).
Il le paie à la longue par un enchaînement
de vengeances et de contre-vengeances échelonné
sur quelque trente-cinq ans et qui s'étend à tous
les siens. Restent en vie Etzel, païen éclairé,
et Dietrich, chef désobéi mais chrétien.»
Le film de Gentilomo emprunte surtout à Wagner lequel,
sauf les noms, avait davantage puisé dans l'Ancienne
Edda païenne que dans la courtoise épopée
bavaroise (Nibelungenlied)(6),
sans pour autant que le cinéaste suive la tétralogie
dans tous ses développements. Comme pour la mythologie
grecque, il existe plusieurs versions différentes - ne
citons que l'Ancienne Edda islandaise,
le Nibelungenlied bavarois et la réécriture
par Richard Wagner, mais on trouve des détails
dans d'autres textes comme la Völsungasaga islandaise,
la Saga de Théodoric de Vérone (7)
norvégienne ou le Waltharius -, qui ne sont pas
toujours concordantes sur les faits, les motivations et même
les noms des personnages. Ainsi, les Siegfried, Brunhilde, Krimhilde
et Gunther du poème allemand se nomment respectivement
Sigurd, Brynhild, Gudrun et Gunnar dans l'Ancienne Edda,
tandis que les Burgondes
y deviennent les Giukungs (ou les Gibichungen dans Le Crépuscule
des Dieux de Wagner).
Et si le poème du XIIe s. ne voit dans l'aversion de Brunhilde
pour Siegfried qu'un préjugé féodal, le sentiment
amoureux refoulé dont Gentilomo a fait un des principaux
ressorts de son film était bien présent dans la
version islandaise, reprise par Richard Wagner. Avant que d'aller
en Islande en compagnie de son ami Gunther/Gunnar pour conquérir
Brunhilde/Gudrun, Siegfried/Sigurd avait déjà rencontré
la belle au cours d'un premier voyage; et traversant le cercle
de feu qui entourait la couche de la Walkyrie endormie, l'avait
réveillée d'un chaste baiser. Avant de la quitter,
il lui avait promis de revenir la chercher, et elle lui avait
passé au doigt une bague engageant sa foi.
Hélas, une drogue administrée par Griemhild, mère
de Gudrun (8),
effaça cette promesse de sa mémoire, ce pourquoi
dans son ignorance il livra à son ami celle qui l'aimait
et l'attendait. |
|
I. Encyclopédie
Le poème des Nibelungen a été fixé
par écrit au XIIe s., et la civilisation qu'il décrit
était de toute évidence celle que connaissaient
ses auditeurs, les contemporains du poète : le Moyen Age
allemand.
Pourtant, en dépit de sa coloration chrétienne -
mariage dans une cathédrale - et ses références
au monde féodal comme la relation suzerain-vassal, le poème
brasse de nombreux éléments empruntés au
vieux fond du paganisme
germanique. Siegfried est de toute évidence un héros
de cette mythologie, tout comme Brunhilde dont les Eddas
islandaises font une Walkyrie
fille d'Odin, ou encore Hagen
de Tronège, l'homme de l'ancienne loi.
Même si le réalisateur a choisi de camper l'action
de son film dans un Moyen Age syncrétique plutôt
que le Bas-Empire romain, un protagoniste comme Etzel (Attila,
roi des Huns, qui intervient dans la seconde partie du poème,
non traitée par Gentilomo) ancre bien la légende
dans les dernières décennies de l'Empire romain
d'Occident.
Le roi des Burgondes
Gunther, Gunnar dans la version nordique, correspond au personnage
historique de Gundikar ou Guntiarius,
qui se fit massacrer par les Huns avec toute sa famille et une
partie de son peuple en 436. Guntiarius et son royaume burgonde
avaient dominé une partie de la vallée rhénane;
mais, par ses velléités d'expansion vers la Belgique,
ce fœderati avait irrité le Patrice romain
Ætius, Maître de la Milice. Ætius les fit liquider
par ses alliés huns, sur lesquels, fin 434, son ami Attila
venait de prendre le pouvoir. Les Burgondes survivants émigrèrent
dans la vallée du Rhône, la future Bourgogne. La
Chanson des Nibelungs situe sa capitale rhénane
à Worms - l'antique Borbetomagus celtique, capitale des
Vangions -, mais ce rôle semble historiquement assez peu
probable (9).
Douze ans après la mort du héros, sa veuve Krimhilde
poussa le roi des Huns, son second mari, à inviter en sa
capitale sur le Danube les Burgondes, assassins de son premier
époux. Son but était de les y faire exterminer avec
la complicité de certains chevaliers Huns à sa dévotion.
Le personnage légendaire de Krimhilde a peut-être
été inspiré par celui, historique, de la
Germaine Hildiko qui fit périr son mari Attila lors de
sa nuit de noces en 453 (15 mars ?). Hildiko
était issue d'un peuple soumis par les Huns. Or si, dans
la version bavaroise du XIIe s., Krimhilde - sa vengeance accomplie
- n'assassine nullement son barbare empereur hun de mari, qui
est présenté comme un souverain pacifique, dans
la version islandaise, par contre, Attila attirait bien à
sa cour son beau-frère Gunther afin de l'assassiner et
le dépouiller du trésor des Nibelungen.
Et Krimhild vengeait ses frères en immolant les deux fils
qu'elle avait eu d'Attila, puis - ayant confectionné des
pâtés avec leur chair - les servait à manger
à leur père. Quoi qu'il en soit, même dans
la version bavaroise qui leur est favorable, il semble que le
potentiel militaire des Huns ait été réduit
à néant lorsqu'enfin le vassal d'Attila, l'Ostrogoth
Dietrich de Bern (10)
et son maître d'armes Hildebrand, vinrent à bout
de Gunther.
|
|
II. Les sources
«S'il est donc relativement aisé de déceler
les origines de cette légende, il est plus difficile de
dire comment se sont formées celles dont Siegfried est
le héros. Etait-il à l'origine un être mythique
dont le destin symboliserait successivement la victoire de la
lumière sur les ténèbres (combat avec le
dragon), puis la revanche des forces du mal (mort de Siegfried)
? S'agit-il d'un personnage de contes populaires qui serait devenu
héros de légende ? Ou bien ces récits - comme
celui de la mort des rois burgondes - remontent-ils en dernière
analyse à des événements historiques ? Faut-il
y voir l'écho des démêlés sanglants
entre Brunehaut (Brünhild), l'épouse du roi d'Austrasie
Sigebert, et Frédégonde ? Siegfried
est-il le chef chérusque Arminius,
dont la victoire sur les légions romaines de Varus aurait
été présentée sous la forme mythique
d'un combat avec un dragon, alors que le récit de sa mort
se serait maintenu sur le plan purement humain ? De toutes ces
thèses, aucune n'a réussi à s'imposer»
(11)
.
Les trois sources principales sont : |
| — |
l'Ancienne Edda islandaise |
| — |
la Chanson des Nibelungs |
| — |
la Tétralogie de Richard Wagner : L'Anneau du
Nibelung |
|
|
A. L'Ancienne Edda islandaise
L'Ancienne Edda (ou Edda poétique) est un
recueil de poèmes du IX-XIIIe s., en langue norroise, la
plupart composés en Islande, quelques-uns au Grœnland,
attribué à Sœmund-le-Sage et découvert
en 1642. La seconde partie est entièrement consacrée
aux Vœlsungs et à Sigurd.
Recueil de pièces diverses, l'Ancienne Edda nous
révèle l'histoire de Sigurd, ses exploits, ses amours,
sa mort et la vengeance de sa veuve... mais par petites touches,
comme dans un tableau tachiste. Les différents poèmes,
souvent fort courts, sans cesse reviennent sur les mêmes
faits, ou certains aspects de ceux-ci, apportant de nouvelles
précisions, non exemptes de contradictions. On a un peu
l'impression de lire les différents procès-verbaux
constituant un dossier criminel.
(Composée en prose, la Nouvelle Edda (ou Edda
prosaïque) a, quant à elle, été
composée par Snorri
Sturluson vers 1220, mais nous est parvenue avec des ajouts
ultérieurs.)
|
|
| 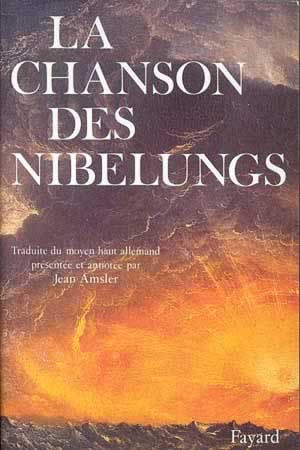
La Chanson des Nibelungs
(trad. moyen haut allemand Jean Amsler - manuscrit B dit
de «Saint Gall»), Fayard, 1992 |
|
| |
B. La Chanson des Nibelungs
Il s'agit d'un poème compilé par un rédacteur
inconnu au XIIe s., vraisemblablement en Basse-Autriche ou en
Allemagne méridionale (Bavière ?) sous le titre
Chanson des Nibelungs (Das Nibelungenlied) ou Détresse
des Nibelungs (Der Nibelungen Not). On en a attribué
la paternité d'abord au Sire de Kürenberg, puis à
un problématique Henri d'Ofterdingen.
L'œuvre se compose de 3.379 strophes de quatre vers chacune,
réparties en trente-neuf «aventures». Les dix-neuf
premières relatent ce qu'il est convenu d'appeler «La
mort de Siegfried»; les vingt autres «La vengeance
de Krimhilde». Elle nous a été transmise par
trois manuscrits conservés respectivement à Donaueschingen,
à Saint-Gall et à Münich.
Sa principale caractéristique est d'insérer dans
un monde médiéval courtois, chrétien et chevaleresque
une matière venue des temps païens d'Odin-Wotan et
des autres dieux du Walhalla. Les exploits mythologiques de Siegfried,
son combat contre le dragon Fafner, la conquête du Trésor
maudit des Nibelungs, la chape d'invisibilité (Tarnkappe
ou Tarnhelm) et l'anneau, son invulnérabilité
et sa compréhension du langage des oiseaux sont brièvement
rapportés par Hagen
en quinze strophes de la Troisième Aventure, sans aucun
développement (Chanson, III, 86 à 100).
La relation du héros avec le nain forgeron Mime
est complètement ignorée de la chanson, comme du
reste les origines du trésor et le crime des dieux. Est
également passé sous silence la tragique histoire
de ses parents Siegmund
et Sieglinde : pour le «poète bavarois»
(appelons ainsi l'auteur de la Chanson des Nibelungs),
Siegfried a connu une enfance princière auprès de
ses père et mère à Xanten, sur le Rhin; d'ailleurs
ils lui survivront, au lieu de l'avoir laissé orphelin
ainsi qu'il est dit dans les versions islandaises et wagnérienne.
Et contrairement à ce que rapporte l'Ancienne Edda
- suivie par Wagner -, Siegfried, en route pour Worms, n'a jamais
rencontré pour la réveiller d'un chaste baiser Brunhilde,
la «Belle-au-Bois-Dormant».
La rédaction de la Chanson des Nibelungs a eu
pour toile de fond les temps tourmentés, s'il en fut, des
cinquième et sixième croisades qui virent, en
Allemagne, l'affrontement entre les Gibelins (Waiblingen),
partisans de la Maison de Souabe représentée par
l'empereur Frédéric II et les Guelfes (Welfes),
soutenant en la matière le point de vue du Pape. A telle
enseigne que, dans un premier temps, Wagner, qui ne s'était
pas encore lancé dans la composition de sa tétralogie,
s'était d'abord attelé à la rédaction
d'un petit essai, les Wibelungen (1848) où il assimilait
les Nibelungen aux Waiblingen/Gibelins, avant de bifurquer
pour s'attaquer la même année à une Mort
de Siegfried, premier jet de ce qui deviendra vingt-sept ans
plus tard le quatrième volet de la Tétralogie :
Le Crépuscule des Dieux (1874).
Le Saint Empire romain germanique n'avait de «romain»
que la légitimité qu'il tirait de sa sanction par
le Pape de Rome. Benoist-Méchin a consacré une superbe
biographie à Frédéric II de Hohenstauffen
(12),
le fils de l'éphémère empereur germanique
Henri VI et le la reine de Sicile, la Normande Constance d'Hauteville.
Né après le décès de son père,
le jeune prince souabe avait non sans difficultés - avec
l'aide du Pape (Honorius III) ou malgré son opposition
(Innocent III, Grégoire IX et Innocent IV) - récupéré
ses trônes de Sicile, puis d'Allemagne occupés par
ses tuteurs-usurpateurs. Son mariage avec Yolande de Brienne l'avait
fait en titre «roi» de Jérusalem (13),
alors entre les mains des musulmans. Mais le peu d'empressement
à partir en croisade de cet humaniste et diplomate, fervent
admirateur de la culture arabe et qui se déclarait «vice-roi
sur la Terre d'Alexandre-le-Grand et du Christ», lui
valut d'être excommunié à trois reprises,
d'abord par Honorius III (29 septembre 1227), ensuite par Grégoire
IX (20 mars 1239), puis enfin par Innocent IV (17 juillet 1245).
S'immisçant dans le pouvoir temporel, ce dernier avait
même voulut le déposer en tant qu'empereur germanique,
ce à quoi s'opposa le roi de France.
Il est bon de se souvenir de ce contexte.
|
|
La tétralogie
de Richard Wagner, L'Anneau du Nibelung (Der Ring des
Nibelungen) : un peu moins de seize heures de spectacle
musical sous-titré en français, est notamment
disponible dans la version du Metropolitan Opera de New-York
sous la direction de James Levine et mis en scène
par Otto Schenk (1990) (DVD : Deutsche Grammophon, 2002).
Prologue - L'Or du Rhin (Das Rheingold,
1854) (163'). Premier jour - La Walkyrie (Die
Walküre, 1856) (241'). Deuxième jour -
Siegfried (Siegfried, 1869) (253'). Troisième
jour - Crépuscule des Dieux (Götterdämmerung,
1874) (281').
Le texte des livrets en «juxta» allemand-français,
traduction Jean d'Arièges, préfaces de Marcel
Doisy, chez Aubier-Flammarion (4 vols, 1968-1972).
|
|
| |
C. La Tétralogie de Richard Wagner (Der
Ring des Nibelungen)
Personne n'en disconviendra, Wagner a révolutionné
l'opéra par son concept de spectacle total inspiré
de la tragédie grecque, où la musique, le texte
et la mise en scène s'interpénètrent profondément,
et la Tétralogie en fut l'aboutissement le plus achevé.
«... Cette œuvre marquait justement ma rupture définitive
avec les théâtres modernes d'opéra, et
(...) mon aversion pour eux n'avait pas peu contribué
à m'inspirer cette excentrique conception, (mais) personne
ne voulait prendre cette raison au sérieux» (14).
Son ami Edouard Schuré - le seul Alsacien que ne détestât
point le Maître de Bayreuth, par ailleurs antisémite
- écrira de lui : «Comme poète et comme
musicien, Wagner fut le plus universel des artistes; comme homme
et comme penseur ce fut un Teuton obstiné» (15).
1. Résumé
- L'Or du Rhin (Das Reingold, 1854) (163')
|
Sc. 1 |
- Le nain Alberic tente de séduire les Filles
du Rhin, gardiennes de l'or. Comme elles se moquent de
lui, il maudit l'amour, condition sine qua non
pour s'approprier le précieux métal d'où
il forgera un anneau qui lui donnera l'empire sur le monde.
|
| Sc. 2 |
- Le roi des dieux, Wotan
a fait construire par les géants Fasolt et Fafner
un inexpugnable château : le Walhalla. Mais il lui
faut maintenant régler le salaire convenu, c'est-à-dire
leur livrer Freia, la déesse de la Jeunesse et
du Printemps, épouse de Froh. Les dieux - Froh,
Donner, Fricka l'épouse de Wotan, et Loge le génie
du feu - cherchent une solution pour soustraire la belle
déesse à cette obligation. L'or puissant
du Nibelung Alberic est avancé comme contre-proposition;
mais déjà il suscite la convoitise de Wotan.
|
| Sc.
3 |
- Dans le Nibelheim, Alberic règne sur les nains-forgerons,
les Nibelungen, qu'il traite en esclaves - en particulier
son frère Mime, son souffre-douleur. Loge et Wotan
descendent dans le souterrain royaume, s'emparent de l'or,
du heaume magique et de l'anneau. Et enchaînent
Alberic qui les maudits.
|
| Sc.
4 |
- Les dieux échangent Freia contre l'or. Mais
Fasolt et Fafner exigent également le heaume magique
et l'anneau du pouvoir. En vain cependant solliciteront-ils
l'arbitrage des dieux dans un équitable partage
du trésor ! Fafner tue son frère Fasolt
et emporte le tout. Les dieux prennent possession du Walhalla,
pendant que se lamentent les Filles du Rhin grugées.
|
|
- La Walkyrie (Die Walküre, 1854-1856)
(241')
|
| Acte 1, Sc. 1, 2 et 3 |
- Siegmund le proscrit
trouve refuge dans la maison de Hunding le Neidingen,
son persécuteur. Celui-ci lui accorde l'hospitalité
pour la nuit, mais à l'aube les deux hommes se
livreront à un duel à mort. Mariée
de force, l'épouse de Hunding Sieglinde reconnaît
en Siegmund son frère jumeau dont elle a été
séparée. Elle révèle à
son frère et amant l'existence de l'épée
Notung (l'«épée de Détresse»),
fichée par leur père «Wolfe»
(16)
- Wotan, lors d'une de ses frasques terrestres - dans
le tronc du frêne autour duquel est bâtie
la demeure d'Hunding.
|
| Acte 2, Sc.
1 à 5 |
- N'étant pas libre d'agir à sa guise,
Wotan confie à sa fille Brünnhilde,
la Walkyrie, la tâche de soutenir Siegmund dans
son duel contre Hunding. Survient son épouse Fricka,
la reine des dieux, déesse du mariage, qui dénie
à son mari le droit de protéger le couple
adultère et incestueux (17)
(«ce couple criminel de jumeaux, fruit
indiscipliné de ton inconstance...»)
qui vit en marge des lois divines et humaines les plus
sacrées. Ainsi se venge-t-elle des infidélités
de son époux. Le roi des dieux lui répond
avec bonhommie :
Fais aussi l'expérience
de ce qui arrive de soi-même,
même si cela ne s'est encore jamais produit !...
Ces êtres s'aiment :
c'est pour toi d'une clarté aveuglante.
Dès lors, écoute un conseil loyal :
si tu veux qu'une douce joie
récompense ta bénédiction,
bénis en souriant à l'amour
le lien de Siegmund et Sieglinde !
(...)
... tu es incapable de comprendre
avant que l'événement ne se produise
Seule l'expérience vécue
peut t'éclairer,
alors que toute ma pensée tend
vers ce qui ne s'est encore jamais produit !
(La Walkyrie, Acte 2, sc. 1 - trad.
Jean d'Arièges)
Wotan - qui sent venir le déclin de la puissance
des dieux - est contraint de renoncer à son projet
d'un homme libéré des divinités (18),
le seul qui pourrait pour lui reconquérir le fameux
anneau maudit. Brünnhilde, toutefois, refuse d'abandonner
Siegmund et s'opposera à son propre père
lors du duel où s'affrontent Hunding et Siegmund.
Wotan tue donc son fils - et, plein de mépris,
occit également l'«instrument» Hunding
-, tandis que Brünnhilde met en sécurité
Sieglinde, qui porte en son sein le fruit de leur amour
maudit : Siegfried.
|
| Acte 3,
Sc. 1, 2 et 3 |
- Brünnhilde, s'est réfugiée chez
ses sœurs, les Walkyries, filles de Wotan et d'Erda,
la déesse de la Terre, et remet à Sieglinde
les tronçons de l'épée brisée
Notung. Puis elle comparaît devant son père,
ulcéré par sa désobéissance.
Elle plaide n'avoir rien fait d'autre que d'accomplir
la vraie volonté de son père. Celui-ci,
ému, la prive de sa divinité, et la plonge
dans un long sommeil d'où seul un héros
poussé par l'amour véritable pourra l'en
tirer par un baiser. A la demande de sa fille, il entoure
sa couche d'un mur de feu.
|
| |
| 
Siegfried affronte le dragon Fafner.
Illustration de J. Kühn-Régnier pour H.
WEILLER, Epopées et légendes d'Outre-Rhin,
Paris, F. Nathan, s.d. |
|
|
- Siegfried (Siegfried, 1856, 1864-1869)
(253')
|
| Acte 1, Sc. 1 |
- Pendant que le jeune Siegfried terrasse des ours dans
la forêt, le forgeron Mime - qui l'a éduqué
- désespère d'être capable de forger
une épée digne du jeune homme. Siegfried,
conscient que le nain ne peut pas être son père,
lui extorque la vérité : c'est sa mère
Sieglinde, mourante, qui l'a confié au forgeron
en même temps que les fragments de l'épée
Notung.
|
Sc. 2
|
- Wotan ne règne plus dans le Walhalla; il erre
sur la terre. Sous l'aspect d'un voyageur à la
robe bleue, au large chapeau rabattu sur son visage dissimulant
la cavité de l'œil qu'il a perdu, une lance
en guise de bâton de marche. Le voici dans la forge
de Mime, lui posant trois énigmes. Mime répond
aux deux premières : «Qui sont les Nibelungen
? Quel fut le destin des Wälsungs - que le dieu aima,
mais ne put défendre - et de l'épée
Notung ?»
Mais il ne peut répondre à la troisième
: «Quel adroit forgeron pourra ressouder l'épée
?» La réponse est pourtant évidente
: seul Siegfried le peut, lui qui ignore la crainte, lui
qui est destiné à vaincre Fafner.
|
Sc. 3
|
- Retour à la forge, Siegfried réclame
son épée. Mime tente de lui enseigner la
peur en lui parlant de Fafner, mais le héros le
prie au contraire de le conduire à son antre. Au
préalable, il reforge lui-même Notung, la
trempe dans l'eau, brise l'enclume avec... tandis que
Mime, espérant récupérer le trésor
à son seul profit une fois le dragon occis, lui
prépare du poison.
|
| Acte 2,
Sc. 1 |
- Wotan rencontre Alberic, et pour détourner son
attention de Siegfried, le met en garde contre son frère
Mime, invitant même Fafner à restituer le
trésor à Alberic.
|
Sc. 2
|
- Arrivent en discutant Mime et Siegfried. Puis le héros,
s'allongeant sous un tilleul, tente de s'initier au langage
des oiseaux. Pendant ce temps, Mime va tirer Fafner de
son antre. Alors le duel s'engage; Siegfried lui perce
le cœur, et le saurien agonisant met en garde le
héros contre la perfidie de Mime. Léchant
ses doigts couverts du sang du dragon, Siegfried s'aperçoit
qu'il comprend le langage des oiseaux et se précipite
dans la caverne pour récupérer l'anneau
et le heaume d'invisibilité.
|
Sc. 3
|
- Là il trouve Mime et Alberic se disputant la
propriété du trésor; Mime menace
son frère de s'en remettre à l'arbitrage
de Siegfried. C'est alors que survient le héros;
mais lorsque Mime lui tend le breuvage empoisonné
qu'il lui a préparé, Siegfried le tue. Avec
le corps du dragon, le héros obstrue l'entrée
de la caverne, puis se recouche sous le tilleul, où
le chant de l'oiseau l'informe de ce que, endormie sur
son rocher entouré de flammes, la belle Brünnhilde
attend le héros sans peur qui la réveillera.
L'oiseau accepte de guider le héros jusqu'à
elle.
|
| Acte 3,
Sc. 1 |
- Wotan consulte Erda, déesse de la Terre, pour
connaître l'avenir. Mais la déesse, mère
de Brünnhilde, reste évasive. Wotan, qui attend
sans crainte le déclin des dieux et l'élévation
d'une nouvelle race, n'insiste pas.
|
Sc. 2
|
- Wotan impose une ultime épreuve au «héros
ignorant» en se mettant en travers de sa route.
Siegfried balaye l'importun et de son épée
Notung brise la lance du dieu (19).
Alors Siegfried sonne du cor et plonge dans les flammes.
|
Sc.
3
|
- Sur le rocher, Siegfried découvre le corps d'un
guerrier et près de lui son cheval, Grane, endormis.
Il lui ôte son armure et, pour la première
fois, éprouve un sentiment qu'il croit être
la peur. D'un baiser, il réveille la jeune fille,
Brünnhilde. Les deux jeunes gens renoncent au Walhalla
pour ne plus penser qu'aux humaines valeurs de «la
flamme d'amour, joie de la mort».
|
|
- Crépuscule des Dieux (Götterdämmerung,
1869-1874) (281')
(Une première version fut rédigée
en 1848, La mort de Siegfried (Siegfrieds Tod).)
|
| Acte 1, Sc. 1 |
- Chez les Gibichungen, au bord du Rhin. Fils d'Alberic
et de la reine Grimhilde, le perfide Hagen - demi-frère
du roi Gunther et de la princesse Gutrune - fait ces derniers
bénéficier de sa «sagesse»,
tissant patiemment la trame de la vengeance du roi des
nains. On annonce l'arrivée de Siegfried et déjà
il a un plan : que l'on donne Gutrune en mariage à
Siegfried «le fort entre les forts»,
à condition qu'il aide Gunther à conquérir
Brünnhilde «la belle entre les belles».
Un breuvage magique, offert en bienvenue par Gutrune,
sèmera la confusion dans l'esprit de Siegfried,
détournant sur celle-ci la passion du héros.
|
Sc. 2
|
- Et ce qui a été dit est fait. Siegfried
tombe amoureux de Gutrune, et se lie par le sang à
Gunther, à qui il se fait fort de livrer Brünnhilde
avec l'aide de son heaume magique.
|
Sc. 3
|
- Sur son rocher, Brünnhilde résiste aux
supplications de sa sœur, la Walkyrie Waltraute,
venue l'inviter à restituer aux Filles du Rhin
l'anneau que Siegfried lui a remis en gage de son amour.
Dans le lointain sonne un cor, que Brünnhilde reconnaît
comme étant celui de Siegfried. Et celui-ci est
bientôt devant elle... mais sous l'apparence de
Gunther ! Elle montre à «Gunther» l'anneau
qui signifie que sa foi est déjà engagée,
mais le Gibichungen se jette sur elle, la contraint, et
lui arrache l'anneau. Loyalement, Siegfried-Gunther passe
la nuit avec Brünnhilde en plaçant entre eux
deux l'épée Notung.
|
| Acte 2,
Sc. 1 |
- Au bord du Rhin, Hagen est en sentinelle, et confère
avec son père Alberic, qui lui enjoint de récupérer
l'anneau tant convoité par Wotan.
|
Sc. 2
|
- Transporté par son heaume magique, Siegfried
apparaît au palais du roi Gunther, pour annoncer
l'imminence de l'arrivée de celui-ci en compagnie
de sa reine Brünnhilde.
|
Sc. 3
|
- Hagen convoque les guerriers gibichungen en armes,
pour accueillir leur roi, Gunther.
|
Sc. 4
|
- Siegfried et Gutrune accueillent Gunther et Brünnhilde.
Siegfried (complètement sous l'emprise magique)
confirme à Brünnhilde que Gunther est bien
son promis. Mais celle-ci a remarqué l'anneau du
Nibelung à son doigt. Elle comprend qu'on s'est
joué d'elle. Elle proteste : c'est Siegfried son
époux. Mais Siegfried jure sur la lance de Hagen
qu'il n'en est rien. Et Brünnhilde, l'accusant de
parjure, voue à sa vengeance la lance de Hagen.
|
Sc.
5
|
- A Hagen qui s'offre à la venger, Brünnhilde
révèle le point vulnérable de Siegfried,
entre ses omoplates - là où ses charmes
n'ont point agi (20).
Le complot se trame.
|
| Acte 3,
Sc. 1 |
- Au cours d'une partie de chasse, Siegfried apparaît
sur le bord du Rhin. Les Ondines le prient de leur restituer
l'anneau fatal, et le héros au cœur pur serait
prêt à leur rendre ce plaisir car l'anneau
n'est rien pour lui. Mais une parole malheureuse l'interpelle
: on lui prédit que conserver l'anneau lui vaudrait
de mourir ce jour même. Or Siegfried se moque de
mourir.
|
Sc. 2
|
- La partie de chasse s'achève. Tandis qu'il se
désaltère, Hagen lui plonge son épieu
dans le dos. Son agonie déchire le voile qui obscurcissait
sa mémoire : ses dernières paroles seront
pour... Brünnhilde, sa «sainte épouse».
Consternation des guerriers. Hagen se justifie.
|
Sc. 3
|
- Au palais des Gibichungen, Hagen se vante de sa «victoire».
Gutrune accuse son frère de meurtre; celui-ci répond
qu'Hagen, leur demi-frère, a agi d'initiative.
Le meurtrier revendique l'anneau, que le roi lui conteste;
alors Hagen tue Gunther. Le héros défunt
se redresse sur sa couche, lorsque le félon veut
lui ôter l'anneau. Tandis que Gutrune se penche
sur le corps de son frère, Brünnhilde comprend
que la prétendue trahison de son fiancé
a été suscitée par un philtre dont
il fut la victime. La Walkyrie déchue mesure la
culpabilité des dieux en cette affaire. La restitution
de l'anneau aux Ondines, Filles du Rhin, seule aurait
pu contrer la malédiction. Mais il est trop tard.
Elle passe l'anneau à son doigt puis allume le
bûcher du héros, érigé au bord
du Rhin. Alors, montée sur le cheval Grane, elle
s'élance dans les flammes et rejoint Siegfried
dans la mort. Soudain, le Rhin déborde et balaye
le bûcher. Les Ondines récupèrent
l'anneau et entraînent Hagen dans les profondeurs
- tandis qu'à l'horizon s'embrase le Walhalla.
|
|
|
| 2. Chronologie |
| |
| 1848 : |
Prélude à ce qui allait être l'œuvre
de sa vie, Wagner compose un essai, les Wibelungen
(1848) - interprétation historico-sociale de la saga
- et trois esquisses dramatiques, Jésus de Nazareth
[Jesus von Nazareth], Le forgeron Wieland [Wieland der Schmied]
et Le mythe des Nibelungen [Der Nibelungen Mythus],
dans lequels le poète ébauche «les
exigences éthico-religieuses de l'âme moderne,
partagée entre l'amour et la charité, entre
la volonté de jouissance et de domination et la volonté
de renoncement, se concrétisent dans le mythe de l'amour,
qui s'oppose à la fascination fatale de l'or»
(Laffont-Bompiani) qui allaient structurer sa Tétralogie.
En novembre de la même année, Wagner entame une
Siegfrieds Tod («La Mort de Siegfried»)
qui, remaniée, deviendra le quatrième volet
de la Tétralogie, Le Crépuscule des Dieux. |
| 1852 : |
Wagner compose les poèmes de L'anneau du Nibelung. |
| 1854 : |
Il compose L'or du Rhin (Das Rheingold), prologue
de la Tétralogie, et entame la première partie
: La Walkyrie (Die Walküre), qu'il achève
en 1856. |
| 1856 : |
La partition de La Walkyrie achevée, il s'attaque
à celle de Siegfried (Siegfried). |
| 1864 : |
Encouragé par Louis II de Bavière, il se remet
à la composition de Siegfried. |
| 1869 : |
Se remet aux actes II et III de Siegfried. Naissance
de son fils Siegfried. Création de l'Or du Rhin
à Munich, mais contre sa volonté. Wagner entame
la composition du quatrième volet de la Tétralogie,
le Crépuscule des Dieux (Götterdämmerung). |
| 1870 : |
La Walkyrie est créée à Munich,
sans son consentement. Il écrit la Siegfried-Idyll. |
| 1871 : |
A Bayreuth, Wagner décide d'y édifier son
Festspielhaus (pose de la première pierre en 1872). |
| 1874 : |
Wagner achève la partition du Crépuscule
des Dieux. |
| 1876 : |
Le Festpielhaus est inauguré par trois représentations
intégrales de la Tétralogie. |
|
| |
Richard Wagner (Leipzig,
22 mai 1813-Venise, 13 février 1883) comptait 35
printemps lorsqu'il s'attaqua à l'écriture
de sa Tétralogie; il ne devait l'achever qu'à
61 ans. L'œuvre de toute une vie, que l'artiste avait
voulu être un «spectacle total», et
qui fut une véritable révolution du théâtre
lyrique. (Bologne Liceo Musicale - photo : Scala). A droite
: traduction française des commentaires de ses
opéras par leur auteur : Richard Wagner, Mes
Œuvres, Corréa éd., 1941
|
|
|
D. Autres sources
Un document du début du Ve siècle, la loi Gombette,
a conservé les noms des anciens rois burgondes : ce sont,
à peu de chose près, ceux qu'on trouve dans la Chanson
des Nibelungen et dans les textes scandinaves.
Outre l'Ancienne Edda et la Chanson des Nibelungs
précités, la principale source est, assurément,
la Völsungasaga - que, n'étant pas spécialiste,
l'auteur de ce dossier ne connaît que par des «sources
obliques (21)»
et n'a pas eu l'occasion de la consulter en traduction (22).
La Thidrekssaga (ou Saga de Théodoric de Vérone)
est une compilation norvégienne, composée circa
1260, dont l'auteur, selon ses propres dires, s'est ingénié
à grouper autour d'un personnage central historique, Dietrich
von Bern (23)
différents héros dont Sigurd, Iron et Gautier d'Aquitaine.
On en trouvera les références
bibliographiques en fin de dossier. |
NOTES :
(1) «Nuit et brouillard, / semblable
à personne», formule magique murmurée par
Alberich se coiffant du heaume qui le rend invisible (R. WAGNER,
L'Or du Rhin, sc. 3). - Retour texte
(2) Sa séquelle Ercole e
la Regina di Lidia (1959), recevra le numéro de visa
de censure 2.001. - Retour texte
(3) Au 1er Acte, sc. 1 du Siegfried
de Wagner, il les étrangle. - Retour
texte
(4) Siegfried a tué les frères
Schilbung et Nibelung. Chez Wagner et dans le film de Gentilomo,
il tue seulement le fourbe Mime, qui ne l'a élevé
que pour le trahir. - Retour texte
(5) La Chanson des Nibelungs
(traduite du moyen haut allemand, présentée et
annotée par Jean AMSLER), Fayard, 1992, p. 8. - Retour
texte
(6) R. Wagner s'est également
inspiré d'œuvres telles que la tragédie en
sept actes d'Hans SACHS, Siegfried à la peau de corne
(1557). - Retour texte
(7) La Saga de Théodoric
de Vérone (traduite du norrois par Claude Lecouteux),
Paris, Honoré Champion éd., 2001. - Retour
texte
(8) Dans les Eddas islandaises,
la princesse des Giukungs (Burgondes) se nomme Gudrun (Kriemhilde)
et sa mère est Griemhild (Ute, dans la version allemande
du XIIe s.).
Dans la Tétralogie de Wagner, c'est Hagen qui remet le
philtre à Krimhilde. - Retour texte
(9) Lucien MUSSET, Les invasions.
Les vagues germaniques, P.U.F., coll. «Nouvelle Clio»,
1965, p. 112, note 1. - Retour texte
(10) Dietrich de Bern, c'est-à-dire
le roi Ostrogoth Théodoric de Vérone, Théodoric
le Grand «exilé à la cour d'Attila»,
qui règnera sur l'Italie de 474 à 526 - syncrétisme
des poètes... - Retour texte
(11) Encyclopædia Universalis
(c) 1995. - Retour texte
(12) Jacques BENOIST-MÉCHIN,
Frédéric de Hohenstauffen ou le rêve
excommunié (1194-1250). - Retour
texte
(13) ... qu'il récupéra
sans effusion de sang en signant avec le sultan Al-Khamil le
traité de Jaffa (18 février 1229). - Retour
texte
(14) R. WAGNER, Mes Œeuvres,
Corréa éd., 1941, p. 234. - Retour
texte
(15) E. Schuré, Souvenirs
sur Richard Wagner, cité par A. CŒUROY, Wagner
et l'esprit romantique, Gallimard-NRF, 1965, pp. 243-244.
- Retour texte
(16) Wölfing. Jeu de mot avec
Wälse; Siegmund est un Wälsung (Vœlsung). - Retour
texte
(17) Ce passage a suscité
les commentaires de K. Marx et F. Engels. Selon Engels (1884),
le premier stade d'organisation familiale est la «famille
consanguine», où «les groupes conjugaux
sont séparés suivant les générations
: dans les limites de la famille, tous les grands-pères
et les grand-mères sont entre eux maris et femmes; de
même leurs enfants, autrement dit les pères et
les mères dont les enfants, à leur tour, formeront
un troisième cercle d'époux communs, et les enfants
des enfants, autrement dit les arrière-petits-enfants
des premiers, formeront le quatrième cercle. Dans cette
forme de famille, les droits et les devoirs (dirions-nous) du
mariage sont donc exclus seulement entre ascendants et descendants,
parents et enfants. Les frères et les sœurs, les
cousins et les cousines du premier, du second et des autres
degrés sont tous entre eux frères et sœurs,
et c'est justement pourquoi ils sont tous maris et femmes les
uns des autres. Le rapport de frère et sœur inclut
tout naturellement, à cette période, l'exercice
du commerce sexuel entre eux.» Et de préciser
en note :
«Dans une lettre écrite au début de 1882,
Marx s'exprime dans les termes les plus virulents au sujet du
texte des Nibelungen de Wagner, qui falsifie complètement
les temps primitifs. «A-t-on jamais ouï que le
frère embrassât la sœur comme son épousée
?» A ces dieux de luxure wagnériens qui, d'une
façon toute moderne, donnent par un brin d'inceste plus
de piquant à leurs intrigues amoureuses, Marx répond
: «Dans les temps primitifs, la sœur était
la femme, et c'était moral.» [...] Un de mes
amis français, admirateur de Wagner, n'est pas d'accord
avec cette note et fait observer que déjà dans
l'antique Edda sur laquelle s'appuie Wagner, Loki, dans
Œgisdrecka, fait à Freia ce reproche : «Devant
les dieux, tu embrassas ton propre frère.»
Le mariage entre frère et sœur aurait donc été
déjà proscrit à cette époque. L'Œgitdrecka
est l'expression d'une période où la foi dans
les anciens mythes était complètement brisée;
c'est une pure satire contre les dieux, à la manière
de Lucien. Si Loki, jouant le rôle d'un Méphisto,
y fait à Freia semblable reproche, c'est plutôt
un argument contre Wagner. Quelques vers plus loin, Loki, s'adressant
à Niördhr, dit encore : «C'est avec ta sœur
que tu as engendré un (tel) fils (vidh systur thinni
gastu slikan môg).» Niördhr n'est pas un
Ase, mais un Vane, et dit dans la Ynglinga Saga que les
mariages entre frères et sœurs étaient d'usage
en Vanaland, ce qui n'était pas le cas chez les Ases.
Ceci indiquerait que les Vanes seraient des dieux plus anciens
que les Ases. En tout cas, Niördhr vit parmi les Ases,
sur un pied d'égalité, et l'Œgisdrecka
est plutôt une preuve qu'au temps de la formation des
légendes norvégiennes sur les dieux, le mariage
entre frère et sœur, du moins chez les dieux, ne
provoquait encore nulle horreur.» (Source : Bibliothèque
de sciences sociales de l'Université
de Québec.) - Retour texte
(18) Il le sera par le christianisme.
- Retour texte
(19) Dans La Walkyrie c'était
l'inverse : la lance de Wotan brisait Notung. - Retour
texte
(20) Rappelons que dans la version
wagnérienne, Siegfried ne s'est point baigné dans
le sang de Fafner, mais a reçu les enchantements de Brünnhilde.
- Retour texte
(21)Cf. H. JEANMAIRE, Couroï
et Courète, Univ. Lille, 1939, pp. 556-558; E. HAMILTON,
Mythologie, Marabout Université, pp. 379-380;
Cl. LECOUTEUX, Dict. Mythol. germanique, p. 211, s.v.
«Svanhildr». - Retour texte
(22) Il en existe une traduction
française dans Regis BOYER, La saga de Sigurd ou la
parole donnée, Paris, 1989, pp. 187-280. - Retour
texte
(23) A l'origine : le personnage
de Théodoric le Grand (ca 455-526; roi d'Italie
en 474), le grand roi ostrogoth. La Chanson des Nibelungs
en a fait un vassal d'Attila, quoiqu'il lui soit nettement postérieur...
- Retour texte
|
| |
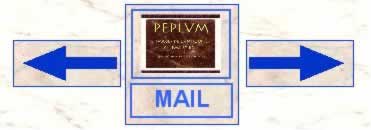 |
|