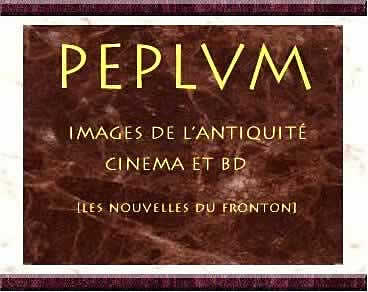 |
| |
| |
De La Chute de l'Empire romain
à Gladiator
Page 5/16
|
|
| |
|
| |
III.
ANNEXES
7. A propos de la bataille contre
les Germains dans Gladiator
7.1. La disposition des troupes
Tout démarre dans les fossés d'un castrum
en Germanie. Les abords déboisés, napalmisés.
Les légionnaires prêts pour la der des der
: la sublime musique de Hans Zimmer y invite. Ses circonvolutions
évoquent un proche passé sans cesse revécu.
«Croyez-vous qu'on va se battre, général
?» demandent les hommes, tendus. Russell Crowe, alias
le général Maximus, rassure. Oui, il y aura bataille...
La dernière, sans doute. Il l'espère. Tout le monde
est boueux, crasseux, las... mais déterminé, exaspéré.
«Les hommes devraient savoir quand ils sont vaincus»,
murmure un tribun, reprochant aux Germains leur obstination. «Le
saurais-tu, toi, Quintus
?, rétorque le général. Le saurais-je,
moi ?» Une possible allusion au Viêt-nam. Perhaps
! Plus probablement à Tite-Live lorsqu'il expose que
les Romains finirent par remporter la Seconde Guerre Punique,
malgré 50 pour cent de pertes simplement parce qu'ils étaient
mentalement incapables de se reconnaître comme vaincus.
Tant qu'un Romain conserverait un souffle de vie, Rome se battrait
! Et puis arrive la réponse des barbares. «Ils
ont dit : non !» Leurs cris de défi scandés
rappellent ceux des Zoulous dans le film homonyme de Cy Endfield...
«Patres !», commence Maximus - «Fratres
!» eut mieux convenu (1).
Erreur de sous-titrage ? Le général évoque
les Champs-Elyséens où les cavaliers romains ne
manqueront pas de chevaucher... s'ils mouraient. C'est un mythe
des Indiens des Plaines que de chevaucher au pays des chasses
éternelles. Indien, donc Américain. Pas Romain...
Et puis tout explose. Maximus a déchaîné les
Enfers... Les projectiles incendiaires transforment en brasier
la lisière de la forêt où se tiennent les
barbares. On songe à ces hélicoptères diffusant
du Wagner à tue-tête dans Apocalypse Now tout
en exterminant joyeusement ce village au bord du Mékong.
Douze cents figurants et cascadeurs ont participé à
la bataille opposant Romains et Germains, tournée dans
la forêt de Farnham, près de Londres; l'infographie
les a multipliés. Il semble néanmoins évident,
pour le spectateur attentif, que Ridley Scott a en fait dû
se débrouiller avec ce qu'il avait. Il est loin le temps
béni où Stanley Kubrick pouvait déployer
7.000 figurants de l'armée espagnole, rangés en
dix cohortes de six cents hommes (Spartacus).
Dans La chute de l'Empire romain, les légions se
déployaient par cohortes au pied de la forteresse romaine,
avant de s'engager dans la forêt devant eux, au bas de la
butte. La forêt où se tapissaient les Barbares. C'est
en somme la même idée qu'exploite Gladiator,
mais avec un traitement différent : la forteresse est réduite
à un talus, le paysage est complètement ravagé
et il y a cette fois des catapultes et des projectiles incendiaires.
Enfin il y a une préférence nettement marquée
pour les plans moyens et les gros plans sur la troupe.
Donc, la scène se passe au pied du talus délimitant
un camp romain (sans fossé, mais alors d'où provient
l'élévation de terre ?), hérissé de
pieux pointus (2).
Un large périmètre autour du camp a été
déboisé par brûlis.
Sorti de la forêt en face, où se terrent les Barbares,
un cavalier romain va mettre de nombreuses secondes à le
traverser au galop, si bien que - compte tenu du «temps
cinématographique» toujours plus synthétique
que le temps réel - l'on peut évaluer cet espace
à plus de 300 m (disons 400 m). Sur l'écran, la
déclivité de la colline donne une impression trompeuse,
raccourcissant la distance...
7.1.1. Le tournage
Initialement, la bataille (3)
devait être filmée près de Bratislava en Slovaquie,
quasiment sur les lieux de l'action, et avec des coûts minimes.
Effrayé par la lourdeur logistique de la scène,
Scott finit par se trouver une forêt adéquate en
Grande-Bretagne, à Farnham dans le Surrey.
Directeur de la figuration, Rob Martin disposait d'un peu plus
de 700 figurants recrutés dans la région, pour la
plupart des étudiants. Ceux qui avaient des cheveux longs
étaient d'office costumés en Germains. Il y avait
250 «Germains», 300 «légionnaires»,
100 «archers» et environ 80 cavaliers. Soit suffisamment
de monde pour emplir l'écran dans les plans rapprochés;
dans les plans larges, ils sont multipliés par l'infographie.
C'est ainsi que les deux catapultes devinrent six. Quelques 16.000
flèches incendiaires, outre celles infographiées,
et 2.500 glaives, haches et lances furent nécessaires pour
un tournage de quatorze heures par jour, qui démarraient
à 5h 30' du matin.
Les combats furent réglés par le maître
d'armes Nicholas Powell. Neil Corbould et Phil Neilson, superviseur
des effets spéciaux de plateau dirigèrent le tournage,
coordonnant trois équipes : la première organisait
la bataille, dirigée par Ridley Scott et le directeur de
la photo Richard Mathieson; Alexander Witt et la seconde filmaient
les plans de coupe; la troisième, celle du superviseur
des effets visuels John Nelson, pour les plans d'ensemble.
Tim Burke, superviseur, Nikki Penny, productrice et Emma Norton,
coordinatrice assuraient la liaison entre le plateau et l'équipe
infographique de Londres (Mill Film). Il s'agissait d'obtenir
:
| 1) |
les panoramas ou plans larges filmés de différents
points de vue en Vistavision, dans lesquels on pourrait injecter
la figuration virtuelle et ainsi décupler les armées
en présence; |
| |
|
| 2) |
faire lancer par les lourdes catapultes reconstituées
sur le plateau par Clifford Robertson des pots de bitume enflammés...
virtuels, et leurs impacts en 2D; |
| |
|
| 3) |
emplir le ciel de flèches enflammées en 3D
et autres effets pyrotechniques comme les explosions créées
par les conduites de gaz conçues par Neil Corbould.
Des câbles, effacés par la suite, tiraient brusquement
en arrière les cascadeurs quand était censée
tomber sur eux la pluie des flèches numérisées. |
7.1.2. Les archers romains
Cinématographiquement parlant, la bataille est l'un des
temps forts du film, en particulier l'attente, puis l'assaut -
le final étant malheureusement gâté par l'abus
d'effets spéciaux, ralentis et autres bricolages infographiques.
Pourtant, son déroulement nous paraît discutable
sur le plan de la tactique : les archers ont été
placés en seconde ligne, derrière les légionnaires.
De concert avec les balistes ils tirent des traits incendiaires
en direction de la forêt, avec l'intention de l'embraser
et de couper toute possibilité de retraite aux barbares.
C'est une conception américaine qui fleure bon les napalmages
de la guerre du Viêt-nam, mais qui est tout de même
assez absurde en 180 de n.E. La portée des arcs étant
ce qu'elle était - soit moins de cent mètres (portée
optimale) et moins de deux cents mètres (portée
maximale) (4).
Par ailleurs, les flèches incendiaires se lançant
avec un arc détendu pour éviter que le souffle dû
à un tir trop brutal ne les éteigne, on ne voit
pas très bien à quoi rime cette débauche
d'effets pyrotechniques. Certes, certaines descriptions comme
celle que Tite-Live fait de la phalarique des Sagontins, autorisent
ce genre de représentation : «Les Sagontins avaient
une sorte de trait qu'ils nommaient falarique, dont la hampe,
de bois de sapin, était cylindrique dans toute sa longueur,
à l'exception du côté d'où sortait
le fer. Carré comme dans notre pilum, le fer était
garni d'étoupe et enduit de poix: il avait trois pieds
de long, pour qu'il pût transpercer l'armure et le corps.
Mais, lors même que la falarique se serait arrêtée
sur le bouclier sans pénétrer jusqu'au corps, elle
répandait encore l'effroi, parce qu'on ne la lançait
qu'embrasée par le milieu, et que le mouvement seul donnait
à la flamme une telle vivacité que le soldat, contraint
de jeter ses armes, était exposé sans défense
aux nouveaux coups qui pouvaient l'assaillir» (TITE-LIVE,
Ab urbe condita, XXI, 8). Mais encore faut-il savoir dans
quel contexte on les utilisait. (Assiégés par Hannibal,
les Sagontins du haut de leurs murailles balançaient les
phalariques sur un adversaire rapproché.)
Par ailleurs, c'est peu romain de placer les archers derrière
les légionnaires : ils eussent dû les précéder
en tirailleurs, lancer quelques volées de traits, et puis
se replier derrière les cohortes d'infanterie lourde. Le
plan général pris de derrière la légion
et embrassant tout le panorama de la forêt strié
par la trajectoire infographique des projectiles enflammés,
pour spectaculaires que soient les images, ne convaincra pas le
spectateur un peu critique et au courant des armes et de la tactique
(5).
Par comparaison, rappelons que l'issue de la
bataille de Gettysburg aurait pu être différente
si elle s'était déroulée en 1861 plutôt
qu'en 1863. En 1861, Nordistes et Sudistes utilisaient des fusils
à canon lisse (seuls les Nordistes possédaient des
compagnies de tireurs d'élite, les sharpshooters,
armés de fusils à canon rayé). Mais, dès
1862, la plupart des régiments de l'Union étaient
pourvus de fusils à canon rayé, arme idéale
pour la défensive comme ce fut le cas pour eux à
Gettysburg. En effet, le fusil à canon rayé de l'époque,
Endfield cal. 58 ou Springfield cal. 577, avait une portée
optimale de 3 à 400 m (pour les tireurs d'élite,
800 m), alors que le canon lisse n'avait qu'une portée
de 250 m (portée optimale : 80 m).
Lorsque le 3 juillet 1863, la division d'infanterie du général
Pickett monta à l'assaut des Fédéraux retranchés
sur Cementery Ridge, il lui fallut marcher deux kilomètres
sous les tirs des canons yankees, que les Confédérés
n'avaient pas réussi à faire taire, et des fusils
à canon rayé qui pouvaient tirer trois coups à
la minute et portaient plus loin. Les Sudistes s'ébranlèrent
au pas, marchèrent 1.800 m, puis à 200 m de l'ennemi
s'élancèrent au pas redoublé, et enfin au
pas de charge les quatre-vingt derniers mètres (25").
La charge dura donc une demi-heure, et les 14.000 hommes qui y
participèrent, après avoir laissé sur le
terrain les deux tiers de leur effectif, furent repoussés.
Le général Lee était stoppé sur la
route de Washington et perdait tout espoir de donner la victoire
au Sud et d'ainsi abréger de deux ans la guerre civile
(6).
Ce que nous voulons dire par cet exemple, c'est que chaque bataille
se gagne ou se perd selon les moyens de son époque. Les
balistes et les scorpions ne portent pas à un kilomètre,
encore moins les archers qui ne sauraient tirer par-dessus les
cohortes mais au contraire sont voués à les précéder.
En fait, la disposition exacte des archers,
dans le film, est la suivante : une première cohorte est
alignée au pied d'un talus hérissé de branchages
aiguisés. Au sommet du talus, les archers - sur une seule
ligne - ont tracé à leurs pieds une rigole contenant
du pétrole enflammé. Ils tirent, donc, par dessus
les troupes de première ligne qui sont en dessous d'eux.
Et derrière les archers, s'aligne sur 3 ou 4 rangs une
seconde cohorte de légionnaires. Comment ces derniers avanceront-ils
? Comment descendront-ils - et en bon ordre - du talus par définition
impraticable, puisque hérissé de branches pointues
(cippi), racines, etc. ? C'est impossible. Dans la logique
de la tactique romaine, la seconde ligne - la seconde cohorte
- est censée suivre et relever la première. Et non
bien sagement se retrancher sur un agger (talus) en attendant
que ça se passe (7).
7.1.3. Armures, casques, boucliers romains
Les armes romaines sont parfois quelque peu fantaisistes. Ainsi
l'armure du général Maximus, qui est un hybride
de la cuirasse musclée (thorax) des officiers supérieurs
avec les protège-épaules de la lorica segmentata
de l'homme de troupe; par ailleurs, la précitée
lorica segmentata (à bandes de métal articulées),
particulière à l'infanterie, n'était pas
en usage dans la cavalerie qui préférait les cottes
de mailles...
Les cuirasses ont été reconstitués avec
soin, mais sans se soucier de l'authenticité des matériaux
: c'est d'abord le confort des acteurs et la liberté de
leurs mouvements qui ont compté. L'armure de Commode, par
exemple, était en caoutchouc recouvert de cuir pour plus
de malléabilité. Celle de Maximus, en mousse de
latex également recouverte de cuir. Ces armures furent
reproduites à plusieurs dizaines d'exemplaires, histoire
d'habiller les cascadeurs qui doublaient les acteurs pendant les
scènes d'action les plus dangereuses. Chaque costume existait
en plusieurs versions : propre, boueux, déchiré,
maculé de sang, pour pouvoir raccorder facilement avec
des scènes tournées auparavant.
Si l'on n'y regarde pas trop près, les casques
des légionnaires avec leur large couvre-nuque peuvent faire
illusion. Pourtant, aux Ier et IIe s., la visière de tous
les casques romains - qu'il s'agisse des types celtiques «toque
de jockey» et «impérial gaulois» ou du
type italique «Montefortino», et leurs dérivés
- est rapportée au sommet du front, et ne prolonge jamais
le bord.
La grille de protection du visage en moins, les casques du film
ne sont pas sans rappeler les pots «queues de homard»
(8)
portées par les «Côtes de Fer» de Crowmwell,
lors de la Guerre civile anglaise !
Par contre, les boucliers sont superbes : des scuti
parfaitement quadrangulaires, d'un modèle qui apparut vers
40-50 de n.E. et demeura en usage jusqu'en 200 (9).
Leur motif décoratif s'inspire de celui figuré sur
la stèle funéraire de Gnæus Museus (Mayence),
repris par les membres du groupe de reconstitution germano-américain
de Dan Peterson, la Legio XIV Gemma Martia Victrix (10)
- mêmes couleurs, mais les foudres en moins. |
| |
7.2.
Prélude crescendo
La novélisation de Dewey Gram, tirée du scénario
de D. Franzoni, restitue parfaitement les images qui ouvrent le
film : «Traînant la main pour sentir les grains
gorgés de soleil s'éparpiller entre ses doigts,
il [Maximus] s'enfonça dans un luxuriant champ de
blé. L'homme contempla les collines sur lesquelles serpentait
la route menant à une ferme entourée de cyprès
blancs, de pommiers et de poiriers. Un rire d'enfant jaillit non
loin de là. Dans un frémissement, un rouge-gorge
dodu se posa sur la branche d'un pin, la tête inclinée
comme pour lui demander : «Que fais-tu là ?»»
Contre-champ de la camera. Retour à la réalité.
La vision du périmètre guerrier contraste par son
horreur. «Le rouge-gorge survolait un paysage carbonisé,
complètement dévasté. Les souches noircies
d'arbres déracinés jonchaient une étendue
tellement labourée par la guerre qu'elle en était
devenue un véritable bourbier. Cette terre conquise n'était
plus rien qu'un amas de fange et de sang. Il n'y restait plus
un brin d'herbe, plus une feuille (11).»
D'entrée en matière, Ridley Scott va faire très
fort, avec cette bataille contre les Germains, superbe de puissance
et d'émotion. Son chien sur les talons, le général
Maximus déambule parmi ses hommes, fatigués mais
prêts à en découdre une fois de plus, pleins
de respect et de dévotion pour leur chef : «Vous
croyez qu'ils vont attaquer, général ?»
Pensif, il suppute les risques. «Les catapultes ? Un
risque acceptable, pour la cavalerie.» Cette cavalerie
dont il va lui-même prendre la tête, pour exécuter
le mouvement de tenailles qui mettra l'ennemi à sa merci.
Un tape affectueuse à un vétéran reconnu
parmi d'autres légionnaires. Tout est en place...
7.3. La danse du feu
«A mon signal, déchaînez des enfers»,
enjoint-il à son commandant-adjoint.
Les images qui suivent
alors puiseront sans complexe «dans l'imaginaire collectif
du monde moderne», comme le fera observer Fabrizio Pesando
(12)
faisant référence à l'«effet Pompéi»
qui, dans tout péplum qui se respecte, se doit de dépeindre
à grands renforts d'effets pyrotechniques les cataclysmes
de l'Antiquité, de l'incendie de la Rome néronienne
à la biblique malédiction de Sodome et Gomorrhe.
«Dans ce cas précis, les détails ne sont
pas particulièrement anachroniques par rapport à
la reconstruction historique», ajoute F. Pesando. L'artillerie
nervobalistique mise en œuvre par la légion romaine
aligne des reconstitutions plus ou moins fidèles d'armes
qui ont réellement été utilisées,
comme les lithoboles, ces pierriers lanceurs de boulets
garnis de poix enflammée, ou comme les grandes arbalètes
lanceuses de traits, les scorpions - tous engins notamment décrits
par Vitruve, qu'au XIXe s. reconstitua le capitaine d'artillerie
prussien Erwin Schramm. «Mais l'effet de ce bombardement,
lui, suggère une scène moderne : les flèches
incendiaires décochées par les arcs ou les boules
de feu qui sèment la panique dans les files des barbares
reproduisent les scènes auxquelles nous ont habitués
les correspondances de guerre, avec un ciel traversé par
des balles traçantes et un paysage dévasté
par les explosions (13).»
7.4.
Crépuscule wagnérien
Dans ses interviewes, Ridley Scott a raconté comment
il avait obtenu la concession d'un lopin de terre à
déboiser, ce qu'il entreprit consciencieusement à
coups d'effets pyrotechniques appuyés par l'infographie.
Pour incarner les légionnaires, il avait recruté
quelque 300 étudiants - que les informaticiens
démultiplièrent à l'écran -
qu'il fit encadrer par des re-enactors du groupe
britannique de reconstitution III Augusta. Pourtant,
malgré le concours de ces spécialistes de
la tactique romaine, la bataille du film accumule les invraisemblances.
Nous avons déjà évoqué la question
de la portée des catapultes et des arcs, l'efficacité
des flèches incendiaires et, enfin, l'emplacement
des archers par rapport aux légionnaires. En voici
quelques autres : |
- bizarre la rigole creusée dans le sol, où
l'on verse du pétrole ou de la naphte, pour que
les archers puissent y enflammer leurs traits;
- les cohortes romaines sont adossées à
leurs propres défenses de talus hérissés
de pieux, s'interdisant ainsi toute possibilité
de recul;
- les légionnaires forment la tortue (tactique
de siège) en rase campagne et utilisent comme arme
d'estoc leur pilum, arme de jet !
Lors du troisième affrontement dans la plaine de
Laumes contre l'armée de secours gauloise, les
légionnaires firent la tortue pour se défendre
contre les flèches, pierres et javelots ennemis
(CÉSAR, G.G., 85. 5), mais ils étaient
alors en position défensive. La position offensive
consiste à charger et, arrivés à
portée, balancer les pilums, ce qui demande de
la place pour le mouvement de balancier du bras : donc
est impossible à combiner avec la tortue, formation
serrée;
- étonnants aussi, ces cavaliers qui, tout au long
du film, brandissent des enseignes de tout genre comme
de vulgaires lances. Quatre enseignes pour une patrouille
de six cavaliers ! Pour faire joli, sans doute...
- et ces fantassins, le soir, la bataille finie, qui
n'ont pas débouclé leur armure. On peut
les plaindre ! Mais il faut que le spectateur puisse immédiatement
les identifier comme étant des légionnaires
romains, alors...
(Notons que lors de cette paisible scène festive,
Hans Zimmer a eut la bonne idée d'insérer
une composition du groupe musicologique Synaulia,
qui étudie les techniques de l'Antiquité.)
|
| Arrêtons-nous là.
Il y a ce que nous savons des tactiques romaines, et il y
a le reste. Après tout, Jules César n'a pas
toujours construit ses camps bien rectangulaires, comme le
veut la règle (en fait, l'ordonnancement rectiligne
des camps romains lui est bien postérieure). Les légions,
de toute façon, devaient savoir s'adapter au terrain.
Et les cinéastes aux impératifs de l'«entertainement». |
7.5. La chevauchée des
Walkyries
«Et si vous vous retrouvez tout seul dans un champ verdoyant,
n'en soyez pas étonnés - assure Maximus, qui
parle en connaissance de cause (14).
C'est que vous avez atteint l'Elysée... et vous êtes
morts.» Nous avons gardé pour la fin l'étonnante
charge de la cavalerie romaine qui contourne les Germains, les
prenant à revers... en pleine forêt ! Une charge
de cavalerie à travers bois est de la plus haute improbabilité
(15).
Nous nous sommes interrogés sur ce qui avait pu amener
les cinéastes à mettre en scène une prouesse
aussi aberrante, lorsque feuilletant une histoire des guerres
de l'Antiquité, nous sommes tombés devant un schéma
explicatif de celle livrée en +16 à Idistaviso par
Germanicus,
qui y infligea une sévère défaite au Chérusque
Arminius. |
|
| 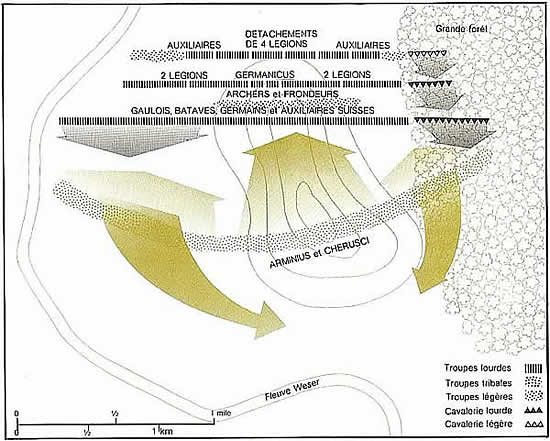
La bataille d'Idistaviso
et l'improbable mouvement de la cavalerie romaine à
travers bois (John WARRY, Histoire des guerres de l'Antiquité,
Bordas, 1981, p. 192)
La fameuse bataille d'Idistaviso,
dans une boucle de la Weser, prélude à l'anéantissement
d'Arminius, roi
des Chérusques, par Germanicus
en 16 de n.E. Le centre des Germains est sur une colline
entre le fleuve et la forêt; ses ailes s'étirent
à flanc de coteau. Ils sont de 40 à 50.000
hommes, dont un peu de cavalerie légère. Leur
faisant face, au nord, 1.000 prétoriens et des éléments
de huit légions romaines, estimés à
28.000 h, et 30.000 auxiliaires gaulois, bataves, germains
et helvètes. L'aile gauche des Romains (à
droite sur le plan) est constituée de 4-6.000 cavaliers
lourds et 1-2.000 cavaliers légers (archers montés).
On notera que le dessinateur Clive Sprong a bien placé
les archers et frondeurs devant les légionnaires,
mais derrière l'infanterie lourde des auxiliaires.
L'infanterie gauloise et batave, suivie de deux légions,
va envelopper les Chérusques, à gauche sur
le plan; la cavalerie romaine va charger à travers
bois, à droite sur le plan... sauf que le récit
de Tacite ne dit pas que la cavalerie romaine chargea à
travers bois - seulement que l'aile droite des Germains
se dissimulait en sous-bois. Cette bataille à la
configuration classique semble avoir inspiré celle
qui ouvre Gladiator (extr. John WARRY, op.cit.) |
|
| |
En fait, la bataille d'Idistaviso
(16)
(TAC., An., II, 15-18) se déroula en deux phases,
séparées par un laps de temps indéterminé
(quelques jours), puisqu'elle fut assez rapidement suivie d'un
second engagement avec les barbares, lesquels - retraitant vers
l'Elbe - s'étaient reformés dans le Hanovre, près
du mur des Angrivariens (TAC., An., II, 19-22). C'est-à-dire,
vraisemblablement au sud du lac Steinhud, à une trentaine
de kilomètres au nord d'Idistaviso (17).
7.5.1. Les champs d'Idistaviso
Imaginez une plaine étroite entre la forêt et une
boucle de la Weser. «C'est une plaine située entre
le fleuve et des collines; d'une inégale largeur, elle
s'étend ou se resserre suivant les sinuosités du
fleuve et les saillies de la montagne. Derrière s'élevait
un bois de haute futaie, dont les arbres laissaient entre eux
la terre dégarnie.» Il y a au centre une colline,
où ont pris position les Chérusques; leurs alliés
s'étirent de part et d'autre sur leurs ailes : jusqu'au
fleuve d'un côté, jusqu'à la forêt de
l'autre, où ils se sont partiellement engagés (pour
empêcher les Romains de tourner leur position ?). Des marécages
enserrent complètement la forêt, coupant la retraite
aux 40 ou 50.000 Germains, qui n'ont d'autre ressource que vaincre
ou mourir.
Le fleuve excepté, et aussi le fait que ce soient les
Romains qui sont adossés aux palissades de leur castrum
(alors que dans le second combat au Steinhude Meer, ce seront
les Chérusques qui se rangeront sous le mur des Angrivariens
[18]),
tout est bien comme dans le film, à quelques nuances près,
que nous examinerons. Tacite décrit le dispositif romain,
sur trois rangs : «Les auxiliaires gaulois et germains
en tête; ensuite les archers à pied; puis quatre
légions, et Germanicus avec deux cohortes prétoriennes
et un corps de cavalerie d'élite; enfin autant d'autres
légions, l'infanterie légère et les archers
à cheval, avec le reste des cohortes alliées»
(TAC., An., II, 16). John Warry en donne l'évaluation
numérique suivante : 1.000 prétoriens; 28.000 légionnaires
(éléments de huit légions); 30.000 auxiliaires
gaulois, rhètes et vindéliciens; 4 ou 6.000 alliés
germaniques (dont les Chauques, qui délibérément
laisseront fuir Arminius vaincu); 6.000 cavaliers lourds et mille
ou deux mille archers montés (19).
Les Romains disposent en outre de catapultes, engins lanceurs
de traits (et sans doute aussi de boulets).
Le plan hypothétique de la bataille d'Idistaviso
publié dans l'ouvrage de J. Warry (loc. cit.) place
les trois lignes romaines dans l'ordre décrit par Tacite,
mais nous ignorons en fait ce qui du fleuve ou de la forêt
se trouvait sur le flanc droit ou gauche des Romains. J. Warry
place la totalité de la cavalerie romaine sur la gauche
des Romains et la fait chevaucher à travers la lisière
de la forêt. |
| |
|
| |
Lancer la cavalerie à travers
la «forêt» est une faute tactique, et du reste
le texte de Tacite ne suggère nulle part que les Romains
firent une chose semblable. Dans sa harangue préliminaire,
Germanicus fait
observer à ses légionnaires que si les Romains excellent
à combattre en terrain découvert, ils ne seront
pas pour autant défavorisés en terrain boisé
: leurs armes courtes (glaive, pilum) leur procurent un avantage
certain sur les longues épées des Germains (TAC.,
An., II, 14). A propos du second combat, celui du lac Steinhud,
l'historien romain notera que les Chérusques avaient dissimulé
leur cavalerie sous le couvert des arbres, dans l'espoir de prendre
les légionnaires à revers (TAC., An., II,
19), mais il est clair qu'à Idistaviso, ceux des Romains
qui chargèrent dans la forêt étaient, de toute
évidence, des fantassins.
Tacite, en fait, décrit un mouvement d'enveloppement
: «Germanicus, voyant les bandes des Chérusques
s'élancer, emportées par leur ardeur, commande à
ses meilleurs escadrons d'attaquer en flanc, tandis que Stertinius,
avec le reste de la cavalerie, tournerait l'ennemi et le chargerait
en queue : lui-même promit de les seconder à propos.
En ce moment, huit aigles furent vus se dirigeant vers la forêt,
où ils pénétrèrent. Frappé
d'un augure si beau, Germanicus crie aux soldats «de
marcher, de suivre ces oiseaux romains, ces divinités des
légions.» Aussitôt l'infanterie se porte
en avant; et déjà la cavalerie enfonçait
les flancs et l'arrière-garde» (TAC., An.,
II, 17). Germanicus, donc, commande l'aile la plus exposée,
côté forêt, puisque c'est à son légat
Seius Tubero qu'il a confié l'infanterie côté
plaine et la cavalerie. Une partie de la cavalerie de Tubero
(20)
attaque les Chérusques de flanc, tandis qu'ainsi couvert
L. Stertinius (21), continuant
sur sa lancée, dépasse l'ennemi puis se rabat sur
ses arrières.
La belle charge de cavalerie en sous-bois que mène Russell
Crowe-Maximus est une hérésie tactique. A Waterloo,
Napoléon jugea Wellington piètre général
car il avait adossé à la forêt de Soignes
ses carrés d'infanterie ! La forêt est, par excellence,
le lieu impraticable même pour des formations d'infanterie
qui se battent épaule contre épaule (22).
Et pendant la Guerre civile américaine où souvent
les fantassins se fusillèrent en sous-bois, jamais on n'y
engagea la cavalerie... Tombés dans une embuscade entre
marais et marécage où ils ne peuvent se déployer
selon la tactique légionnaire, les soldats de Varus - exceptionnellement
- furent bien obligés de combattre de la façon décrite
par le film. Et voici en quels termes Dion Cassius rapporte la
chose : «Mais les revoici de nouveau dans les bois, où
ils subissent leurs pertes les plus lourdes en tentant de se défendre
contre leurs assaillants : ils ne disposent que d'un espace étroit
pour former leurs lignes, afin que la cavalerie et l'infanterie
puissent ensemble réduire l'ennemi, se gênant mutuellement
ou entrant en collision avec les arbres» (DION CASSIUS,
LVI, 21).
7.5.2. Steinhude Meer
A Idistaviso, les Germains qui, au départ, jouissaient
de l'avantage stratégique d'occuper la colline au centre
de la plaine, furent enveloppés de toutes parts. Bientôt
ils lâchèrent pied : ceux qui étaient dans
la plaine cherchèrent le couvert des bois, croisant ceux
de la forêt qui en jaillissaient, espérant pouvoir
franchir la Weser à la nage. Les formations germaniques
disloquées, les archers romains tranquillement criblèrent
de flèches les fuyards, tirèrent à la cible
les nageurs et ceux qui se s'étaient réfugiés
dans les hautes branches des arbres...
Les Chérusques en déroute fuirent vers l'Elbe, ralliant
leurs dernières forces : des enfants, des vieillards prirent
les armes. Alors eut lieu une seconde bataille, que les historiens
modernes localisent sur les bords du lac Steinhud. Ils se regroupèrent
à plusieurs dizaines de kilomètres d'Idistaviso,
talonnés par les Romains. Tacite décrit rapidement
leur situation : «L'infanterie se rangea sur cette chaussée
[le mur des Angrivariens]; la cavalerie se cacha dans les bois
voisins pour prendre nos légions à dos lorsqu'elle
seraient engagées dans la forêt» (TAC.,
An., II, 19). Entendons bien que la cavalerie des Germains
est cachée dans le bois, mais qu'elle n'a pas chargé
à travers bois.
Mais Germanicus a été informé des intentions
d'Arminius. Aussi, «il charge le légat Seius Tubero
de la cavalerie et de la plaine; il disposa les fantassins
de manière qu'une partie entrât dans la forêt
par le côté où le terrain était plat,
tandis que l'autre emporterait d'assaut la chaussée.
Il prend pour lui-même le poste le plus périlleux,
et laisse les autres à ses lieutenants. Le corps qui
avançait de plain-pied pénétra facilement.
Ceux qui avaient la chaussée à gravir recevaient
d'en haut, comme à l'attaque d'un mur, des coups meurtriers.
Le général sentit que, de près, la lutte
n'était pas égale; il retire ses légions
un peu en arrière, et ordonne aux frondeurs de viser sur
la chaussée et d'en chasser les ennemis. En même
temps les machines lançaient des javelots, dont les coups
renversèrent d'autant plus de barbares que le lieu qu'ils
défendaient les mettait plus en vue. Maître du rempart,
Germanicus César s'élance le premier dans la forêt
à la tête des cohortes prétoriennes. Là
on combattit corps à corps» (TAC., An.,
II, 20).
«Egaux par la bravoure, les Germains étaient
inférieurs [aux Romains] par la nature du combat
et par celle des armes. Resserrés dans un espace trop étroit
pour leur nombre immense, ne pouvant ni porter en avant et ramener
leurs longues piques, ni s'élancer par bonds et déployer
leur agilité, ils étaient réduits à
se défendre sur place, tandis que le soldat romain, le
bouclier pressé contre la poitrine, l'épée
ferme au poing, sillonnait de blessures leurs membres gigantesques
et leurs visages découverts, et se frayait un passage en
les abattant devant lui» (TAC., An., II, 21).
Ceux qui occupent la «chaussée» des Angrivariens
sont accablés par les balles des frondeurs et les tirs
des balistes. Germanicus, qui a ôté son casque pour
se faire reconnaître de ses hommes, les excite au massacre,
à l'extermination. «Cette victoire fut grande
et nous coûta peu de sang. Massacrés sans relâche
depuis la cinquième heure jusqu'à la nuit, les ennemis
couvrirent de leurs armes et de leurs cadavres un espace de dix
milles. On trouva, parmi les dépouilles, des chaînes
qu'ils avaient apportées pour nos soldats; tant ils se
croyaient sûrs de vaincre» (TAC., An.,
II, 21).
|
| |
|
| Suite… |
|
NOTES :
(1) Claude Aziza
a une amusante explication de la bévue qui fait dire
à Maximus, s'adressant à ses légionnaires,
«Patres» : les sénateurs sont les «pères
conscrits» (patres conscripti)... les conscrits
étant pris pour des soldats, les cavaliers légionnaires
deviennent donc des patres conscripti, ou, pour faire
court, des patres (Cl. AZIZA, L'événement
du jeudi, n 31, 15-21 juin 2000, p. 24). Ingénieux.
Mais nous préférons croire à une banale
erreur de plume du dialoguiste. - Retour
texte
(2) Si l'on avait été
sous les fortifications érigées par Jules César
autour d'Alésia, aucun légionnaire n'aurait pu
se tenir à cet endroit qui n'est que pièges et
chausse-trappes sur près de 200 m. Mais nous sommes deux
siècles plus tard : les Romains étaient-ils toujours
aussi rigoureux dans l'élaboration de leurs ouvrages
militaires ? - Retour texte
(3) SFX, n 83, juin 2000,
pp. XXIV-XXV. - Retour texte
(4) Jean-Nicolas
CORVISIER, Guerre et société dans les mondes
grecs (490-322 av. J-C.), Armand Colin, 1999, p. 20; Robert
HARDY, Le grand arc. Histoire militaire et sociale des archers,
Edita-Denoël, 1977, pp. 137, 141-142, 159 et 163; William
REID, Les armes, Hatier, coll. «Trésors
des mécanismes», pp. 15-16. La portée réelle
de tir est, bien évidemment, une réalité
que même les cinéastes devraient prendre en compte.
Mais Ridley Scott ne reconnaîtra-t-il pas lui-même,
dans le Making of de son film : «La portée
de mes archers était de 200 m, avec l'informatique je
pouvais tirer à 1.000 m ! (...) Je pouvais donner
l'idée de ce que c'était un bombardement par les
Romains...» - Retour texte
(5) Il y a d'ailleurs une faute de
raccord : un plan montre les archers face à une petite
rigole creusée dans le sol, derrière les légionnaires,
dans laquelle l'on fait circuler de la naphte enflammée
où ils peuvent «allumer» leurs projectiles.
Le plan en contre-champ ne laisse pas voir ce petit mur de feu
entre les légionnaires et les archers, qui réapparait
dans les plans suivants. - Retour texte
(6) Cf.
James M. McPHERSON, La Guerre de Sécession (1861-1865)
(1988), R. Laffont, coll. «Bouquins», 1991, pp.
518-519 et 726. - Retour texte
(7) Photo dans Studio, n 157,
juin 2000, p. 78; la même dans American Cinematographer,
mai 2000, p. 36 et [mal cadrée : on ne voit pas la cohorte
du premier rang] SFX, n 83, juin 2000, p. XXVI. - Retour
texte
(8) Répandu vers le milieu
du XVIIe s., ce casque est originaire d'Allemagne où
il était appelé zischägge. La variante
anglaise portée par les soldats de la cavalerie pendant
la Guerre civile de 1642-1648 était connue sous le nom
de pot anglais ou pot «queue de homard».
Elle comporte un masque protecteur (= formé de trois
barres verticales), un couvre-nuque et des garde-joues pivotants.
- Retour texte
(9) Cf. John WARRY, Histoire
des guerres de l'Antiquité, Bordas, coll. Encyclopédie
visuelle, 1981, p. 148, fig. 4. - Retour
texte
(10) Cf. Daniel PETERSON,
La légion romaine hier... et aujourd'hui, Paris,
Histoire & Collection, coll. Europa Militaria, 1992, pp.
16, 47-49. - Retour texte
(11) D. GRAM, Gladiator, J'Ai
Lu, n 5743, 2000, pp. 7-8. - Retour texte
(12) F. PESANDO, «Ombres de
lumière : le cinéma péplum et Pompéi»,
in Da Pompei a Roma. Histoires d'une éruption
(sous la dir. Pietro Giovanni GUZZO), Bruxelles, Europalia-Italia,
2003, pp. 38-49. - Retour texte
(13) F. PESANDO, op. cit.
- Retour texte
(14) Cette phrase en apparence anodine
renvoie au plan d'ouverture du film, qui nous montre le héros
errant parmi les blés mûrs, qu'il flatte du bout
des doigts - lequel film n'est donc qu'un long flash-back.
C'est là ce film de notre vie qui, paraît-t-il,
se dévide dans notre tête à l'instant de
rendre le dernier souffle. - Retour texte
(15) On retrouve la même charge
de cavalerie en forêt dans La chute de l'Empire romain.
- Retour texte
(16) BOUILLET, Dict., identifie
Idistaviso au bord de la Weser avec un lieu qu'il nomme tantôt
Vegesak, tantôt Hasbach. SCHMIDT (Westfäl. Zeitschrift,
XX, p. 301 - cité par MOMMSEN, Hist. rom., Laffont,
«Bouquins», p. 538, n. 1), situe les «champs
d'Idistavisus» près de Bückeburg, à
une dizaine de kilomètres à l'est de Minden, de
l'autre côté de la Weser. - Retour
texte
(17) «Schmidt admet (Westfäl.
Zeitschrift, XX, p. 301) que le premier combat fut livré
près de Bückeburg, aux champs d'Idistavisus et que
le second, à propos duquel on parle de marais, eut lieu
peut-être, près du lac de Steinhud, non loin du
village de Bergkirchen, situé au sud de ce lac. Cette
opinion - observait Mommsen -, n'est nullement inadmissible;
elle sert au moins à éclairer les événements.
Mais ici, comme dans la plupart des récits militaires
de Tacite, il faut renoncer à une certitude complète»
(MOMMSEN, Hist. rom., op. cit., p. 538, n. 1). - Retour
texte
(18) Il s'agissait d'un passage barré
par une «chaussée» édifié par
les Angrivariens voisins, qui leur tenait lieu de frontière
d'avec les Chérusques. «La retraite était
fermée à l'ennemi par le marais, aux Romains par
le fleuve et les montagnes. De part et d'autre la position était
sans issue; le seul espoir était dans le courage, le
salut dans la victoire» (TAC., An., II, 20).
- Retour texte
(19) J. WARRY, Histoire des guerres
de l'Antiquité, Elsevier-Bordas, 1981, p. 192. On
peut supposer qu'il inclut les archers à pied parmi les
30.000 auxiliaires. - Retour texte
(20) Seius Tubero n'est pas nommé
à propos de la bataille d'Idistaviso, mais son nom apparaît
à propos de l'engagement qui suivit juste après.
- Retour texte
(21) L. Stertinius commande toujours
à de la cavalerie et/ou à de l'infanterie légère
(TAC., An., II, 8, 11, 17). Sans doute était-il
le commandement de la cavalerie mixte. Il y a également
un préfet, Pedo, qui semble être le préfet
de cavalerie de Germanicus (TAC., An., I, 40). - Retour
texte
(22) ... il s'agit d'empêcher
les cavaliers ennemis de s'infiltrer dans les rangs des fantassins.
- Retour texte
|
| |
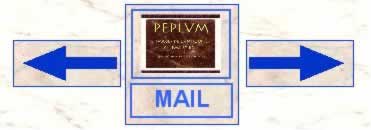 |
|