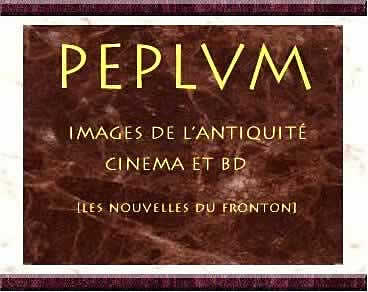 |
| |
| |
De La Chute de l'Empire romain
à Gladiator
Page 7/16
|
|
| |
|
| |
8.3.
Demandez le programme !
| En règle, le programme
des jeux est le suivant : |
| 1) |
venatio la matinée
(ludi matutini). Les bestiaires affrontent
les fauves, souvent dans des décors évoquant
un paysage sauvage. Parfois des scènes de domptage.
D'autres fois, opposition de fauves contre d'autres fauves. |
| 2) |
l'heure méridienne.
A midi ont lieu les exécutions publiques de criminels.
Parfois elles sont intégrées dans des numéros
comiques, des pantomimes mythologiques comme celle d'Icare.
Ses ailes fondues en s'approchant du soleil, «Icare»
propulsé dans les airs par une machine de guerre vient
se fracasser sur la piste. C'est aussi l'heure des «gladiateurs
pour rire», comme les laquearii armés
de lassos et de bâtons. |
| 3) |
L'après-midi ont lieu
les munera. Après un défilé
(pompa), suivi d'exercices d'échauffement avec
des armes de bois, se déroulent les duels proprement
dits, sous le contrôle d'arbitres. |
|
| |
| 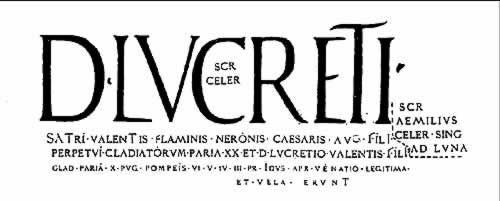
Voici le texte et sa traduction (1)
:
D. Lucreti / Satri Valentis
flaminis Neronis Cæsaris Aug. fili / perpetui gladiatorum
paria XX, et D. Lucretio Valentis fili glad. paria X,
pug. Pompeis VI V IV III pr. idus Apr. venatio legitima
/ et vela erunt [scr. / Æmilius / Celer sing. /
ad luna]
«Vingt paires de gladiateurs
appartenant à Decimus Lucretius Satrius Valens,
flamine perpétuel de Néron César
fils d'Auguste et dix paires de gladiateurs appartenant
à Decimus Lucretius Valens le fils combattront
à Pompéi le six, le cinq, le quatre, le
trois et la veille des ides d'avril. Il y aura une chasse
conforme aux règles et des vela [pour se
protéger du soleil].
Æmilius Celer l'a écrit à la clarté
de la lune.»
|
|
| |
Pour toutes sortes de raisons évidentes
- le cinéma n'a aucune vocation pédagogique, et
les cinéastes n'ont qu'une vision caricaturale et sulpicienne,
bref entertainment, de la gladiature - le film omettra
quantité de détails superfétatoires pour
privilégier l'action. Un bon point, néanmoins, pour
Jerzy Kawalerowicz qui dans son Quo
Vadis (2000) non seulement a montré une pompa,
sans toutefois trop s'appesantir sur les détails; mais
il a laissé entrevoir certains acteurs religieux comme
ces valets déguisés en Mercure qui cognent aux portes
de la mort (libitinensis porta) par où on emportait
les gladiateurs tués (2).
|
| |
| 
Dans Messaline (Carmine
Gallone, 1951), les gladiateurs défilent en rangs
dans le Cirque Maxime à Rome. Il n'y manque que quelques
éléments (prêtres, acolytes, musiciens,
arbitres etc.) pour que ça soit une pompa
parfaite ! |
|
| |
| «Séparés
à l'époque républicaine, venationes et
munera sont intégrés dans un même spectacle
dès l'époque augustéenne. A partir du règne
de Tibère, il est difficile de comptabiliser séparément
munus et venatio. Sous l'Empire, le programme du
munus classique comprend trois moments : chasse le matin et
combats de gladiateurs l'après-midi, séparés
par un intermède vers la mi-journée, les meridiani
(les jeux de midi)» (3).
8.3.1. Les jeux du matin (ludi
matutini)
Le matin, donc, ont lieu
les venationes, les «chasses aux fauves». Les
jeux commençaient à l'aube et s'achevaient parfois,
comme sous Domitien, à la nuit tombée. Ils commençaient
par toutes sortes d'exhibitions, de mimes, de dressage de fauves,
de combats de fauves (ours contre buffles, rhinocéros contre
éléphants) dont Martial nous a conservé le
souvenir étonné.
Les bestiaires sont-ils des gladiateurs ? Au
niveau des armaturæ certainement pas, ce de par la
nature même de leurs démonstrations. Comment, en
effet, pratiquer une escrime codifiée, avec arbitre, lorsqu'un
des adversaires est une bête ?
A noter que sous l'empire chrétien, le combat contre la
bête symbolisera la lutte contre les ténèbres.
Les bestiaires survécurent aux gladiateurs. Interdits une
première fois par Constantin Ier en 325, puis par l'empereur
Honorius en 404, réitéré par son neveu Valentinien
III en 438 les gladiateurs ne disparurent définitivement
que vers la fin du Ve s.
Les courses de chars, quant à elles, se maintinrent sous
l'Empire byzantin au moins jusqu'au XIIe s.
|
|
| 
Dans Les
gladiateurs (Delmer Daves, 1954), Victor Mature
affronte un fauve dans l'arène de Caligula |
|
| |
Dans Les gladiateurs (Demetrius
and the Gladiators, Delmer Daves, 1954), Victor Mature affronte
un tigre royal sous les yeux de Caligula. Sa bravoure lui vaudra
d'être, à leur demande, incorporé dans les
prétoriens (on peut néanmoins douter que ces membres
de la petite noblesse provinciale aient voulu d'un ancien esclave
grec dans leurs rangs !).
|
|
| 
Décor de venatio
reconstitué dans l'amphithéâtre de Vérone
pour le film de Richard Fleischer, Barabbas. Le praticable
où combattent en mêlée les gladiateurs
(catervarii) enjambe des enclos de fauves, des brasiers
et des étangs (à crocodiles ?). Au fond sur
la gauche, une exhibition d'éléphants; sur
leur droite, combat d'amazones et de nains - difficiles
à reconnaître sur cette photo. A noter que
les bas-reliefs nous ont conservé le souvenir du
pontarius, gladiateur juché sur un pont qu'il
défend contre un adversaire en contrebas... |
|
| |
Pour les venationes - qui
plus tard finiront par se confondre avec les munera - il
était fréquent de construire un décor exotique,
avec toutes sortes de plantations, de collines, de sentiers. Dans
Barabbas (Richard Fleischer, 1962) on a combiné
venatio et munera dans cet étonnant décor
reconstitué dans l'amphithéâtre de Vérone.
Les «gladiateurs» sont des catervaires qui s'affrontent
en groupes sur un quadruple pont enjambant des fossés emplis
de fauves, d'éléphants, de crocodiles barbotant
dans des mares artificielles, séparés par des brasiers...
Gare à ceux qui y tombent ! A noter la présence
d'une bande d'amazones affrontant une armée de nains (idée
reprise du Signe de la
Croix, C.B. DeMille, 1932). Ce décor semble avoir
resservi dans la séquence prégénérique
des Sept gladiateurs (Pedro Lazaga, 1962); un autre du
même genre avait été conçu, dans ce
même amphithéâtre de Vérone, pour Fabiola
(Alessandro Blasetti, 1948). |
| |
|
Crucifixion ou livraison aux fauves de condamnés
à mort, sous le coup de midi (J. Kawalerowicz, Quo
Vadis, 2001) |
|
| |
8.3.2. L'heure
méridienne
Lorsque le soleil est au plus haut, entre la venatio du
matin et les munera de l'après-midi, vient l'heure
des exécutions de criminels et de bouffonneries en tout
genre. Un des moments favoris des péplums sulpiciens (les
exécutions, pas les bouffonneries !). |
| |
| 
A l'heure méridienne
: pendaisons, crucifixions et exécutions en tout
genre de condamnés à morts - ici des chrétiens,
ces «ennemis du genre humain» - dans les décors
de la venatio non encore démontés (Fabiola,
A. Blasetti, 1948) |
|
| |
Donc vers midi - à
l'heure méridienne - avaient lieu les exécutions
capitales : voleurs et assassins étaient mis à mort
selon leur condition. La décapitation pour les citoyens,
la crucifixion, le bûcher ou les fauves pour les esclaves
ou les non-citoyens. Sous la république, elles se déroulaient
sur le Forum, ad metalla, par le fer, c'est-à-dire
qu'ils étaient purement et simplement égorgés
par des gladiateurs, généralement des rétiaires,
la catégorie la plus méprisée (4);
ad bestias, par les bêtes; ou encore noxii ad
gladium ludi damnati, c'est-à-dire qu'ils devaient
affronter désarmés un autre condamné armé,
qui passait ensuite ses armes à un autre chargé
de le tuer lui aussi (SÉNÈQUE, Ep. Lucillius,
7). Nous avons vu quelles catégories de condamnés
étaient livrées aux fauves, ajoutons-y - relevant
du droit commun - les parricides, le crime le plus affreux qui
puisse se concevoir, et les «ennemis du genre humain»,
c'est-à-dire ces chrétiens dont l'athéisme
affiché, menaçant l'équilibre cosmique, ne
pouvait qu'attirer le malheur sur l'Empire. Car même si
de munera sacrés, organisés à l'occasion
de funérailles, les combats de gladiateurs sont devenus
des ludi profanes, la symbolique des jeux reste religieuse.
Ainsi les courses de chars symbolisant la marche des saisons.
Mais il importe peu aux cinéastes d'exposer le comment
et le pourquoi, encore moins d'expliciter les phases du spectacle,
ni ses catégories. Le cinéma va directement à
l'essentiel, en fonction du scénario.
|
| |
|
La révolte des esclaves (Nunzio
Malassoma, 1960)
|
|
| |
| C'est donc sur le coup de midi que
l'on exécute les criminels et les ennemis de l'Etat. Les
citoyens ont droit à la décapitation par le glaive.
Le sort des étrangers et des esclaves est moins enviable
: pour eux, c'est la crucifixion, les fauves ou le bûcher.
Dans ce remake de Fabiola, un évêque
chrétien est, comme chef d'une secte interdite, condamné
au bûcher (La révolte des esclaves, Nunzio
Malasomma, 1960)... |
| |
|
La révolte des esclaves (Nunzio
Malassoma, 1960) |
|
| |
... Il échoit à des
«gladiateurs», en général des rétiaires,
de parfois faire office de bourreaux, et de descendre dans l'arène
égorger purement et simplement les condamnés. Ici
ce seront des mercenaires africains qui cribleront de javelots
les «ennemis du genre humain», les chrétiens
condamnés à mort (La révolte des esclaves,
Nunzio Malasomma, 1960). Dans Les derniers jours de Pompéi
(Mario Bonnard & Sergio Leone, 1959) ce seront les lions,
ou plutôt un seul malheureux lion. Celui-ci n'ayant pas
faim, des gladiateurs seront dépêchés pour
cribler de flèches les pauvres chrétiens.
Dans Quo Vadis ?, Lygie fera les frais d'un pantomime contant
la mort d'une cruelle marâtre de la mythologie, Dircé,
qui fut attachée à la queue d'un taureau furieux
(5)... |
| |
| 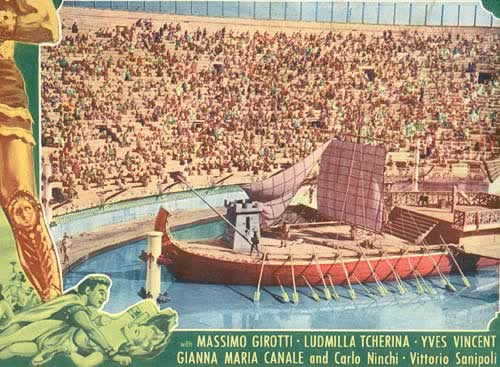
Une galère non pas
pour une naumachie, mais décor d'un ballet mythologique
qui doit s'achever sous les crocs des lions. Filmé
dans l'amphithéâtre de Vérone censé
être le Colisée de Rome (Spartacus,
Riccardo Freda, 1952) |
|
| |
... Car l'heure méridienne,
c'est aussi celle du snuff-movie à l'antique. Des
acteurs jouent des pantomimes à l'issue desquelles un condamné
à mort est substitué au comédien incarnant
le personnage censé mourir. Par exemple le brigand Laureolus,
triste héros d'un pantomime célèbre, à
l'issue duquel il est crucifié et étripé
par un ours.
Riccardo Freda a saisi cet instant un peu hors contexte dans Spartacus
(1952), filmé lui aussi dans l'amphithéâtre
de Vérone. Une galère-décor suggère
de prime abord des images de naumachie. En fait, c'est d'un ballet
qu'il s'agit. La danseuse Amytis, femme de Spartacus, mime le
ballet des Néréides sous les yeux du rebelle enchaîné.
Sur ces entrefaites, des lions lâchés vont alors
déchiqueter cette malheureuse sous les yeux de son amant
impuissant, avant de s'occuper de celui-ci. C'est du moins ce
qu'espère l'organisateur...
|
|
| 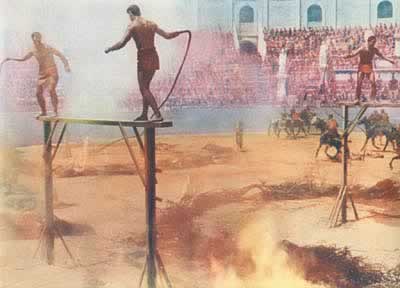
Sur une passerelle entourée
de pièges mortels, le combat bouffon des laquearii
devient un jeu dangereux dans La révolte des esclaves
(Nunzio Malasomma, 1960) |
|
| |
... Mais l'heure méridienne,
c'est aussi les combats burlesques, où s'affrontent les
gladiatores meridiani, des combattants armés d'un
lassos et d'un bâton, les laquearii, ou d'un gourdin
et d'un fouet, les pægnarii. Avec son costume rembourré,
il est d'ailleurs bien malaisé de considérer le
pægnarius comme un gladiateur. Dans La révolte
des esclaves (Nunzio Malasomma, 1960), ces combattants armés
de fouets qui s'affrontent sur un pont léger, font songer
à ces pægnarii (6)
que les cinéastes auraient ici combinés avec les
pontarii («ceux qui se battent sur un pont»).
L'idée de ces combattants armés de fouet, juchés
sur une étroite plate-forme d'où ils essaient mutuellement
de se faire chuter... de préférence sur des braises
ardentes, revient dans plusieurs films : Fabiola (A. Blasetti,
1948), Pompéi (Warrior Queen, Chuck Vincent,
1986)...
|
| |
|
Laquearius (à gauche) et pægnarius
(à droite), «gladiateurs pour rire» qui
- tout au plus - risquaient de se prendre un méchant
coup de bâton ou de fouet, animaient les intermissions
par leurs facéties |
|
| |
8.3.3. Les munera
Les condamnés à mort expédiés, on
peut enfin - l'après-midi - passer aux choses sérieuses.
Ceux que leurs affaires ont retenus le matin ont rejoint les gradins,
et la foule est maintenant comble.
a. La pompa
Le premier jour des combats, dans l'après midi, un cortège
triomphal (pompa) se rendait à l'amphithéâtre
avec l'editor. Les gladiateurs appelés à
combattre y participaient, revêtus de luxueux vêtements
de parade. «Derrière les magistrats, revêtus
de pourpre et accompagnés des licteurs, les gladiateurs
pénétraient dans l'arène par la porta
triumphalis. Ils défilaient en grande tenue avec leurs
casques de parade et leurs armes rutilantes. Des porteurs de pancartes
indiquaient le palmarès des meilleurs d'entre eux. Les
condamnés aux bêtes suivaient en titubant, mains
liées et attachés les uns aux autres. Le cortège
se déplaçait au son d'une musique puissante où
dominaient les cors et les trompettes» (7).
«Les gladiateurs, conduits [en chariot] du
ludus magnus au Colisée, mettaient pied à terre
en arrivant devant l'amphithéâtre, et faisaient le
tour de l'arène en ordre militaire, vêtus de chlamydes
teintes de pourpre et brodées d'or. Ils marchaient l'allure
dégagée et les mains libres, suivis de valets qui
portaient leurs armes» (8).
Par analogie avec la pompa circences qui ouvrait les jeux
du cirque, c'est-à-dire les courses de chars, on peut imaginer
également participant au cortège une délégation
de la jeunesse romaine, des prêtres et des chars où
ont pris place les dieux, et bien sûr des artistes, jongleurs,
danseurs appelés à se produire dans les interludes.
b. Les échauffements
Le spectacle débutait par des exercices d'échauffement
à armes mouchetées (prolusio). Les amateurs
pouvaient descendre dans l'arène et essayer avec les «pros»
quelques passes d'escrime.
Les afficionados étaient ensuite invités
à réintégrer les gradins. Alors les armes
réelles étaient soumises au contrôle (probatio
armorum) de l'editor, et l'on tirait au sort les adversaires
pour constituer des paires. Leurs noms et performances étaient
écrits sur les pancartes que des præcones
(hérauts) présentaient à la vue du public.
Les combattants revêtaient alors de leurs armes, aidés
par des assistants (ministri). |
|
| 
La musique d'un orgue hydraulique
comme celui-ci accompagnait les combats des gladiateurs.
Reconstitution du Musée archéologique d'Aquincum
(Budapest, Hongrie, pochette du 45 t vinyl) |
|
| |
c. Les combats
Ces préliminaires achevés, une musique martiale
- cors, trompettes, orgue hydraulique - annonçait le début
des affrontements qu'ils ponctueraient en rythme, tel qu'on peut
les voir sur la mosaïque de Zlitten (Lybie, IIIe s. de n.E.).
Accompagnés de leur arbitre (summa rudis) et de
gardes armés de fouets (lorarii) - pour stimuler
des ardeurs défaillantes -, chaque paire de gladiateurs
gagnait son emplacement. Les duels pouvaient commencer aussitôt
que l'éditeur des jeux donnait le signal des combats (signum
pugnæ).
Le combat consistait à essayer de percer la défense
de l'adversaire, le fatiguer, lui infliger de légères
blessures, bref à marquer des points selon un code bien
précis que comptabilisait l'arbitre. Finalement, celui
qui se déclarait (ou était déclaré)
vaincu posait ses armes et tendait sa gorge, stoïque.
Levant le bras, l'index pointé, il demandait grâce.
Moment très attendu du public qui admirait le mépris
de la mort et appréciait la sérénité
du perdant. Selon le cas, il huait le maladroit (Jugula !,
«Egorge-le !») ou applaudissait le courage malheureux
(Mitte !, «Renvoyez-le [vivant] !»). Toutefois
la décision finale dépendait de l'éditeur
des jeux. Il faut tordre le cou à la légende du
pouce baissé, ce Pollice
verso qui a donné son nom à la fameuse toile
de Gérôme. Il est plus probable que les spectateurs
- dont le suffrage exprimé avec les doigts ne devait guère
être visible à l'autre bout de l'amphithéâtre
- soulignaient l'injonction «Jugula !» en tournant
le pouce vers leur propre gorge, en un geste menaçant bien
connu. Quant au pouce levé, par opposition au baissé,
il n'est attesté dans aucune source ancienne. |
| |
| 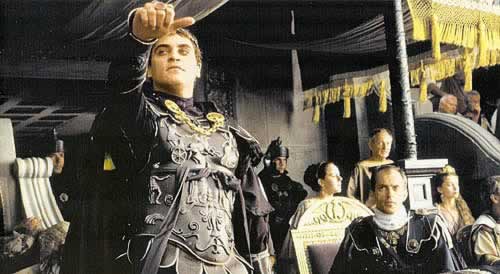
Commode fait durer le suspense
: admirez la technique imparable du pouce horizontal...
se relèvera ou s'abaissera ? Que demande le Peuple
? L'empereur romain, toujours généreux, hume
la foule, scrute son attente... |
|
| |
Stans missus
ou rudarius ?
Il appartenait donc à l'éditeur, qui offrait les
jeux - l'empereur, ou un magistrat -, de décider si le
vaincu devait être stans missus (9)
(«renvoyé debout»), c'est-à-dire momentanément
renvoyé, ou recevrait la rudis, le glaive de bois
qui le libérerait définitivement de l'arène,
l'acquittait de son engagement.
En fait, les rudarii quittaient rarement le monde de la
gladiature : ils y restaient comme instructeurs (doctors);
d'autres rempilaient une fois, deux fois et devenaient ainsi des
prima rudis, secunda rudis etc.
Jouer n'est pas tuer...
Le gladiateur n'a en principe pas le droit de tuer froidement
son adversaire sans l'injonction expresse de l'éditeur
des jeux. Pour des professionnels bien entraînés,
le duel à mort risquerait d'être court, donc sans
intérêt. L'arbitre (summa rudis), dont la
tunique s'orne de deux bandes de tissu noir, verticales, une de
chaque côté de la poitrine, veille à les rappeler
à l'ordre. Martial parle de combats ad digitum,
qui s'arrêtent «au premier sang», c'est-à-dire
quand celui qui s'estime vaincu jette son bouclier et lève
le doigt pour faire sa soumission... et obtenir sa grâce.
Toutefois il a pu arriver que dans l'intensité de l'action,
les combattants ne retiennent plus leurs coups. Et même
s'entre-tuent : ainsi à Pergame, le provocator Nympheros
et le mirmillon Kallimorphos (10). |
| |
| 
Sur cette mosaïque romaine
du IIes. de n.E., trouvée dans la villa de Nennig
(Sarre), on voit très bien entre les combattants
le doctor (arbitre) avec sa tunique ornée
de deux bandes noires verticales. La présence d'un
arbitre est attestée par d'autres documents figurés |
|
| |
Sine missio
Bien sûr, ce que nous venons de décrire, ne concerne
que les combats classiques, normaux. Il pouvait arriver que des
combattants soient engagés dans des duels sine missio
(«sans renvoi», c'est-à-dire sans merci), dont
la mort serait obligatoirement l'issue. Il s'agissait alors d'une
forme de condamnation à mort, appliquée à des
individus jugés dangereux pour la sécurité
publique (11).
Mais ici on sort des règles de la gladiature proprement dite,
puisque l'issue en a été réglée d'avance.
Le condamné affrontera les uns après les autres autant
d'adversaires que nécessaire, jusqu'à sa défaite
inéluctable. |
| Suite… |
|
NOTES :
(1) Corpus inscr. lat., suppl.
IV, II, n 3884; H. DESSAU, Inscr. lat. selectæ,
II, n 5145. - Retour texte
(2) Cette pompa, ce défilé
de gladiateurs, les Charon et les Mercure - qui achèvent
les blessés et tirent leurs corps jusqu'au spoliaire
- sont évoqués dans le roman de Sienkiewicz, Chapitre
LVI : «Les jeux matutinaux», dont Kawalerowicz fut
l'adaptateur scrupuleux. - Retour texte
(3) GOLVIN & LANDES, Amphithéâtres
et gladiateurs, op. cit., p. 189. - Retour
texte
(4) Teyssier
& Lopez s'insurgent contre cette opinion en citant Juvénal
(JUV., Sat., 197-210). En dehors des equites et des femmes,
qui sont toujours tunicati - revêtus d'une tunique
-, le rétiaire traditionnellement torse nu porte parfois
une tunique, ce qui suggérerait que des citoyens comme
celui dont parle Juvénal se commettaient parfois dans
cette armatura... prestigieuse (TEYSSIER & LOPEZ,
Glad., op. cit., p. 58). - Retour
texte
(5) Le roman comme les différentes
versions filmiques éluderont la référence
au pantomime de Dircé, contexte logique de ce genre d'exécution.
S'inspirant du roman de son ami Sienkiewicz pour peindre, en
1897, sa célèbre toile Dircé chrétienne,
le peintre Henryk Siemiradzki en témoigne à l'évidence.
- Retour texte
(6) Notons que ces curieux pægnarii
ne portent pas non plus leur justaucorps ni leurs culottes matelassées...
- Retour texte
(7) Ch. LANDES et J.-Cl. GOLVIN, Amphithéâtres...,
op. cit., p. 194. - Retour texte
(8) J. CARCOPINO, La vie quotidienne
à Rome, Hachette, p. 277. - Retour
texte
(9) Pluriel : stantes missi.
- Retour texte
(10) L. ROBERT, Hellinica,
VIII, 335 - cité par LANDES & GOLVIN, op. cit.,
p. 195. - Retour texte
(11) Il s'agissait d'une forme alternative
de la peine capitale. On sait que le droit romain ne se souciait
pas de l'égalité dans l'application du prononcé.
Peu importait la manière plus ou moins expéditive
ou cruelle dont mourait le condamné, pourvu qu'il mourut
pour l'édification de tous : dans un show live,
déguisé en personnage mythologique, ou brûlé
vif, crucifié, empalé. Ou les armes à la
main, s'il en avait la capacité.
Evidemment, on ne condamnait à ce genre de peine que
des individus capables de chèrement défendre leur
peau, et d'ainsi fournir un spectacle intéressant ! -
Retour texte
|
| |
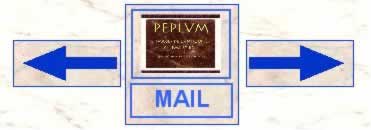 |
|