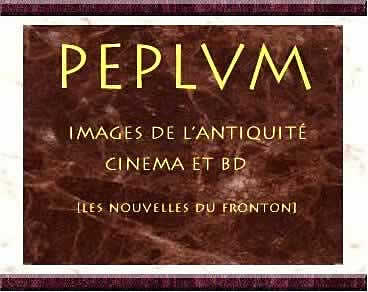 |
| |
| |
De La Chute de l'Empire romain
à Gladiator
Page 10/16
|
|
| |
|
| |
10.
Bibliographie historique
 Orientation bibliographique
Orientation bibliographique
Pour remettre les pendules à l'heure, nos visiteurs se
reporteront - bien sûr - aux bios de Marc Aurèle
par Charles Parain (rééd. chez Complexe) et par
Pierre Grimal (chez Fayard), sans oublier l'Histoire Auguste,
rééditée chez Bouquins.
|
| |
|
| |
 Romans historiques
Romans historiques
Epinglons plus spécialement les excellents romans de François
Fontaine centrés sur les Antonins, en particulier à
propos d'Avidius Cassius
et de la Guerre des Marcomans, L'Usurpation, ou le roman de
Marc Aurèle (Fayard, 1979) et, du point de vue de Pompeianus,
second mari de Lucilla, D'Or et de Bronze - Les Mémoires
de T. Pompeianus (Julliard, 1986), ainsi que, de Gilbert Sinoué,
La Pourpre et l'Olivier (Orban, 1987), à propos
de Marcia, la célèbre
concubine chrétienne de Commode, et du futur seizième
pape Calixte (217-222)...
Enfin, de François Fontaine encore, Douze autres Césars
(Julliard, 1985) qui se présente, de Nerva à Alexandre-Sévère,
comme une «reconstitution» des œuvres perdues
de L. Marius Maximus.
Ces quatre romans donnent une idée de ce qu'on aurait pu
faire sur cette période et dans le respect de l'histoire...
|
| |
|
| |
Dans Blandine de Lyon (Julliard,
1987), F. Fontaine retrace le martyre de sainte Blandine, en 177,
sous Marc Aurèle. Et le même auteur, décidément
intarissable sur les Antonins, raconte comment Hadrien succéda
à Trajan dans Mourir à Sélinonte (Julliard,
1984; rééd. Presses Pocket, n° 2809, 1987 - avec
annexes historiques de Cl. Aziza).
La novélisation de La Chute de l'Empire romain
par Harry Whittington a été publiée chez
Marabout (Géant, n° 205, 1964) à l'époque,
et celle de Gladiator par Dewey Gram, chez J'Ai Lu (n° 5743).
|
| |
|
| |
 Auteurs anciens
Auteurs anciens |
- Histoire Auguste (Suétone et les écrivains
de l' -),
[Recueil de six compilateurs : Ælius Lampridius, Ælius
Spartianus, Flavius Vopiscus, Julius Capitolinus, Trebellius
Pollion et Vulcacius Gallicanus]
traduction Théophile Baudemart publiée sous la
direction de M. Nisard, Paris, Firmin Didot [J.J. Dubochet et
Cie], 1845;
- Histoire Auguste (trad. A. CHASTAGNOL), Laffont, coll.
«Bouquins», 1994, 1244 p.;
- MARC AURÈLE, Pensées pour moi-même
(suivies du Manuel d'Epictète et du Tableau
de Cébès) (trad., introd. et notes de Mario
Meunier), Garnier, 1960.
|
| Pour Hérodien et Dion Cassius
il n'existe - à notre connaissance - pas d'édition
française disponible, on se référera donc aux
éditions anglaises (Loeb Classical) ou allemandes (Teubner).
Notons toutefois : |
- HÉRODIEN, Histoire romaine, traduction L. Halévy,
Paris, 1887;
- DION CASSIUS, Histoire romaine, traduction Gros &
Boissée, 10 vols, Paris, 1870.
|
| |
 Auteurs modernes
Auteurs modernes
|
- Edward GIBBON, Histoire du déclin et de la chute
de l'Empire romain (Decline And Fall of the Roman Empire,
1776),
traduction de M.F. Guizot, 13 vols, Paris, 1812;
Rééd. du précédent, 2 vols, Robert
Laffont, coll. «Bouquins», 1983, 1.187 p. et 1.273
p.
|
| De par sa réputation universelle,
l'œuvre de Gibbon reste un «must» pour le grand
public. Notons une réédition abrégée
illustrée : |
- E. GIBBON, Décadence et chute de l'Empire romain
(Londres, Bison Books, 1979), Paris, Fernand Nathan, 1981, 256
p.
|
| Voir aussi : |
- MONTESQUIEU, Considérations sur les causes de la
grandeur des Romains et de leur décadence (1734),
Olivier Orban, 1988.
|
| |
 Etudes modernes
Etudes modernes |
- Peter BROWN, Genèse de l'Antiquité tardive
(trad. Aline Rousselle), Mayenne, N.R.F.-Gallimard, 1983, 195
p.;
- A. CHASTAGNOL, La fin du monde antique, Paris, 1976,
383 p.;
- P. CHAUNU, Histoire et décadence, Paris, 1981,
365 p.;
- COLLECTIF, Gibbon et Rome à la lumière de
l'historiographie moderne - Colloque, Genève, 1977,
264 p.;
- Pierre GRIMAL, Marc Aurèle, Fayard, 1991, 449
p.;
- Henri-Irénée MARROU, Décadence romaine
ou antiquité tardive ? (IIIe-IVe s.), Seuil, coll.
Points-Histoire, n° H 29, 1977;
- Henri-Irénée MARROU, Christiana tempora,
Rome, 1978, pp. 3-85;
- J.-P. MARTIN, Le siècle des Antonins, Paris,
P.U.F., coll. Documents histoire, n° 20, 1977;
- S. MAZZARINO, La fin du monde antique, Paris, 1973,
210 p.;
- Charles PARAIN, Marc Aurèle (1957), Bruxelles,
Editions Complexe, 1982, 217 p.;
- Lucien MUSSET, Les invasions. Les vagues germaniques,
P.U.F., coll. «Nouvelle Clio - L'histoire et ses problèmes»,
n° 12, 1965, 329 p.;
- P. PETIT, La Paix romaine, Paris, P.U.F., coll. Nouvelle
Clio, n° 9, 1971;
- P. PETIT, Histoire générale de l'Empire romain,
Paris, Le Seuil, coll. Points-Histoire, 1974, vol. 2, 254 p.
- vol. 3, 287 p.;
- André PIGANIOL, Le sac de Rome - Le mémorial
des siècles, Albin Michel, 1964; rééd.
La chute de l'Empire romain - Le mémorial des siècles,
Marabout Université, n° MU 379, 1982;
- R. REMONDON, La crise de l'empire romain, de Marc Aurèle
à Anastase, Paris, 1970, 363 p.;
- Pierre RICHE & Philippe LE MAÎTRE, Les invasions
barbares (1953), P.U.F., Que sais-je ?, n° 556, rééd.
1983.
|
| |
IV
- FICHES TECHNIQUES
11. La Chute de l'Empire romain
11.1. Fiche technique
Chute de l'Empire romain (La)
Chute de l'Empire romain (La) [FR]
Chute de l'Empire romain (La) [BE] |
Etats-Unis, 1963
|
Fall of the Roman
Empire (The) [EU]
Caduta dell'Impero Romano (La) [IT]
Fall of the Roman Empire (The) [EU]
Fall of the Roman Empire (The) [GB]
Untergang des Römischen Reiches (Der) [AL]
Caida del Imperio Romano (La) [SP]
Prod. : Samuel Bronston (Madrid) - Rank / Technicolor
/ 35 mm Ultra-Panavision (Technirama [1])
/ 4.595 m / 188' (EU) [ou 180', 185' ?] [copyright
: 153'] - 179' (FR) [puis 150'] - 135' (SP)
Fiche technique
Réal. : Anthony MANN; Scén. : Ben BARZMAN,
Basilio FRANCHINA & Philip YORDAN; Images : Robert
KRASKER, B.S.C.; Camera : John HARRIS; Camera 2e éq.
: Cecilio PANIAGUA; Prod. : Samuel BRONSTON; Prod.
assoc. exéc. : Michael WASZYNSKI; Prod. assoc.
: Jaime PRADES; Dir. prod. : C.O. ERICKSON; 1er assist.
réal. 1ère éq. : José
Lopez RODERO; Script-girl : Elayne SCHREYECK; Répétiteur
des dialogues : George TYNE; Dir. opérations
2e éq. : Andrew MARTON; Dir. 2e éq.
: Yakima CANUTT; 1er assist. réal. 2e éq.
: José Maria OCHOA; Chef de la figuration :
Maude SPECTOR; Montage : Robert LAWRENCE; Décors
: Veniero COLASANTI & John MOORE; Conseiller technique
& historique : Dr Will DURANT; Fresques : Maciek
PIOTROWSKI; Directrice de l'habillement : Gloria MUSETTA;
Costumes : CERATELLI & PERUZZI (Italie); Coiff.
: Grazia DI (DE) ROSSI; Maq. : Mario VAN RIEL; Ing.
son : David HILDYARD (Westrex); Ing. son studio :
Gordon K. MCCALLUM; Montage effets son. : Milton BURROW;
Montage musique : Leon BIRNBAUM; Aide monteuse : Magdalena
PARADELL; Effets spéc. : Alex WELDON; Chef
accessoiriste : Stanley DETLIE; Superv. techn. (chef
machiniste) : Carl GIBSON; Chef électricien
: Bruno PASQUALINI; Musique : Dimitri TIOMKIN. |
|
|
|
| |
Fiche artistique
Sophia LOREN (Lucilla [VF : Antonia]) - Stephen BOYD (Gaius Livius
Metellus) - Alec GUINNESS (Marc Aurèle) - James MASON (Timonidès)
- Christopher PLUMMER (Commode) - Anthony QUAYLE (Verulus, gladiateur)
- John IRELAND (Ballomar, chef des Barbares) - Mel FERRER (Cléandre,
courtisan aveugle) - Omar SHARIF (Sohamus, roi d'Arménie)
- Eric PORTER (Julianus, patricien ami de Commode) - Douglas WILMER
(Niger, patricien ami de Commode) - Peter DAMON (Claudius, patricien
ami de Commode) - Andrew KEIR (Polybius, tribun ami de Livius)
- George MURCELL (Victorinus, tribun ami de Livius) - Lena VON
MARTENS (Helva, princesse des Barbares) - Gabriella LICUDI (Tauna,
une jeune barbare) - Rafael Luis CALVO (Lentulus, guide de Cléandre)
- Normann WOOLAND (Virgilianus, proconsul d'Egypte) - Virgilio
TEXERA (Marcellus, gouverneur de Syrie) - Michael GWYNN (Cornelius,
préfet du prétoire) - Guy ROLFE (Marius, sénateur)
- Finlay CURRIE (Cæcina, sénateur).
| INT/ |
J. Arthur Rank (The Rank Organisation) |
| AL/ |
Rééd. Avco Embassy
- 20th Fox |
| BE/ |
Rank; puis Excelsior |
| EU/ |
Paramount Pictures (sortie à
New York, 25 mars 1964)
Rééd. Joseph E. Levine & Avco Embassy |
| FR/ |
Rank (sortie en France, 30 avril
1964). Le 29 avril 1964, inaugure - hors compétition
- le XVIIe Festival cinématographique de Cannes. Rééd.
'80 : Argos Films |
| SP/ |
Globe Film S.A. |
NOTES
Tourné aux studios Samuel Bronston, Madrid.
Copyright 1964 par Bronston-Roma Productions - Tous droits réservés
- Approuvé par certificat MPAA, n° 20602.
Post synchronisation française
LINGUA SYNCHRONE - Réal: Richard HEINZ.
Texte de Max MORISE, supervisé par Philippe ERLANGER [Ph.
Erlanger : historien français, directeur des échanges
artistiques au Ministère des Affaires étrangères]
- Enregistré à l'Auditorium Jean Mermoz par Louis
KIEFFER.
Voix : William SABATIER - Jean-Claude MICHEL - Gérard FERAT
- Nathalie NERVAL - René ARRIEU - Pierre ASSO - Jacques
BERLIOZ.
| — |
The Fall of the Roman Empire,
B.O. 33t LP, réf. CBS 62.277; P. 1964.-
Musique composée et dirigée par Dimitri Tiomkin,
à la tête du Symphony Orchestra of 110 of England's
Finest Musicians. |
| — |
Réédition dans le
coffret «Dimitri Tiomkin», réf. CBS 66.604
(6 disques 33t : The Fall of the Roman Empire, 55 Days
at Peking, The Alamo, The Guns of Navarone, The Old Man and
the Sea, Wild is the Wind); P. ca 1980, réf.
CBS 83.119. |
FILMOGRAPHIE
Pas d'extraits en Super.8 (?).
Existe toutefois une version complète sur disque laser.
VIDÉOGRAPHIE
1. VHS : La chute de l'Empire romain, Hollywood
Video.
2. DVD : La chute de l'Empire
romain, Opening Edition, réf. 786148, 19/9 compatible
4/3, 170'. Reprise chez Fabbri.
3. DVD : Edition collector 3 DVD : Le
Cid - La chute de l'Empire romain - Les coulisses des films (bonus)
Editeur : Opening Video. |
- Le Cid - Format : 2.35 Cinémascope - 16/9 compatible
4/3 - Langues : français mono, anglais stéréo
- s/t fr - Film annonce - 177'. DVD 9
- La chute de l'Empire romain - Format : 2.35 Cinémascope
- 16/9 compatible 4/3 - Langues : français mono, anglais
stéréo - s/t fr - Film annonce - 172'. DVD 9
- Bonus : Les coulisses des films
La chute de l'Empire romain - Rome in Madrid (Making of)
(VO s/t fr) (10') - L'analyse de Jean Douchet (30') -
Requiem (interview Claude Aziza - réal. : Noël
Simsolo) (43') - Le Cid - Le Médiateur (interview
Pierre-Henry Deleau) (36') - Filmographie de Anthony Mann.
|
| |
11.2.
Bibliographie
Presse |
- Esteban MARQUEZ, «De grands acteurs vivent en Espagne,
dans la neige et le froid - La chute de l'Empire romain»,
Ciné Revue, n° 5, 1963, p. 23;
- J. VAN COTTOM, interview de Samuel Bronston et Anthony Mann,
Ciné-Presse, n° 19, 11 mai 1963;
- J. VAN COTTOM, «Sophia Loren - Grande vedette de La
chute de l'Empire romain», Ciné Revue,
n° 20, 16 mai 1963, pp. 17-22;
- «Omar Shariff - Le Forum de La chute de l'Empire
romain», Ciné Revue, n° 22, 1963, p.
19;
- J. VAN COTTOM, «Stephen Boyd : La femme étant
la femme, l'homme peut-il vraiment la comprendre ?», Ciné
Revue, n° 23, 6 juin 1963, pp. 16-17;
- Roland FOUGÈRES, «Dimitri Tiomkin, le plus célèbre
compositeur du cinéma, rêve à une musique
vivante pour La chute de l'Empire romain», Ciné
Revue, n° 44, 1963, pp. 30-31;
- Roland FOUGÈRES raconte La chute de l'Empire romain,
Ciné Revue, n° 11, 1964, pp. 20-31;
- Jacques MONTFORT, «Trois heures d'enchantement visuel»,
Ciné Revue, n° 41, 1964, pp. 6 et 7;
- Kinematograph Weekly, 16 mars 1964;
- La saison cinématographique 1964, pp. 59-60;
- «La chute de l'Empire romain. De fabuleux destins
ballottés entre le pouvoir et l'amour» (film raconté),
Ciné Revue Magazine, Hors Série, n° 1A,
janvier 1979, pp. 24-31;
- Henry-Jean SERVAT, Secrets
de tournages, Le Pré aux Clercs, 2001, pp. 122-133.
|
| |
| Novélisation |
- Harry WITTINGTON, The Fall of the Roman Empire, A Gold
Metal Book, février 1964, n° 701; rééd.,
n° d1385;
Harry WITTINGTON, La chute de l'Empire romain (trad.
Denyse et Henri Fagne), Bibliothèque Marabout Géant,
n° 205, 1964; 278 p. [La traduction française contient
un commentaire historique de D. Charlan].
|
| |
Programme souvenir
En Belgique il en existe au moins trois différents : |
- Le programme du gala organisé par la F.N.A.P.G. avec
la participation de la chanteuse Dalida [couverture noir et
blanc et orange];
- Le programme-souvenir, imprimé en France, adaptation
française du Kine Weekly par Monique Abelleira
[couverture couleur];
- Le programme The Fall of the Roman Empire [tiré-à-part
du «film raconté» de Bonnes Soirées,
16 p., sous couverture crème, impression brune].
|
| |
War Game
Ne fait pas partie du merchandising du film, mais serait
à mettre en parallèle avec l'œuvre d'Edward Gibbon
: |
- Terence DONNELLY, Decline and Fall of the Roman Empire,
Ariel (Edson Printers Ltd, Watford, Herts, GB), (1972) 1977.
Avec notice française.
|
| |
11.3.
Scénario
En 180 de n.E., l'Empire romain est à l'apogée
de sa gloire. L'empereur Marc Aurèle a donné rendez-vous
aux gouverneurs, princes et rois de l'Empire dans un fort perché
(Vindobona [Vienne] ?) sur les pentes enneigées des chaînes
de montagnes situées dans le nord, sur le Danube.
Il désire solliciter leur aide afin de pouvoir réaliser
la Pax Romana dont l'empereur Auguste posa les premiers jalons.
Seules deux frontières restent hostiles à Rome :
celles de la Perse, à l'est; celles du Barbaricum, au septentrion.
Parmi les arrivants se trouvent Livius Gaius Metellus - un tribun
militaire qui fut élevé par l'empereur comme son
fils - et le roi des Arméniens, Sohamus qui, lui, aspire
à obtenir la main de Lucilla, la fille de Marc Aurèle.
Son fils Commode s'intéressant beaucoup plus aux plaisirs
qu'à l'avenir de l'Empire, l'empereur décide que
Livius sera son successeur. Il a fait part de ses projets à
ce dernier en présence de Lucilla. Ces propos sont malheureusement
entendus par Cléandre, l'haruspice aveugle - mais pas sourd
- de la Cour. Sans perdre un instant, Cléandre et le clan
des courtisans de Commode complotent la mort de César,
qu'il faut empêcher d'officialiser sa décision.
Sur ces entrefaites arrive de Rome Commode, accompagné
de son ami Verulus et d'une cohorte de gladiateurs déguisés
en légionnaires. Courageux mais cruel, le fils dilettante
de l'empereur est bien décidé à participer
aux opérations militaires avec cette étrange «troupe».
Très indécis - car Commode est son ami, presque
son frère - Livius informe le fils de Marc Aurèle
des intentions de son père. Froissé, Commode prend
Livius pour un habile intrigant et lui répond par d'amers
sarcasmes.
Plus habitués à parader et à mourir dans
l'arène sous les vivats de la foule, qu'à l'ingrate
besogne du légionnaire dans la forêt obscure des
Barbares, les gladiateurs lâchent le terrain et compromettent
la stratégie romaine. Livius est contraint de laisser échapper
les Barbares pour voler au secours de Commode.
Pour la punir de sa lâcheté, Livius décide
de décimer la cohorte des gladiateurs. Mais Commode le
somme d'arrêter la punition. Les deux hommes s'affrontent
dans un duel-course de chars sur les routes raides et escarpées
de la montagne. Les traits du char de Livius se rompent, et celui-ci
a tout juste le temps de sauter dans celui de Commode, pendant
que le sien se fracasse sur les rochers.
Leur folle course s'étant ainsi achevée, ils en
viennent aux mains, et leur affrontement se s'arrête que
par l'interruption d'un détachement romain.
Malgré le grand amour que Lucilla éprouve pour
Livius, elle accepte, à la demande de son père,
de se soumettre à la raison d'Etat et d'épouser
Sohamus. Marc Aurèle pense ainsi démontrer au monde
la valeur qu'il attache à ses frontières de l'Est.
Livius supplie Lucilla de partir avec lui mais, au même
moment, arrive une dépêche urgente du quartier général
de l'empereur les priant de s'y rendre immédiatement. Ils
y arrivent juste à temps pour assister au dernier soupir
de Marc Aurèle empoisonné par une pomme que lui
a offert Cléandre.
Trop faible pour pouvoir dire ce qu'il souhaite, il meurt en murmurant
seulement le nom de «Livius».
Aucun document ne prouvant que César avait désigné
Livius comme son successeur, le tribun décide d'éviter
la discorde politique et renonce à des droits qu'il ne
peut établir. Il proclame lui-même Commode empereur.
En reconnaissance de sa soumission, Commode le nomme commandant
en chef de toutes les légions de l'Empire. Lucilla, quant
à elle, doit se résigner à obéir aux
dernières volontés de son père et épouse
Sohamus.
Timonidès, un philosophe grec ardent partisan des idées
de Marc Aurèle, croit comme le défunt empereur que
l'amour peut surmonter la haine. Il tente d'amener les prisonniers
marcomans à ces conceptions. Supplicié par leur
chef Ballomar, qui lui brûle la main, le courage du stoïcien
ébranle la férocité des barbares - qui détruisent
l'idole de leur dieu Wotan.
 |
Lucilla retourne à Rome afin de prévenir Commode
d'une rébellion qui se fomente en Orient, suite aux taxes
excessives qu'il impose aux populations. (Taxes dont l'unique
objet est de financer ses plaisirs extravagants, à Rome.)
Sous le conseil pressant de Lucilla, Livius demande au sénat
l'autorisation pour les Barbares de s'installer sur le territoire
fertile de l'Empire. Touché par le vibrant discours de
Timonidès, le sénat lui accorde son soutien. Les
Marcomans seront autorisés à se fixer en Italie,
à Ravenne. Furieux, Commode empêchera désormais
les amants de se revoir. Lucilla est renvoyée chez son
mari en Arménie, et Livius aux frontières orientales.
Appuyés par les Parthes, les Arméniens se révoltent
contre Rome; plus grave : ils sont soutenus par les Légions
d'Orient (Syrie et Egypte). [Floue allusion du film à
la rébellion d'Avidius
Cassius en 175, sous Marc Aurèle ?]
Livius est chargé de liquider cette révolte. Il
arrive non sans mal à convaincre les légions rebelles
qu'elles sont en réalité manipulées par les
Parthes ennemis. En échange de sa promesse de plaider la
cause des Provinces d'Orient pressurées, Livius retourne
la situation. Les Romains réconciliés écrasent
les Parthes et les Arméniens; Livius affronte Sohamus et
le tient bientôt à sa merci, mais un javelot lancé
par un légionnaire étend raide mort le roi arménien.
Ayant retrouvé Lucilla, le général vainqueur
éconduit les émissaires de Commode venus lui promettre
les plus hautes faveurs en échange d'une répression
aveugle et cruelle contre les provinces repenties. Livius les
renvoie à Rome, enchaînés dans des cages à
fauves.
 |
Les légions de Livius, Polybius et Victorinus réunies
marchent sur Rome. En Italie, elles découvrent le village
marcoman exterminé par ordre de Commode, et Timonidès
mourant.
Les légions s'arrêtent aux portes de Rome. Livius
entre seul dans la ville, pour une ultime tentative de raisonner
l'Empereur. Dans le Temple de Jupiter Capitolin, il trouve Commode
- l'esprit complètement dérangé - prétendant
tenir une conversation avec les dieux. Il les entend se rire des
conseils de Livius ! L'officier est arrêté. Quand
à ses légionnaires, Commode n'a d'autre ressource
que de les acheter au poids de l'or. L'honnête Polybius
est abattu, tandis que Victorinus, étouffant ses scrupules,
accepte les sesterces.
C'est la débâcle. Lucilla essaye d'assassiner son
impérial dément de frère. Démasquée
elle est condamnée à périr sur le bûcher
dressé sur le Forum, où doivent ainsi brûler
- holocauste au dieu Commode - des captifs barbares et des sénateurs
opposants. [Allusion du film à l'audacieux rebelle gaulois
Maternus, qui - ses
bandes anéanties - s'était introduit dans le Palais
dans le but de poignarder Commode ?]
Ayant imprudemment avoué à Lucilla sa liaison avec
leur mère Faustine et revendiqué la paternité
de Commode, le gladiateur Verulus est assassiné par l'empereur
qui ne peut souffrir l'idée de son illégitimité.
Commode défie Livius en duel, sur le Forum, afin de démontrer
au peuple que ses victoires passées dans l'arène
étaient le fruit de sa vaillance, non de la complaisance
de ses amis gladiateurs.
Au terme d'un âpre duel livré dans le quadrilatère
délimité par les boucliers des prétoriens,
Livius tue l'«empereur-gladiateur» et délivre
Lucilla de justesse, cependant que les autres condamnés
périssent dans les flammes. Toutefois le héros vainqueur
refuse le trône impérial et s'éloigne avec
la femme qu'il aime, cependant que l'Empire est mis aux enchères...
|
| |
11.4.
L'intrigue (documentation de presse)
«Il n'est jamais agréable pour un père
de devoir admettre l'indignité de son fils. Encore ce père
doit-il savoir prendre ses responsabilités, et à
plus forte raison lorsqu'elles engagent tout un empire. C'est
donc le cœur labouré, mais la voix claire, qu'en présence
de sa fille Lucilla, Marc Aurèle informa de ses décisions
le jeune et brillant tribun Livius que ce serait lui, Livius,
et non son fils Commode, qu'il chargeait de l'écrasante
succession de son empire ! Très digne, Lucilla écouta
sans broncher ces quelques mots qui entravaient son avenir; de
très tendre sentiments l'unissaient à Livius, qui
le lui rendait bien. Et elle pressentait obscurément combien
les charges de l'empire allaient peser sur leur amour naissant.
Sinistre pressentiment qu'un fait apparemment anodin allait s'empresser
de confirmer. A l'issue de cet entretien si lourd d'importance,
Lucilla et Livius se heurtèrent au fourbe Cléandre,
prophète aveugle et âme damnée de Commode.
De ses yeux morts jaillissaient des éclairs de haine et
de violence sur lesquels Lucilla ne se méprit point. Cléandre,
de toute évidence, avait éventé le secret
des décisions de Marc Aurèle. Et de ce Cléandre,
Lucilla savait qu'il n'y avait pas moins à redouter que
de la malédiction de tous les dieux !
Quelques jours passèrent pourtant, sans raviver les appréhensions
de Lucilla. Livius avait rejoint ses troupes et dirigé
une expédition punitive contre une tribu barbare plus turbulente
que permis. Malheureusement, cette modeste opération avait
failli tourner à la confusion de Rome en raison de l'intervention
intempestive de Commode, soudain soucieux de glaner quelques faciles
lauriers de stratège. Excédé, Livius le provoqua
en un combat singulier : une course de chars effrénée
dont le vainqueur devrait précipiter le vaincu du haut
d'un rocher. Comment allait se terminer cette course implacable,
et pas toujours très régulière de la part
de Commode ? ... Le mieux du monde ! En fait, Commode était
trop éprouvé par sa vie de débauches pour
prendre le meilleur sur un Livius rompu à toutes les disciplines
sportives. Longtemps indécise, la course finit par donner
l'avantage à Livius. Mais, ivre de rage, Commode se tendit
en un effort désespéré qui l'amena à
deux doigts de sa perte; au moment même où son char
déséquilibré, s'abîmait dans le vide,
Livius le rattrapa, le sauvant ainsi de la mort.
Convaincu de s'être acquis la gratitude éternelle
de Commode, Livius a rejoint Lucilla, qu'il informe des récents
événements. Lucilla, hélas ! n'a pas le cœur
à rire. Ainsi qu'elle le redoutait, son chemin va s'écarter
à jamais de celui de Livius : Marc Aurèle vient
en effet d'accorder sa main à Sohamus, le roi d'Arménie.
D'abord effondré, Livius reprend vite le dessus et presse
Lucilla de s'enfuir avec lui loin des intrigues de l'Empire. Que
pèsent la gloire et les honneurs à côté
de toute une vie de bonheur à deux ?
Peut-être Livius serait-il parvenu à convaincre
Lucilla s'il n'avait été interrompu par la plus
tragique des nouvelles : Marc Aurèle agonisait. Ah ! ce
n'était pas pour rien que Lucilla s'était méfiée
de Cléandre ! Profitant de ses petites entrées chez
l'Empereur, le prophète de malheur lui avait offert une
pomme empoisonnée. Lucilla et Livius, atterrés,
assistent en ses derniers instants l'Empereur, qui use ses derniers
souffles à chuchoter le nom de Livius.
Mais aucun testament, aucun document officiel n'existe pour attester
que Livius, et non pas Commode, est bien l'héritier désigné
par l'infortuné Marc Aurèle. Rien ne s'oppose à
l'accession de Commode au trône de l'Empire, même
pas Livius, qui renonce sans lutte ni amertume à ses ambitions
légitimes. Commode se fait donc proclamer empereur. Sur
une flamme sacrée, Livius lui prête serment de loyalisme
et, en échange, se voit promu général en
chef des armées romaines.
Lucilla, pour sa part, cache mal le désenchantement que
lui inflige le renoncement de Livius. Fille d'empereur, il lui
est déjà difficile d'admettre son indifférence
vis-à-vis du trône ! En outre, elle le juge sévèrement
pour son inertie à faire respecter les dernières
volontés de Marc Aurèle. Pour elle, la raison d'Etat
prime toutes les autres, y compris celles du cœur ! Elle
le prouve en épousant l'homme que son père lui avait
désigné : Sohamus. Rarement vit-on épousée
aussi lugubre, mais rarement aussi femme eut autant qu'elle le
sentiment du devoir accompli. Plaise aux dieux qu'elle en doive
jamais le regretter !
Et la vie continue ! Pour oublier ses peines de cœur,
Livius s'est jeté à corps perdu dans ses nouvelles
responsabilités de général en chef. N'ayant
jamais admis la demi-défaite que lui avaient infligée
les barbares et bien que sachant parfaitement que Commode en était
le vrai responsable, il décide une nouvelle expédition
punitive. Oublieux de toute pitié comme de la plus élémentaire
humanité, il les traque dans leurs derniers retranchements,
décime leurs rangs et s'empare de leur chef Ballomar.
Mais en Livius, la bonté et la générosité
ne se sont qu'assoupies ! Timonidès l'a bien compris, qui,
en philosophe et ardent supporter des idées généreuses
de Marc Aurèle, croit, tout comme ce dernier, que l'amour
peut triompher de la haine. Son vibrant plaidoyer en faveur des
barbares hirsutes et sidérés par tant de générosité
ébranle Livius, qui promet d'intervenir près de
l'Empereur pour leur assurer la paix.
Ce que Livius ignore, c'est que Commode incline moins que jamais
à l'indulgence en ce moment où les ennuis affluent
de tous côtés. Ainsi Lucilla est-elle rentrée
à Rome pour l'informer de ce qu'une rébellion se
fomente à l'Est, à la suite des taxes excessives
imposées au peuple. Au vrai, si Lucilla s'est faite elle-même
messagère d'aussi mauvaises nouvelles, c'est moins dans
le désir de revoir son frère que dans l'espoir de
retrouver Livius, que toute sa volonté n'a nullement réussi
à effacer de son cœur.
Et effectivement, les deux amoureux séparés se retrouveront,
mais pas tout à fait comme ils l'avaient rêvé.
Tandis que Commode enjoint à Lucilla de retourner en Arménie,
il ordonne à Livius d'aller écraser des régiments
romains félons qui, à la frontière de l'Est,
ont rejoint les forces rebelles avec l'intention non déguisée
d'envahir Rome et de le contraindre, lui, Commode, à l'abdication.
 |
Malgré sa répugnance à opposer des Romains
à d'autres Romains, Livius accepte. Il n'a d'ailleurs pas
le choix ! Dans les plaines de l'Est, il rencontre donc les armées
de Sohamus, bien décidé à s'alléger
une fois pour toutes de l'écrasante tutelle romaine. Une
fois de plus, Lucilla supplie Livius de se joindre à eux
afin de détruire ensemble la néfaste autorité
de Commode. Livius refuse, et le combat s'engage, terriblement
inégal, entre les troupes minoritaires de Livius et toute
l'armée de Sohamus...
Bien qu'inégal, l'affrontement évolue très
vite en faveur de Livius, dont les extraordinaires talents de
stratège n'ont jamais trouvé à mieux s'employer.
Bientôt, la vaste plaine ne constitue plus qu'un gigantesque
brasier où viennent s'abîmer les hordes arméniennes.
 |
Livius n'est pas le dernier à la peine. Pour lui, il
s'agit surtout de s'emparer de Sohamus, seul moyen de mettre un
terme à ce combat sanguinaire. A peine l'a-t-il rejoint
qu'un javelot le frôle et cloue son adversaire au sol !
Mais Lucilla, abusée par les apparences, pourra-t-elle
jamais croire que ce n'est pas lui qui a tué son mari ?
Ainsi que Livius s'y attendait, Lucilla ne lui pardonne pas la
mort d'un époux qu'elle n'aimait guère, sans doute,
mais auquel l'unissaient les profonds liens de sa loyauté.
En la ramenant vers Rome, Livius lui multiplie les prévenances,
s'efforçant de lézarder le mur de silence qu'elle
lui oppose. En pure perte.
C'est en quelque sorte Commode qui favorisa leur réconciliation.
Ayant évidemment appris la victoire aussi brillante qu'inespérée
de Livius sur les rebelles, il lui avait fait parvenir une dépêche
par laquelle il s'engageait à partager le trône de
Rome avec lui. C'était compter sans Livius, qui ne se contenta
même pas de refuser : il lui répondit aussi qu'il
devait y avoir une nouvelle Rome, dirigée par un nouvel
empereur.
Cette insolence mit Commode dans une rage indescriptible. Pour
l'assouvir, il ne trouva rien de mieux que de charger ses gardes
de saccager le village barbare et de ramener Ballomar et son peuple
à Rome, pour y être brûlés vifs. C'est
en effet Livius, on s'en souvient, qui avait intercédé
pour la grâce des barbares. Timonidès, ici agonisant,
essaya bien d'entraver le massacre qui se préparait, mais
il le paya de sa vie. Avec lui, c'est un peu du bon Marc Aurèle
qui mourut une seconde fois !
C'est ainsi qu'approchant de Rome, Lucilla et Livius trouvent
en cendres le village barbare qu'ils avaient toutes raisons de
croire ami. Tant de fourberie leur donne la nausée. Tout
au moins cette cruauté installe-t-elle en Livius la volonté
inébranlable d'en finir une fois pour toutes avec Commode
!
Abandonnant Lucilla aux portes de Rome pour lui éviter
des risques inutiles, Livius pénètre dans la ville,
tout entière livrée aux sauvages festivité
des Saturnales. Livius affronte Commode dans le Temple de Jupiter
et somme le Sénat de décréter quelle Rome,
celle de Marc Aurèle ou celle de Commode, présidera
aux destinées de l'Empire. Le Sénat prend le parti
de Commode.
Aux portes de Rome, c'est l'anarchie totale. Pressentant que Livius
ne se tiendra pas pour battu et tentera un coup d'Etat avec l'appui
de ses légions, Commode leur a envoyé des chariots
remplis d'or, sur lesquelles les soldats se ruent avec l'avidité
que l'on imagine. C'est bien en vain que Lucilla tâche de
faire entendre la voix de la raison. Ne pourra-t-elle rien tenter
pour endiguer l'imminente catastrophe ?
Si pourtant ! Lucilla puise en son courage et en son amour la
force de prendre sur elle tous les risques. Elle a réuni
à grand-peine quelques soldats d'une loyauté à
toute épreuve; avec eux, sur son char, elle fend la foule
romaine en direction du Palais Impérial. Sa décision
est prise : elle tuera Commode de ses mains. Mais Livius est-il
encore en vie ?
Il l'est, mais pas pour longtemps. Un gigantesque bûcher
barre tout le Forum; les barbares y sont enchaînés,
et Lucilla s'affole d'y reconnaître Livius, ligoté
lui aussi et prêt à être brûlé
vif sur les ordres de Commode. N'écoutant que la voix de
son cœur, Lucilla se rue vers Livius... pour bientôt
se retrouver sur le bûcher, enchaînée à
ses côtés. La victoire de Commode semble totale.
Pourtant un scrupule inattendu vient d'assaillir Commode. En fait,
il s'agit moins d'un scrupule que d'un souci, vital pour lui,
de bien reprendre son peuple en mains. Il suggère alors
à Livius un combat singulier, qui permettra aux dieux de
désigner celui qui doit dicter sa loi à Rome.
 |
Bien que rompu par toutes les épreuves qu'il vient
de traverser, Livius accepte, et en plein Forum, dans une sorte
de ring formé par des boucliers, un terrible duel s'engage
entre les deux hommes. Un duel qui ne pourra prendre fin que par
la mort de l'un des combattants. Sur le bûcher, Lucilla
assiste, éperdue, au combat. Dans ce furieux quitte ou
double, Commode est moins que jamais soucieux de la régularité
de ses attaques.
 |
Un coup bas lui permet de désarmer Livius, lequel rassemble
ses pauvres forces en un effort surhumain... Un moment plus tard,
Commode gît sur le sol, le corps transpercé d'un
javelot. Livius ne prend même pas le temps de savourer sa
victoire : il se rue vers le bûcher que l'on vient d'embraser,
et c'est d'extrême justesse qu'il arrache aux flammes Lucilla.
Les barbares, hélas ! doivent être abandonnés
à leur sort. Et tandis qu'une âcre odeur de chair
brûlée envahit le Forum, Livius prend dans ses bras
le cadavre du responsable de cet odieux massacre. Il en fera volontiers
cadeau à Rome, au Sénat, aux dieux, à quiconque
le réclamera... Mais personne (et surtout pas Rome) ne
revendique la dépouille de celui qui l'amena si près
de sa perte.
 |
Quant à Lucilla et Livius, ils en ont assez de Rome,
de ses cruautés, de ses intrigues et de ses ignominies.
Il n'est pas nécessaire de régner sur un empire
pour vivre parfaitement heureux; il suffit d'être à
deux, de s'aimer vraiment et de régner l'un sur l'autre
plus sûrement que sur un royaume ! Cette sagesse-là,
Lucilla et Livius ont mis du temps à la comprendre, mais
ils n'en sont que mieux décidés à l'appliquer.
Fi de Rome, des honneurs et des ennuis ! Désormais ils
ne vivront plus que pour leur amour, cachés de tous et
de tout. Rome survivra bien sans eux. Si tant est, bien sûr,
qu'elle soit appelée à survivre. En fait, pour elle,
c'était le commencement de la fin. La chute de l'Empire
romain.»
|
programme (Bonnes Soirées, tiré-à-part)
|
| |
11.5.
Les intentions des scénaristes (documentation de presse)
La période de civilisation la plus heureuse et la plus
prospère pour l'humanité se situe au IIe s., à
l'époque où l'Empire romain s'étendait de
la Grande-Bretagne à l'Arabie et de l'Espagne à
la Turquie, avec à l'épicentre la merveilleuse cité
de Rome. Cet empire puissant et respecté est resté
jusqu'à ce jour le seul dans toute l'histoire qui ait pu
conquérir le monde entier, tout au moins celui connu à
cette époque.
Les classes de la Société y formaient un ensemble
harmonieux qui fit l'admiration des philosophes, des historiens,
de ses sujets et même de ses ennemis. Rome semblait éternelle
lorsque l'Empereur Marc Aurèle mourut et fut remplacé
par Commode, un homme dont les folies et la passion du pouvoir
entraînèrent, après douze années d'infamies
croissantes, la disparition des dernières vertus qui avaient
fait sa grandeur, et provoquèrent sa chute.
Cette page d'histoire répétée maintes et
maintes fois et même encore de nos jours, se renouvellera
sans doute jusqu'à la fin des temps. Cependant la chute
de l'Empire romain fut à une telle échelle qu'elle
n'a jamais été dépassée. Le cinéma
mondial attendait depuis longtemps ce récit, le plus passionnant
qui puisse être raconté; cependant aucun producteur
n'avait tenté jusqu'ici de porter à l'écran
un sujet aussi vaste.
Mais Samuel Bronston, encouragé par le succès de
ses célèbres productions Le Cid et Les
55 Jours de Pékin, décida que ce sujet pouvait
être filmé, et pour cela il a employé une
telle richesse de moyens qu'il s'est lui-même surpassé.
Pour La chute de l'Empire romain les décorateurs
Colosanti et Moore ont recréé grandeur nature le
Forum tel qu'il existait il y a dix-huit cents ans. Fidèle
à l'histoire dans chaque détail, c'est le plus grand
décor qui ait jamais été construit pour un
film, à aucune époque, dans le monde entier. Il
couvre cent hectares de la campagne espagnole et de nombreuses
scènes d'intérieur ont été tournées
dans les vastes studios de Samuel Bronston à Madrid et
de Cinecittà à Rome.
Pour la mise en scène d'un film de cette importance, le
producteur Samuel Bronston a fait appel à Anthony Mann
dont la réalisation du film Le Cid fut acclamée
par tous. Il est passé maître dans l'art de diriger
le déploiement des grandes scènes de batailles,
mais il a aussi la sensibilité nécessaire pour rendre
l'atmosphère des scènes d'amour et de drame.
La musique faisant partie intégrante d'un grand film, la
partition de ce film a été composée par Dimitri
Tiomkin, lauréat de l'«Academy Award».
La chute de l'Empire romain est le couronnement de l'œuvre
de Samuel Bronston qui en quelques années est devenu le
producteur le plus en vue de l'industrie cinématographique.
De son quartier général à Madrid, il contrôle
toute une organisation qui se consacre entièrement à
l'élaboration de chaque phase de la production, depuis
la recherche du sujet d'un film jusqu'à la présentation
de celui-ci dans les cinémas du monde entier.
Des esprits chagrins ont fait reproche à Samuel Bronston
d'avoir fait subir à l'Histoire des outrages qui, à
leurs yeux, sont impardonnables. Ils affirment, par exemple, que
l'Empereur Marc Aurèle n'avait pas de fille (2).
Gageons que, malgré ces avis érudits - et pour
imiter un vers célèbre - «Tout Bruxelles
pour Lucilla aura les yeux de Livius».
Voici d'ailleurs, à ce sujet, un avis autorisé.
Le Dr Will Durant, l'éminent historien, conseiller du film
La chute de l'Empire romain pendant son tournage, affirme qu'il
est «fidèle à l'histoire au point de l'éclairer».
Il dit encore : «Nous demandons à un roman
ou à une pièce historique d'être fidèles
aux événements majeurs et aux personnages de l'histoire
dont ils s'inspirent, et je crois que ce film y parvient.»
En dépit de ses 78 ans, le Dr Durant ajoute : «J'avoue
que j'aime aussi les histoires d'amour, et qu'il ne me déplaît
pas du tout de voir de temps à autre les yeux ensorcelants
de Sophia Loren dans les remous d'un empire à l'agonie.
Il est doux de sentir que malgré tout ce qui peut s'écrouler
autour de nous, la femme demeure, et suffit à nous combler.» |
documentation presse - avant-première
à Bruxelles
|
| |
11.6.
Le producteur : Samuel Bronston
Samuel Bronston, américain né en Russie mais élevé
en France (études de musique et de lettres à la
Sorbonne, puis sciences politiques), avait déjà
produit à Hollywood Martin Eden, Jack London et
Walk in the Sun avant de s'installer comme producteur indépendant
en Espagne, où il rachète les studios Chamartin
(à 16 km de Las Matas, où seront construits les
décors).
Un accord est conclu avec le gouvernement franquiste, prévoyant
des facilités fiscales et l'abondante figuration de l'armée
espagnole. Vantant implicitement la beauté des paysages
espagnols, les films étaient censés attirer les
touristes et ainsi - indirectement - améliorer l'image
de la dictature à l'étranger. Son initiative lui
vaut d'être promu dans l'Ordre royal américain d'Isabelle
la Catholique.
On tourna dans les studios Bronston, John Paul Jones
(1959 - avec Robert Stack et Bette Davis); El Cid, Anthony
Mann (1961 - avec Charlton Heston et Sophia Loren); Le Roi
des rois, Nicholas Ray (1961) et Les 55 jours de Pékin,
Nicholas Ray (1963 - avec Charlton Heston et Ava Gardner).
La chute de l'Empire romain sera aussi la «chute
de l'empire Bronston», dont les ramifications s'étendaient
à 7 succursales internationales : New York, Hollywood,
Londres, Paris, Rome, Buenos-Aires et Tokyo; ruiné par
cette entreprise, Samuel Bronston sera obligé de s'enfuir,
traqué par le fisc espagnol.
Interview de S. Bronston (extraits)
[Jo VAN COTTOM]
De la fidélité historique
 Restez-vous entièrement
fidèle à l'Histoire ?
Restez-vous entièrement
fidèle à l'Histoire ?
S.B. Nous restons fidèles à
la vérité historique tant que cette fidélité
ne nuit pas à la valeur «entertainment» de
notre film mais, de toute manière, nous ne nous éloignons
jamais beaucoup de l'Histoire parce qu'alors, cela devient ridicule.
 Concevez-vous votre
film exclusivement sur un plan «spectacle» ou estimez-vous
que les grands films historiques possèdent une valeur éducative
?
Concevez-vous votre
film exclusivement sur un plan «spectacle» ou estimez-vous
que les grands films historiques possèdent une valeur éducative
?
S.B. Tous les films historiques possèdent
une valeur éducative et c'est une des raisons pour lesquelles
nous en faisons. Nous essayons de toucher autant que possible
toute la famille, du père aux enfants et, jusqu'ici, nous
y avons parfaitement réussi. Sans que cela n'apparaisse
trop, nous voulons donner une leçon.
Du «Kolossal»...
 Selon vous, quelle est
la chose qui a l'importance la plus déterminante : la dimension
du sujet ou la dimension du procédé technique ?
Selon vous, quelle est
la chose qui a l'importance la plus déterminante : la dimension
du sujet ou la dimension du procédé technique ?
S.B. La dimension de la conception
du sujet. Sur le plan technique, tout est plus ou moins établi
de manière permanente.
Des projets qui n'aboutiront pas...
 Vous m'aviez dit un
jour - je crois que c'était lors de la réalisation
du Cid - que vous pariiez sur le Marché Commun.
Vous qui travaillez en Espagne, seriez-vous aidé si l'Espagne
entrait dans le Marché Commun ?
Vous m'aviez dit un
jour - je crois que c'était lors de la réalisation
du Cid - que vous pariiez sur le Marché Commun.
Vous qui travaillez en Espagne, seriez-vous aidé si l'Espagne
entrait dans le Marché Commun ?
S.B. Sur un plan économique,
je ne pense pas que ce serait plus intéressant pour nous
qu'aujourd'hui, mais nous serions aidés sur le plan politique
: il y aurait un relâchement de la tension actuelle.
 Je sais que, tandis
que La chute de l'Empire romain voit le jour, vous préparez
déjà vos prochaines productions. Pourriez-vous m'en
parler ?
Je sais que, tandis
que La chute de l'Empire romain voit le jour, vous préparez
déjà vos prochaines productions. Pourriez-vous m'en
parler ?
S.B. En juillet de cette année,
nous commencerons un film avec Frank Capra, Le Cirque [Quand
le cirque était roi], pour lequel nous avons une
distribution assez brillante : John Wayne, Claudia Cardinale et
David Niven. A notre programme de 1964, nous avons deux films
de grande dimension : Paris 1900 [réalisateur envisagé
: Vittorio de Sica] et un film pour lequel je viens seulement
de signer le contrat mais qui possède un magnifique sujet
: The Night Runners of Bengale [Les révoltés
du Bengale]. Nous le réaliserons entre l'Angleterre
et l'Espagne. Le sommet de notre production sera sans doute
La Révolution française, prévu pour 1965
(3).
|
propos
recueillis par Jo van COTTOM (4)
|
| |
11.7.
Le réalisateur : Anthony Mann
Anthony Mann (1906-1967), célèbre pour ses films
policiers et, surtout, ses westerns avec James Stewart (Winchester
73 (1950), L'homme de la plaine (1955), Je suis
un aventurier (1955), etc.), avait déjà fait
deux brèves incursions dans le péplum. D'abord en
tournant l'incendie de Rome pour Quo Vadis (Mervyn Le Roy,
1951). Ensuite en commençant le tournage du Spartacus
(1959) de Kirk Douglas; celui-ci le remplacera rapidement (5)
par Stanley Kubrick. Douglas lui reprochait notamment de s'être
laissé embobiner par le cabotinage de Peter Ustinov, qui
se croyait la vedette du film !
La chute... fut sa seconde collaboration avec S. Bronston,
pour le compte de qui il avait déjà réalisé
El Cid en 1961.
La direction de la seconde équipe (scènes de foule,
batailles, poursuite en char) sera confiée à Andrew
Marton et Yakima Canutt, qui avaient déjà travaillé
ensemble sur la course de chars de Ben Hur (1959).
A Jo van Cottom, Anthony Mann déclarera : «Il
ne faut pas se moquer du public. Il est devenu plus difficile.
Durant les années de guerre, il allait voir n'importe quoi
pour échapper à l'étau de la réalité.
A présent, les gens achètent des frigidaires, des
voitures, ils prennent des vacances; de ce fait, le film doit
être de qualité pour que le spectateur se dérange»
(6). |
| |
|
| |
11.8.
Les lieux de tournage
Construction du décor : travaux préparatoires :
automne 1960; la construction du Forum débute au 1er octobre
1962.
Premier coup de manivelle : 14 janvier 1963 (dans la forteresse);
durée du tournage : 143 jours, dont 69 consacrés
à des scènes d'action.
Coût : 8 milliards d'anciens francs. 6.000 figurants, 500
techniciens, 1.500 chevaux.
Les décors extérieurs de Rome (le Forum romain,
les Portes de la ville, la voie Appienne, le village barbare)
ont été construits sur quelque 220.000 m2 par Veniero
Colasanti et John Moore dans un ancien champ de seigle, sur l'emplacement
du décor de «Pékin» (dont des éléments
seront récupérés), à Las Matas, à
50 km de Madrid, sur la route de l'Escorial, ancienne demeure
historique des rois d'Espagne.
Au niveau du péplum Veniero Colasanti et John Moore,
architectes de théâtre et d'opéra, étaient
déjà coauteurs des décors de Fabiola
(1947), et en ce qui concerne les productions Bronston, du décor
de Pékin, dans les 55 jours...
La construction du Forum nécessitera 2 ans de recherches
et 3.000 croquis pour les 27 structures figurant les principaux
monuments. 1.100 ouvriers y participeront pendant 7 mois avec
le concours de 400 sculpteurs et spécialistes du travail
sur plâtre.
Après le tournage (et la fermeture des studios Bronston),
le décor deviendra une attraction touristique; en 1966,
Richard Lester viendra y tourner une comédie musicale d'après
Plaute, Le Forum en folie.
La forteresse sur le Danube : au nord de Madrid, dans la Sierra
Guadarrama (à 27 km de Ségovie).
La bataille contre les Perses : plaine bosselée de Manzanares
El Real.
D'autres extérieurs sur les bords du lac Santillana (Espagne
centrale).
Les intérieurs dans les Studios S. Bronston à Madrid,
et de Cinecittà à Rome (cinq à Rome, dont
la chambre de Lucilla - le Gymnase de Commode - le Temple de Jupiter
- la salle du trône impérial [7]). |
| |
11.9.
Dialogues du film (extraits) (8)
11.9.1. Pax Romana
Où l'empereur Marc Aurèle voit défiler
nombreuses les délégations de ses gouverneurs de
provinces et les salue, aidé en cela par son ami et
nomenclator Timonidès. Après une importante ovation,
Marc Aurèle pourra faire son discours :
(Défilé bruyant des cavaliers.)
TIMONIDES (soufflant les noms des officiels) :
— Pertinax, de Bretagne.
MARC AURÈLE (s'exécutant) :
— Bienvenue à Pertinax
de la lointaine Bretagne...
(Temps musical, défilé.)
QUELQU'UN, dans la foule des soldats, poussant le premier
cri de salut :
— Gloire à César
!
LES DÉLÉGUÉS, faisant chorus :
— Gloire à César
! Gloire à César ! (le cri s'amplifiant)
Gloire à César ! (l'enthousiasme dégénère
en cris emmêlés).
MARC AURÈLE (prenant enfin la parole) :
— Princes ! Proconsuls ! Gouverneurs
! (Un temps.) Vous êtes venus des sables des déserts
de l'Egypte, des montagnes altières de l'Arménie,
des forêts touffues de la Gaule, et des plaines ensoleillées
de l'Espagne. (Temps.) Vous êtes issus de races différentes,
vos mœurs et vos coutumes ne se ressemblent guère;
vous avez chacun votre langue et vos chants. Vous n'adorez pas
les mêmes dieux... et pourtant, comme les branches épaisses
d'un chêne majestueux, vous êtes tous les ramifications
d'un même tronc, puissant et tutélaire : Rome ! (Temps.)
Regardez autour de vous : le spectacle qui s'offre à vos
yeux ne suffit-il pas à évoquer la majesté
de Rome ? et la grandeur de son œuvre ? Il y a deux siècles
encore, les Gaulois étaient nos plus farouches ennemis
: nous les saluons maintenant comme des frères ! A la surface
du monde, il ne reste que deux petits territoires qui nous soient
hostiles : l'un est au nord, et les peuplades qui l'habitent méritent
à juste titre l'appellation de barbares; l'autre est à
l'est, la Perse ! (Temps.)
Il n'y a qu'à ces deux frontières que vous trouverez
encore des forts, des palissades, des tranchées et de la
haine. Mais ce ne sont pas là les frontières que
Rome désire. (Temps.) Rome... recherche des voisinages
fraternels...
Nous avons dû soutenir de longues guerres... Votre contribution
a été épuisante... mais le terme approche,
nous atteindrons le bout de la route. Ainsi, nous allons connaître
tous l'âge d'or de la paix retrouvée : l'ère
de la Paix romaine ! Quel que soit votre pays, quelle que soit
la couleur de votre peau, la paix, une fois rétablie, vous
conférera à tous - à tous ! - les droits
suprêmes, qui sont les privilèges des citoyens romains
!
La foule GUERRIÈRE : Vaste éclat d'approbations
- Ovations.
(Marc Aurèle manifeste la douleur; il chancelle : Livius
se précipite à son côté.)
LIVIUS (inquiet) :
— Qu'y a-t-il, César,
tu es souffrant ?!
MARC AURÈLE (la voix étranglée) :
— Ce n'est qu'une petite douleur
au côté, ça passera...
(Reprenant avec vigueur :) Plus de provinces, plus de colonies,
rien que Rome. Rome sera partout une famille de peuples égaux
! Tel... tel doit être l'avenir !
La foule GUERRIÈRE : Ovations générales.
MARC AURÈLE (à part soi) :
— Puissent les dieux hâter
ce jour...
(Les ovations se poursuivent.)
11.9.2. L'esclavage n'est pas
rentable
Retour de Pannonie, Livius et Timonidès veulent convaincre
le Sénat de l'opportunité qu'il y aurait à
affranchir des esclaves - à accueillir en alliés,
sur le territoire de l'Empire, les barbares vaincus.
(Tumulte du sénat.)
ANNONCIATEUR :
— Caius Livius, conquérant
des Germains !
FOULE (acclamations générales) :
— Caius ! Germanicus ! (Tollé
et hourra général.)
(Après un temps d'acclamations, Livius prend la parole.)
LIVIUS (solennellement) :
— Vous qui m'accordez votre
attention (temps), vous qui avez salué en moi le
soldat (temps), vous qui avez bien voulu me porter en triomphe
(temps)... : je vous remercie. Mais vous avez une décision
difficile à prendre, aujourd'hui, et il ne faudrait pas
que moi, en qualité de soldat, j'influence votre vote.
(Temps.) Aussi je demande à César (temps)
qu'un homme, qui ne soit ni un soldat ni un sénateur, mais
un philosophe, un homme plein de sagesse (temps), puisse
prendre la parole à ma place.
(Assentiment silencieux de César Commode, suivi de
l'entrée de Timonidès. Léger brouhaha, lorsque
apparaît Timonidès.)
TIMONIDÈS (d'une voix modeste, presque timide et inquiète)
:
— Concitoyens romains...
Les SÉNATEURS (en chœur) :
— ... grecs ! ... grecs !
... grecs !
TIMONIDÈS (ton de justification) :
— Par la naissance je suis
Grec, mais Romain par le cœur.
Un SÉNATEUR (impétueux) :
— Esclave ! (Approbations
enchaînées du sénat entier.)
TIMONIDÈS (ton raisonnable) :
— Je suis né esclave,
mais j'ai gagné ma liberté. (Temps. Reprenant
sur un ton de concession :) Concitoyens romains... (temps
de réflexion) je suis précepteur... et lorsque
je constate, après avoir répété une
centaine de fois la même chose à un élève,
qu'en dépit de tout il continue à ne pas comprendre
la leçon que je lui enseigne, je suis bien forcé
d'en conclure qu'il y a probablement un défaut quelconque,
soit dans la leçon (temps)... soit chez le précepteur...
(Temps.)
Cent fois nous avons essayé de persuader ceux que nous
nommons barbares combien il peut en coûter de faire la guerre
contre Rome, en brûlant leurs villages, en crucifiant leurs
guerriers et en réduisant leur jeunesse à l'esclavage.
Les incendies s'éteignent, on enterre les morts, les esclaves
meurent, peu à peu. (Temps.) Mais la haine que nous
avons semée derrière nous, subsiste ! (Ton de
colère.) La haine amène les guerres; les guerres
provoquent des impôts... (Temps.) Et combien de malheurs
encore ? La misère (temps), la faim, les maladies,
tout cela est désastreux, ruineux ! (Temps.) Et
pourtant, la solution est simple : il nous faut cesser de faire
la guerre.
Un SÉNATEUR (indigné) :
— Cesser de faire la guerre
?! (Temps.) Alors que tes amis ne cessent de nous attaquer
? (Temps.) C'est une trahison ! (Temps.) Tous ces
peuples ont montré assez clairement ce qu'ils désirent
: notre destruction ! et la destruction de la civilisation romaine
!
TIMONIDÈS (ferme mais souple) :
— Je le maintiens : la solution
est simple. Il faut transformer ces amis, que vous me reprochez,
en citoyens pacifiques. Confions-leur, pour les cultiver, nos
terres abandonnées. Non seulement ils produiront de quoi
se nourrir eux-mêmes, mais je vous le certifie, plus tard,
ils enverront des vivres à Rome.
Un SÉNATEUR (impérieux) :
— Oui, je suis d'accord !
qu'ils cultivent ces terres ! qu'ils produisent des vivres, mais
comme esclaves ! (Temps.) C'est ainsi que nous avons toujours
fait !
TIMONIDÈS (démonstrateur) :
— Niger avait autrefois 20.000
esclaves sur ses propriétés. Que sont-ils devenus
? Tous sont devenus des affranchis ! Pourquoi ?! (Temps.)
Peut-être Niger est-il ennemi de l'esclavage ?! (Rires
commençants.) Hein ? (Rires déclarés.)
Non, parce qu'aujourd'hui il n'est plus avantageux d'avoir des
esclaves. Les esclaves produisent moins que des hommes libres.
Cherchons donc ce qui est à la fois profitable (temps)
et juste. Accordons à ces gens-là le plus grand
bien qui soit. Ne leur refusons pas le droit de jouir de la liberté
romaine. La nouvelle se répandra dans le monde que Rome
les a admis comme des égaux, et c'est seulement alors (temps)
que nous aurons nos frontières humaines !... la paix romaine,
que Marcus Aurelius avait promise... !
(Tumulte : mélange d'approbations et de condamnations.)
Le porte-parole de CÉSAR COMMODE :
— Au nom de César !
(Silence pesant, et reprise du porte-parole :) Un jour,
César me demanda à quel moment Rome fut-elle plus
grande et plus forte, et je répondis à César
: «Jamais Rome ne fut plus grande ni plus forte que maintenant
!» et à quoi devons-nous que l'Empire soit
ce qu'il est aujourd'hui ?! A notre dureté, à notre
intransigeance... (Temps.) Egalité... Liberté...
Paix ! (Temps.) Qui fait donc usage ce ces mots, à
part les Grecs, les Juifs et les esclaves ?! Rappelons-nous que
derrière ces barbares, il y en a des milliers d'autres,
dont l'arme guette une défaillance de notre part pour nous
anéantir ! Si nous acceptons ces barbares parmi nous, nos
ennemis se hâteront de proclamer que nous sommes faibles
! Alors ils fonderont sur nous de toutes parts ! Et ce sera la
fin de l'Empire romain. (Temps.) Ce sera la fin de... Rome.
Un SÉNATEUR (ton modéré) :
— La fin de Rome ? (Temps.)
Comment disparaît un empire ? Est-ce qu'il s'effondre d'un
seul coup ? dans un tremblement de terre ? Non... Non... ! mais
il arrive un temps où les peuples cessent peu à
peu d'y croire, et... c'est alors qu'un empire commence à
chanceler. (Temps.) Pères conscrits (temps),
j'ai vécu sous quatre grands empereurs... Trajan, Adrianus,
Antoninus... Marcus Aurelius... Et au cours de tant d'années,
notre Empire a grandi, a changé. La loi de la vie est de
grandir ou mourir. (Temps.) Et vous, les sénateurs,
vous êtes le cœur de Rome. C'est par votre voix que
le peuple s'exprime. (Avec conviction :) Parlez, pour que
le monde vous entende ! Que le monde sache (temps) que
Rome ne mourra pas. (Temps.) Ils sont des millions... (temps)
des millions qui guettent à nos frontières. Si nous
ne leur ouvrons pas nos portes, ils les briseront, et ils nous
briseront, nous aussi... mais (temps), au lieu de cela,
cherchons à grandir, de plus en plus, et à nous
étendre. Accueillons ces gens parmi nous... C'est avec
leur aide que l'Empire grandira encore. (Temps.) Honorables
Pères conscrits, nous avons changé le monde. (Temps.)
Ne pourrons-nous pas nous changer nous-mêmes ?...
Un SÉNATEUR (enthousiaste) :
— Oui ! Le temps est venu
!
Un second SÉNATEUR (poursuivant l'enthousiasme du premier)
:
— Que la guerre s'efface selon
la Paix romaine !
(Tumulte, conflits, empoignades. Le sénat ne semble
pas s'unir dans un tel enthousiasme.)
|
| |
 Les discours du film
Les discours du film
C'est le propre du roman historique de faire fleurir l'anachronisme
le plus insidieux.
Prenons donc l'exemple des deux superbes discours que nous avons
transcris ci-dessus. La fraternité
entre les membres de l'Empire dont parle Marc Aurèle
est un vœu pieux, qui n'a rien à voir avec ce que
serait tenté de comprendre le spectateur du XXe s. Le monde
antique est une société aristocratique où
le bien-être, il va sans dire, ne concerne que les citoyens
romains - ce qui exclut d'office non seulement les esclaves, mais
aussi les sujets libres de l'Empire (il faudra attendre l'édit
de Caracalla, en 212, pour voir conférer systématiquement
la citoyenneté à tous les hommes libres).
Mais le discours de Timonidès n'est
peut-être anachronique qu'en apparence. Anachronique dans
sa compréhension par le spectateur non averti de la «Weltanschauung»
antique. Il fleure bon le taylorisme nuancé de marxisme
: l'ouvrier est plus rentable que l'esclave. Mais le marxisme
et le taylorisme n'ont peut-être, après tout, que
réinventé ce que l'on croyait oublié et que
les Romains savaient déjà. N'a-t-on pas vu accéder
aux plus hautes charges de l'Empire des citoyens nouveaux, nés
d'affranchis, eux-mêmes fils d'esclaves venus à Rome
les fers aux pieds ? Quand ce n'étaient pas ces affranchis
eux-mêmes...
Le spectateur du XXe s. (oups... du XXIe s. maintenant, tout
va si vite !) à qui ce discours s'adresse en réalité,
ne retiendra, bien sûr, que l'interprétation «socialisante»
à laquelle nous a conditionné l'idéologie
de notre société industrielle - et qui a d'ailleurs
trois niveaux de lecture, selon que l'on est exploiteur, exploité
ou tout simplement exclu, et comportera encore bien des nuances
en fonction du contexte économique (prospérité,
récession). Le travail fait l'homme libre ! Le travail
ennoblit l'homme ! Un véritable blasphème pour un
citoyen romain antique...
On pouvait encore y croire dans les Golden Sixties.
Aujourd'hui il est difficile de s'y référer encore,
au vu de la mondialisation, du libéralisme sauvage et de
la politique des délocalisations (9)...
 Fellows Roman
Fellows Roman
En fait d'anachronisme, il paraît que l'expression par laquelle
Timonidès s'adresse au Sénat de Rome : «Concitoyens
romains» («Fellows Roman», dans la V.O.) a bien
fait rire certain critique lors de la sortie du film (Y.B., Le
Monde, 30 avril 1964 - cf. : «Critiques»).
Entendre les Romains parler anglais ou allemand, dans un film,
n'est pas plus choquant ou anachronique que le français
ou l'italien. Un film est destiné à être compris
par le plus large public possible, avec le vocabulaire en usage
dans cette langue. Fort heureusement, donc (hors les «confidentiels»
Sebastiane de Derek Jarman, et Rudens de R. Licoppe
[10]),
ces films sont donc diffusés non pas en latin, mais dans
une langue accessible. Accessible donc, et pas davantage ce jargon
pédant dans lequel Jean Lombard était passé
maître, lui qui truffait chaque phrase de ses romans de
deux ou trois mots grecs ou latins, ce même pour les objets
les plus banaux - «navigium» pour navire, par exemple
-, sans compter quelques-uns de ces pittoresques néologismes
dont la littérature «populaire» fin de siècle
était friande.
Bien sûr, il y a le choix des mots. Le soldat qui s'adresse
à son supérieur serait-il, selon notre goût,
plus «antique» (plus authentique ?, ou plus «parnassien»
?) lorsqu'il dit : «Seigneur», plutôt que «Chef»
- qui, lui, fait «pandore» (11)
!
Où irions-nous si Liz Taylor-Cléopâtre conviait
Antoine-Richard Burton à prendre dans son salon, non pas
une collation - pardon : un «breakfast», dans la V.O.
-, mais un «brachu deipnon» dans son «triklinion»
- ou quelque chose dans ce goût-là ?
Tout de même, «Fellows Roman», Concitoyens
romains, est plus sobre que le célèbre «Amis
Romains, Concitoyens» («Friends Roman, Countrymen»)
par lequel Antoine s'adressait au peuple (Jules César,
III, 2). «Countrymen» étant d'ailleurs équivoque
lorsque nous le traduisons, car il désigne aussi bien le
concitoyen que le paysan. Mais peut-être, au yeux d'un critique
borné, est-ce là précisément la différence
qu'il faut faire entre le saltimbanque inculte (puisqu'américain
!), le dialoguiste hollywoodien, «ce pelé, ce
galeux...» - et le grand William Shakespeare, génie
consacré par les belles lettres !
|
| |
|
| Suite… |
|
NOTES :
(1) Selon publ. belge. - Retour
texte
(2) Assertion ridicule. Outre Annia
Aurelia Galeria Lucilla (149), Marc Aurèle eut
au moins cinq autres filles : Annia Aurelia Galeria Faustina
(147), Domitia Faustina (...), Fadila (159 ?),
Cornificia (160 ?) et Vibia Aurelia Sabina (171-172)
(cliquez ici). -
Retour texte
(3) Autres projets : Isabelle de
Castille, et un troisième péplum, Cyrus
le Grand, jamais réalisés (N.d.M.E.). - Retour
texte
(4) Jo van COTTOM, «Samuel Bronston
m'a dit : La production de bons films arrêtera la crise
du cinéma», Bruxelles, Ciné-Presse,
n° 19, 11 mai 1963. - Retour texte
(5) Après quinze jours. - Retour
texte
(6) Jo van COTTOM, «Samuel Bronston
m'a dit : La production de bons films arrêtera la crise
du cinéma», Bruxelles, Ciné-Presse,
n° 19, 11 mai 1963. - Retour texte
(7) Selon Photo-Roman, n° 13,
1er juillet 1963. - Retour texte
(8) Transcription d'après la
bande-son : Gian Lhassa. - Retour texte
(9) En réalité, rien
de nouveau sous le soleil. Comment l'Empire britannique appauvrit-il
le sous-continent indien, si ce n'est en lui appliquant les
mêmes règles «libérales» (la
culture de l'indigo, par exemple) que celles auxquelles nous
nous voyons aujourd'hui confrontés, en Europe occidentale...
- Retour texte
(10) ... qui ont depuis fait école
avec Mel Gibson : latin et araméen pour La
Passion, yucatèque pour Apocalypto.
Certains docufictions BBC et autres marmonnent en bruit de fond
un latin à peine audible, écrasé par la
voix du narrateur (ainsi le français Brûlez
Rome !) - Retour texte
(11) C'est dans ce sens qu'«Alix»
passant du Lombard à Casterman, Jacques Martin remania
l'ensemble des phylactères de son Sphinx d'Or.
- Retour texte
|
| |
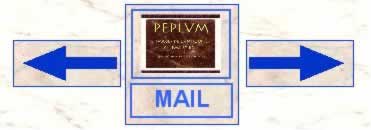 |
|