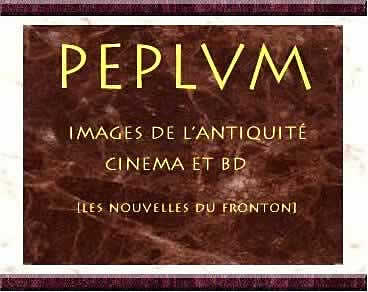 |
| |
| |
Spartacus : Blood and Sand
(13 ép. TV - prod. Starz)
(R. Jacobson, M. Hurst, J. Warn etc.,
EU - 2010)
Page 1/8
|
|
| |
|
| |
|
| |
Spartacus
: Blood and Sand
(13 ép. TV - prod. Starz)
(R. Jacobson, G. Hill, M. Hurst,
J. Warn etc., EU - 2010)
Cumulant toutes les situations, tous les fantasmes
sexuels possibles ou imaginables avec ou sans péplum, cette
production Starz réécrit, en somme, le roman de
Pauline Réage.
Nus, battus, saignants, humiliés ou sexuellement exploités
par des femelles toutes émoustillées, exhibés,
marqués au fer rouge et fiers de l'être, machines
à tuer consentantes ou résignées, la vie
de ces esclaves bodybuildés est entre les mains d'un lanista
qui est aussi un leno, au bord de la banqueroute, qui compte
et recompte ses sesterces, tout en flattant les puissants.
Une bizarre fascination se décante
de cette série atypique qui va plus loin qu'aucune autre
n'a osé. Spartacus : Blood and Sand plaira aux gays
comme aux hétéros que le gore ne rebute pas
trop : pénétrons dans cet univers onirique tout
de sexe et de violence, de maîtres et d'esclaves qui n'est
pas sans rappeler une certaine Histoire d'O, cette fois
resituée dans le monde romain. Après un succinct
rappel du personnage dans la littérature comme au cinéma,
suivi de l'examen des intentions du producteur Starz, nous diviserons
notre analyse en deux sections - sexe et violence.
1. Dans la première, nous nous pencherons sur les
mœurs antiques, la relation des Romains avec la nudité
ou les plaisirs du corps, surabondants dans la série; leurs
limites aussi. Avec un exemplum à la clé
: les robes de ces belles dames du Temps Jadis, que les costumiers
de cinéma imaginent très... glamour.
2. Ensuite la violence, bien évidemment exacerbée
dans ce qu'est une école de tueurs qui sont aussi des athlètes
de haut niveau, mais encore... des esclaves de qui on peut tout
exiger. Tout, tout, tout... L'exemplum, ici, s'impose de
lui-même : la gladiature à une époque charnière
de l'institution, c'est-à-dire quand la gladiature ethnique
devient la gladiature technique. Mais encore, les gladiateurs
et leurs satisfactions, leurs motivations, leurs armes et la manière
de s'en servir.
Rappel
historique
L'histoire est bien connue. C'est celle d'un gladiateur originaire
de la Thrace (l'actuelle Bulgarie), un ancien auxiliaire romain,
déserteur devenu brigand, repris et vendu comme esclave
à un laniste de Capoue nommé Lentulus
Batiatus. En 73 av. n.E., avec soixante-quatorze de ses camarades,
il s'évade et deux années durant tient le maquis
en Italie, anéantissant plusieurs légions romaines.
De nombreux esclaves fugitifs, voire même des miséreux
de condition libre (1)
le rejoignent. A un certain moment, rapporte Appien, ils seront
120.000 - dont il faut sans doute déduire un nombre substantiel
de femmes, d'enfants, de vieillards inaptes aux armes. Le déclin
de son épopée
s'annonce lorsque, suite à un désaccord avec le
Gaulois Crixus, un de ses lieutenants, ce dernier se sépare
de lui avec 10.000 hommes qui se feront exterminer au pied du
mont Gargano.
C'est finalement «l'homme le plus riche de Rome»,
M. Licinius Crassus - avec une armée équipée
à ses frais et soumise à une discipline féroce,
dont la décimation - qui au printemps 71, sur les bords
du Silarus, aura raison des rebelles. Six mille d'entre eux pourriront
sur les croix dressées le long de la voie Appienne, la
chaussée qui relie Capoue à Rome.
1. En guise d'introduction...
1.1. Le personnage littéraire
Avant que de devenir un héros revendiqué par certains
révolutionnaires de 1798, puis par les anarcho-communistes
allemands après la Guerre 14-18 comme Rosa Luxembourg,
il convient de rappeler que les trois «mamelles» littéraires
de Spartacus sont : 1) la pièce de Bertrand Joseph Saurin
(1760), 2) le roman garibaldien de Raffaello Giovagnoli (1874)
et 3) le roman communiste d'Howard Fast (1951) (auquel on peut
rajouter celui d'Arthur Koestler (1945)).
De ses origines nationalistes «giovagnoliennes», les
premières versions cinématographiques italiennes
gardent un certain embarras à fustiger la société
romaine esclavagiste, ce au moment précis où, renaissant
de ses cendres, la nation italienne est en quête de mythes
fondateurs (Oreste Gherardini [?], IT 1909; Giovanni Enrico Vidali
[2],
IT 1913; Ertugrul Mushin-Bey, URSS 1926; Riccardo Freda, IT-FR
1952). En ce sens, la version 1913 est particulièrement
gratinée en matière de gauchissement de faits historiques
bien connus : ayant battu les armées de Crassus, Spartacus
épargne ce dernier, qui en retour le promeut général
en chef de l'armée romaine (!). Un gladiateur rival de
Spartacus, Noricus, ayant assassiné Crassus, le Thrace
est condamné à périr - et périt -
sous les griffes d'un lion, dans l'arène.
Dans le roman de Giovagnoli, le gladiateur Spartacus était,
fin 79, libéré par Sylla suite à une prestation
exceptionnelle dans l'amphithéâtre. Homme libre désormais,
il entrait dans la mouvance de Catilina, l'aristocrate populiste
dont Cicéron allait seize ans plus tard démantibuler
les intrigues et la conjuration. Spartacus y devenait l'amant
de Valeria, la dernière épouse de Sylla, et en avait
même une fille, Posthumia.
Comme tous les intellectuels de son temps, Giovagnoli avait une
remarquable connaissance des événements et des personnages
de la fin de la république, mais ça ne l'empêchait
pas de faire son travail de... romancier !
1.2. Son adaptation à
l'écran
Dans les versions cinématographiques qui vinrent ensuite,
l'ancien esclave gardait cet esprit petit-bourgeois consistant
à vouloir à tout prix fréquenter la haute
société. Il était donc amoureux d'une patricienne
nommée Fausta (1909), de la fille de Crassus Elena (1913)
ou Sabine (1952), ou bien sûr et conformément au
roman, de Madame Sylla dans la version 1926. Ce qui causera sa
perte car, à l'écran, sauf Elena qui l'innocente
dans une fin alternative de la version 1913, et Valeria toujours
fidèle dans la version 1926, la digne patricienne romaine
le trahira et le livrera à ses ennemis (1909, 1952).
En 1913, quand la jeune Italie - qui venait de s'emparer de la
Tripolitaine et du Dodécanèse - était en
plein délire impérialiste, il aurait été
malvenu, dans un film, de minimiser la grandeur de l'Empire romain
par quelque critique de la brutalité de ses mœurs.
Et quarante ans plus tard, il n'en sera toujours pas temps comme
l'apprendra à ses dépends Riccardo Freda (3).
Aux Etats-Unis, le post-maccarthysme ambiant posera également
problème à Kirk Douglas et à Stanley Kubrick
(1960).
Voilà donc, dans les grandes lignes, l'état de la
question quant à ce sulfureux personnage que la Chaîne
câblée américaine Starz vient de le ressusciter
une fois de plus.
1.3. L'«effet Gladiator»
A l'orée du Troisième millénaire, réactivé
par l'«effet Gladiator» Spartacus a la cote
d'amour. Ce sont d'abord des docufictions britannique, The
Real Spartacus (Bill Lyons, GB - 2001, TV), et allemand,
Spartacus - Gladiator
gegen Rom (Günther Klein, AL - 2002, TV, ZDF). Ensuite,
parallèlement au remake TV du film 1960 tiré
d'Howard Fast, Spartacus
(Robert Dornhelm, EU - 2004, TV), nous aurons droit encore
à une comédie musicale [Spartacus le] Gladiateur,
il rêvait d'être libre (Elie Chouraqui, 2005)
et à une série d'animation italienne de 13 x 26',
Spartacus (Orlando Corradi, 2006). Des docufictions et
drames suivront comme Spartacus
(Oliver Dan, GB - 2005, TV), Heroes
and Villains : Spartacus (Tim Dunn, GB - 2008, TV), sans
oublier l'épisode ad hoc de la série américaine
Rome : Rise and Fall
of an Empire (Rex Piano, EU-GB - 2008, TV) ni le film
de terreur Morituris
de Raffaele Picchio (annoncé, mais sans nouvelles depuis).
|
| |
2. Starz Entertainement :
le retour de Spartacus
A l'origine de cette nouvelle série consacrée au
gladiateur thrace, il y a les concepteurs des sagas télévisuelles
Legendary Journeys of Hercules (4 saisons, soit 5 téléfilms
& 116 épisodes, 1994-1998) et Xena Warrior Princess
(6 saisons, soit 134 épisodes, 1995-2001). Ces séries
avec Kevin Sorbo et Lucy Lawless, produites voici une quinzaine
d'années par Renaissance Pictures pour Universal TV étaient
destinées à être programmées aux heures
de grande audience pour un public adolescent, et mettaient en
avant des bons sentiments de respect d'autrui et des différences.
Une démarche aussi pédagogique qu'anachronique :
«Il ne faut pas exclure le Cyclope; en réalité
il est très gentil et souffre de ce que sa taille gigantesque
et son visage difforme suscitent contre lui la méchanceté
des humains» (!). Hercules s'axait sur les effets
spéciaux numériques, les monstres mythologiques.
Au pis, dans la relation ambiguë de la princesse guerrière
et de sa faire-valoir Gabrielle, il émanait de Xena
un léger parfum de lesbianisme que savait savamment doser
la productrice Liz Friedmann - militante homosexuelle très
active aux States - afin que chaque type de téléspectateur
y trouve son compte, et seulement son compte. Mais depuis lors,
nos deux compères ont, semble-t-il, sensiblement modifié
leurs orientations !
Liz Friedmann a disparu
de la nouvelle équipe réunie par Starz, où
néanmoins l'on retrouve les noms de nombreux anciens des
séries Hercules/Xena comme le réalisateur
Michael Hurst (4),
la productrice Chloe Smith (5),
l'acteur Craig Parker
ou le compositeur de la B.O. Joseph Lo Duca. Cependant, visant
une toute autre plage horaire et un public adulte, Spartacus
: Blood and Sand sera... nettement plus cru.
Une fois enterrées les sagas Hercules/Xena
(2001), le réalisateur-producteur Sam Raimi et son compère
Rob Tapert reconduisirent leur association en fondant en 2002
une nouvelle maison de production, Ghost House Pictures (The
Grudge, 30 Days of Night, The Messengers and Boogeyman). Pour
Spartacus, ils seront rejoints par Joshua Donen pour former
Stars Road Entertainement, sous l'égide de Sony Pictures
(6).
Ces trois producteurs exécutifs vont développer
un scénario écrit par Steven S. DeKnight. Il est
entendu que «cela ne ressemblera pas au film de Stanley
Kubrick avec Kirk Douglas, comme l'expliquera le chef des
programmes de la chaîne Starz : nous ne voulions pas
que ce soit un péplum classique. Ce sera fun, dynamique,
bourré d'action et de personnages passionnants. Il y aura
un tout petit plus de profondeur que dans le film des '60.»
| -
Une esthétique qui lorgne vers le 300
de Zack Snyder, avec une dominante des tons ocres ou sépias
- le sable de l'arène, les corps bronzés,
les cuirs, les crépis des murs - avec pour seul contraste,
les vêtements chamarrés des possédants. |
| 
Léonidas fait-il ses adieux à
sa reine Gorgo avant de monter aux Thermopyles ?
Non, c'est Spartacus et son épouse Sura, partant
combattre les Gètes aux côtés des Romains... |
Conçue pour l'audience du câble - donc avec un classement
«R» [«The show bas been rated TV-MA for graphic
violence, strong sexual content, and majors profanity»
(Wikipedia)] - l'épopée est «réinventée»
en vue de séduire une génération de spectateurs
nourris aux super-héros des comics, aux jeux vidéo
et aux effets spéciaux de pointe. Chaque épisode
d'une heure disposa d'un budget de 2 millions de dollars, une
bagatelle... La chaîne
américaine fondée en 1994 - mais dont Spartacus
est une des premières séries originales - entendait
ne pas lésiner sur les moyens après la mise en chantier
de Crash, suite télévisuelle de Collision
(7)
(2009). Le tournage eut lieu dans un studio d'Auckland, en Nouvelle-Zélande,
avec une kyrielle d'acteurs inconnus, peut-être des stars
de demain. Le rôle de Spartacus est tenu par Andy
Whitfield, un acteur britannique depuis dix ans établi
en Australie. A ses côtés, celui de son épouse
Sura est joué par le top model Erin
Cummings (Dollhouse). Lucretia et son mari Batiatus,
le couple diabolique, sont interprétés respectivement
par Lucy Lawless (Xena)
- à la ville, épouse du producteur Rob Tapert -
et John Hannah, déjà
vu dans le personnage de Jonathan Carnahan, le frère gaffeur
de Rachel Weisz dans la trilogie La Momie. Craig
Parker (Legend of the Seeker) prête ses traits
au général Claudius Glaber; et dans le rôle
du Doctor, le chef-entraîneur de l'école des gladiateurs,
nous retrouvons l'excellent acteur noir Peter
Mensah, que dans 300
l'on avait vu disparaître dans un puits sans fond. Comme
dans 300, les personnages évoluent dans un environnement
presque entièrement virtuel et, malheureusement, cela se
voit un peu trop. Tourné exclusivement en studio devant
des écrans bleus, ce Spartacus se réclame
ouvertement du film de Zack Snyder : dans le premier épisode
- et sur l'affiche promotionnelle - le héros et ses auxiliaires
thraces en ont du reste adopté le look, s'habillant
chez le même faiseur ou, plus probablement, les ayant récupérés
dans les «Surplus lacédémoniens» d'après
les guerres médiques ! Très virtuelle, l'esthétique
générale abuse de maquettes, de nuages qui traversent
le ciel à la vitesse du TGV et, à l'inverse, de
ralentis dans les scènes de combat (8),
histoire de bien laisser le temps de voir le sang gicler. A noter
le premier épisode, qui forme un prologue à part,
combinant l'ocre avec le bleu intense du ciel de la Thrace, le
ciel du temps où Spartacus était encore un homme
libre.
Spartacus et ses camarades vivent quasi nus dans ces montagnes
enneigées de l'Hæmus. Tandis que tombent des flocons
de neige (artificielle, cela va sans dire), on se demande quel
genre de fruits virtuels pouvait bien cueillir Sura sur un arbre
aux branches dénudées. Des nèfles ?
| 
Quelle espèce d'arbre peut porter de
tels fruits dans les monts enneigés de l'Hæmus
?
Un arbre virtuel dans des neiges infographiées, bien
sûr... |
Annoncé sur Starz pour l'été
2009, Spartacus a démarré avec un léger
retard sur la chaîne câblée le 22 janvier 2010,
soirée où d'emblée le premier épisode
rencontra une audience de 553.000 téléspectateurs,
résultat plutôt encourageant quand on sait que le
précédent record d'audience de la chaîne avait
péniblement été de... 185.000 spectateur.
La Saison 1 compte treize épisodes, diffusés
sur Starz depuis le 22 janvier le dimanche soir, 22h. Sur la base
du succès rencontré par le clip promotionnel diffusé
depuis le 23 décembre 2009, Starz a déjà
commandé une seconde saison, Spartacus : Vengeance
(9).
L'intrigue de cette première saison reste confinée
dans le huis-clos de l'Ecole des gladiateurs de Capoue où
elle peut s'épancher sur le sérail de ces
hommes voués à la promiscuité et à
la violence, leur dressage, leur apprentissage, leurs rivalités
personnelles sous la coupe de maîtres sévères
etc. Crassus ne figure pas au casting de la Saison 1, mais bien
une de ses «cousines», Licinia. En revanche, dès
le 1er épisode, en Thrace, est bien présent Claudius
Glaber, qui semble ici voué à porter sur ses
épaules et tout au long de la série, le poids de
la rancune de Spartacus, de son aspiration à la vengeance.
Historiquement, nous savons que c'est celui-ci et 3.000 miliciens
qui, au cours d'une audacieuse attaque nocturne au pied du Vésuve,
seront vaincus par un Spartacus dont les forces, à ce moment-là,
ne devaient pas excéder 300 hommes.
Nous ne sachons pas que Claudius Glaber (ou, plus exactement,
C. Clodius Glaber) ait guerroyé en Thrace, laquelle avait
été soumise en 76 par le consul M. Scribonius Curio.
Avec la même logique, le scénariste de Riccardo Freda
avait bien fait de Crassus le conquérant de la Thrace (10),
lui attribuant d'avoir condamné à devenir gladiateur
le décurion romain Spartacus. Certes, dans pareille œuvre
audiovisuelle il est de bon ton de cristalliser sur une seule
personne la phobie récurrente du héros... le strict
respect de l'Histoire - qui en a vu d'autres - dut-il en souffrir
un tantinet !
|
| |
3. Sexe et violence
Le premier épisode, qui est une mise en bouche, alterne
sans désemparer scènes de combats et séquences
érotiques, avec le plus souvent des nudités frontales
intégrales. Ainsi surprend-on successivement Spartacus
et sa compagne Sura dans leur intimité; Glaber et son épouse
Ilithyia dans la leur, avec l'amusante l'idée de la fille
nue sous son manteau de fourrure; enfin, il y a l'«orgie»
chez Batiatus, avec quelques plans lesbiens.
A la question «Spartacus est une série
assez sexy. La nudité ne vous dérange pas ?»,
le top model Erin Cummings (Sura), interviewée par Muscle
& Fitness, répondra : «L'action se passant
en Rome antique, les producteurs ont décidé de repousser
les limites habituelles pour les scènes de sexe et de violence
afin de créer un environnement réaliste. Loin d'être
gratuite, la nudité renforce la crédibilité
des personnages. Andy Whitfield, dans le rôle de Spartacus
se dénude aussi régulièrement que moi, alors
je n'ai pas le sentiment de me faire exploiter» (11).
Plus âgée, Lucy Lawless, on le verra, ne partagea
pas le sentiment de la starlette : on retiendra seulement que
dans l'esprit du grand public comme dans celui des producteurs,
l'Antiquité romaine est un univers de violence (ce n'est
d'ailleurs pas faux) et de sexualité exacerbée (ce
qui resterait à débattre).
| 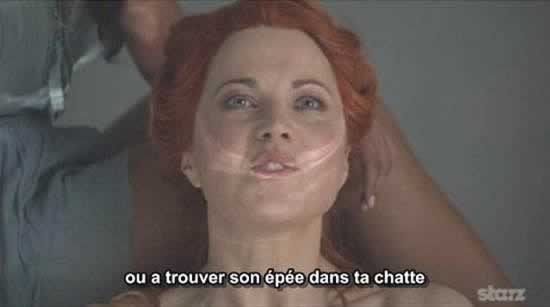
Lucretia n'y va pas par quatre
chemins avec Mira, sa camériste, et le lui dit crûment
: si elle l'envoie à Spartacus, c'est pour qu'il
lui fourre «son épée dans la chatte»,
jolie métaphore à laquelle les textes ne s'opposent
d'ailleurs pas, bien au contraire : c'est avec un vocabulaire
emprunté à la gladiature que la servante Photis
encourage son amant à pratiquer avec elle un autre
genre d'escrime (APULÉE, L'âne d'or,
II, 17) |
3.1.
Sexe
Sexe et violence caractérisent donc la série conçue
par le scénariste Steven S. DeKnight (Buffy, Angel,
Smallville et Dollhouse) lequel, peut-être jaloux
des lauriers d'HBO, semble avoir voulu marcher sur les brisées
de Rome. Et même
y surenchérir. Anecdote : il y avait dans Rome une
curieuse séquence où Atia s'ébattait avec
son amant Marc Antoine, sous l'œil vigilant de sa nourrice
Merula qui - assise à leur chevet - tenait la chandelle
et leur passait des rafraîchissements (!). Outre nous donner
à voir un peu de chair dénudée, la scène
avait sans doute été conçue dans l'idée
de montrer au téléspectateur l'indifférence
dans laquelle les Romains tenaient leurs esclaves, considérés
comme de simples objets dénués de pensée
ou de sentiments, brefs non humains. Arrive que les deux amants
se chamaillaient et qu'Antoine devient mauvais. Sans l'ombre d'une
hésitation, la nourrice sort un poignard et l'en menace.
Le général n'a plus qu'à se rhabiller et
rentrer chez lui (Saison
1, ép. 6) !
| 
Lucy Lawless (Lucretia) et
John Hannah (Batiatus) copulent en bonne compagnie, mais
surtout pour «le bon motif» : avoir un enfant...
Lucretia est «une femme aimante et dévouée,
déclare Lucy Lawless. Elle est l'ultime manipulatrice
et aime son mari plus que la vie elle-même. Elle veut
lui donner un héritier, sans succès pour le
moment. Elle en devient désespérée,
donc pour lui offrir un fils, elle s'engage dans une relation
abusive et très blessante avec un gladiateur, en
espérant tomber enceinte. Tout cela, pour le bien
de son mari. C'est une fille pleine de ressources.» |
Spartacus, en son épisode
2, va faire beaucoup plus fort. Lucretia (Lucy Lawless) et
son mari Batiatus (John Hannah) voudraient avoir un enfant, mais
n'y arrivent pas. Et voici le couple entamant une nouvelle tentative
de procréation, entouré d'une demi-douzaine d'esclaves
des deux sexes. Ils se dénudent (Batiatus) ou se font dénuder
(Lucretia). Puis une jeune esclave agenouillée devant son
maître s'applique à en réveiller la virilité
défaillante - filmé hors-champ, mais de manière
suffisamment explicite. Pendant ce temps Lucretia, qui a conservé
sa tunique de fine soie... transparente (12),
se laisse elle aussi mettre en condition. Glissant une main experte
sous le vêtement de sa maîtresse, sa suivante Nævia
en explore les parties secrètes, sans que pour autant nous
puissions décider si Lucy Lawless est vaginale ou clitoridienne
: il ne faut pas tout révéler, n'est-ce pas ? Après
quoi, dûment motivés maintenant, le dominus
peut saillir la domina - époux et épouse
copulent debout contre une colonne, toujours sous le regard indifférent
des outils-humains qui restent à portée de main.
| 
Nævia, la suivante préférée
de Lucretia, est toujours disposée à aider
sa maîtresse d'un index bienveillant... |
Il est une règle bien établie dans le showbiz
: si elle est actrice, comme c'est probable, c'est l'épouse
du producteur «qui s'y colle». Manière comme
une autre, pour son mari, de récupérer à
son profit le substantiel cachet qu'il lui a accordé. Habituée
de jouer dans des séries pour ados, Lucy Lawless débarque
comme Bécassine de sa province, dans le sulfureux univers
de Spartacus, tout de sexe et de violence. «Je
savais que c'était un nouveau genre de télévision.
Je savais parfaitement que Spartacus, avec les nouvelles
technologies et le monde que cela leur permet de créer,
[re]pousserait les frontières de la télévision.
Le plus important pour moi était le fait que je pouvais
jouer le rôle d'une femme puissante, complexe et tourmentée.
J'aime réellement ce type de rôle.» Xena,
la fighting girl, a l'habitude de rôles musclés;
mais dans Spartacus elle joue plutôt les entremetteuses,
un rôle pas très physique quoique... si - justement
! -, étant partagée entre son mari Batiatus et son
amant Crixus, elle voit de nombreuses scènes coquines s'aligner
sur son planning de tournage.
 |
La
nénette aux petits nénés à
peine voilés par une étroite bande de
gaze que nous n'oserions appeler un strophium,
va de ses lèvres habiles préalablement
remettre en condition le maître Batiatus (ci-dessous)
|
 |
|
La première de ces scènes, celle
que nous venons de décrire, est spécialement torride
- mais davantage dans la suggestion que dans les actes. La domina
Lawless se fait titiller les parties intimes par une esclave.
Sous le péplum, cela va sans dire. Tout cela reste soft,
bien sûr, on n'est pas dans un hardcore d'Antonio
Adamo après tout ! Nous connaissons la vie, n'est-ce
pas ? Point n'est pas besoin de nous faire un dessin. «John
[Batiatus] ne fait rien en gardant son sérieux,
confie en riant Lucy Lawless. Dès que la caméra
est arrêtée, il se marre. Il rit durant treize épisodes
! Néanmoins, il reste un acteur très pro. Les premières
fois où j'ai joué ces scènes, j'étais
terriblement nerveuse. Je suis rentrée à la maison
- j'ai marché directement du plateau jusqu'à la
voiture, j'ai enlevé ma perruque, [je suis] sortie
de la voiture et je suis allée directement au lit. Je n'ai
dit bonne nuit à personne, je me suis juste endormie pour
douze heures. Ceci dit, je ne pouvais pas espérer meilleur
partenaire que John pour jouer ces scènes. Par la suite,
j'étais aussi très stressée, mais nous avons
trouvé comment nous allions procéder. Il devait
y avoir un protocole, des limites pour tourner toutes ces scènes
où vous avez toutes vos marques longtemps à l'avance.
Tout est très sûr et il n'y a aucun contact entre
les acteurs. Peu importe ce que vous pensez voir : il n'y a rien
!»
Il est clair que les séquences érotiques ont plutôt
gêné Lucy. De fait, dans cette série, nombre
de jeunes femmes payent de leur personne - Sura, Ilithyia, Mira,
Licinia et mult anonymes esclaves... Mais hors l'exhibition de
ses seins, Lucy Lawless est assez avare de son académie.
Ses parties de jambes en l'air se font avec une doublure, ou plutôt
une «dédoublure» : entendez par-là que
dans les parties à trois, dame Lucretia n'est que spectatrice,
livrant les boniches à l'infatigable concupiscence de son
mari. Libérale, la Lucretia ? Il est vrai que l'esclave
n'est qu'un instrument, un instrumentum vocale («outil
qui parle»). «Je vais vous regarder, ça
m'excite», déclare-t-elle sans ambages à
son époux venu partager son bain - et qui ne se le fait
pas dire deux fois. Batiatus consomme illico la jeune camériste
résignée (ép. 6; cf. aussi ép.
9).
 |
On peut nourrir quelques doutes quant à
la vraisemblance de cette scène chez des Romains «normaux»
(mais notre laniste n'est, justement, pas un Romain normal, pourrait-on
objecter). Nous concevons que les Romain(e)s s'offraient du bon
temps à discrétion avec leurs esclaves multiusages.
Mais sachant qu'il était assez inconvenant de complètement
dénuder son épouse lors de l'acte sexuel (13),
nous aurions du mal à admettre qu'ils s'adonnaient devant
eux à leurs devoirs conjugaux comme on les voit faire ici.
Il s'agit, c'est évident, de montrer au téléspectateur
que les esclaves ne sont que des instruments, des choses, des
bibelots. A relativiser, donc. Les Romains vivaient dans un monde
très structuré, codifié, où chaque
chose était à sa place et portait une étiquette
bien précise. L'osculum est le baiser que l'on donne
aux enfants, le basium celui que l'on donne à son
épouse et le savium à la courtisane. Ce qu'un
honnête homme s'interdira avec sa citoyenne d'épouse,
est tout-à-fait licite avec un(e) esclave ou un(e) prostitué(e).
Ce n'est hélas pas le cinéma qui nous préservera
des idées reçues quant au stupre romain.
Ceci étant posé, ne perdons pas de vue que les
tenues de plage qui apparurent au lendemain de la WW II, avec
un certain relent de scandale, auraient été impensables
juste avant. De nos jours, le bikini - inventé en 1946
- est parfaitement intégré, et devient de plus en
plus étroit, quand il n'est pas carrément mono.
Idem pour les tenues masculines. Les mœurs comme les
modes évoluent. Les trois guerres civiles qui sonnèrent
le glas de la république romaine amenèrent aussi
une sensible libération des mœurs : nombre de citoyens
ne cherchaient plus à perpétuer le mos maiorum,
à se marier pour avoir de la descendance. Les proscriptions
de Marius, puis celles de Sylla avaient démontré
toute la précarité, toute la relativité de
la vie humaine. A telle enseigne qu'Auguste - qui pourtant ne
crachait pas sur les fruits verts - dut légiférer
et contraindre au mariage et à la procréation les
survivants de l'holocauste davantage préoccupés
par le carpe diem que par leurs devoirs de citoyens. Comme
descendu des Abruzzes, un vent de puritanisme se mit à
souffler sur l'Urbs, envoyant Ovide, le délicat
et licencieux poète des amours, exercer sa verve auprès
des paysans du Danube... nouvel Orphée au milieu des bêtes
féroces.
Au pied du Palatin, on a exhumé les fresques d'une villa
- dite la «villa sous la Farésine» - qui semble
avoir appartenu à Julia, la fille de l'empereur, et à
Agrippa, son gendre. Une villa très rapidement abandonnée,
car trop exposée aux crues du Tibre. Dans l'une des chambres,
deux fresques illustrent la nuit de noces des époux. La
première montre le mari nu, étendu sur la couche
et, assise sur le bord, la jeune épousée encore
revêtue de sa robe orange, la tête couverte de la
palla. Le mari semble essayer de la convaincre de s'abandonner
à ses devoirs conjugaux.
En regard, la seconde fresque montre le mari toujours dans la
même attitude, mais que son épouse, dénudée
jusqu'à la taille, embrasse fougueusement. Sur la première
fresque, un serviteur habillé se tient à côté
des époux; sur la seconde un serviteur nu est encore à
leur chevet, tenant en main un broc de vin (?). Ce dernier serviteur
se tourne vers nous qui admirons la fresque, avec l'air de dire
que si lui est à sa place, nous, nous n'y sommes pas à
la nôtre. C'est l'observateur observé, ou le voyeurisme
mis en abîme... «Inclure ces «valets de chambre»
dans des scènes de sexe était un moyen «chic»
de signaler sa richesse et son raffinement», écrit
John R. Clarke (14).
Une autre fresque trouvée dans la villa du banquier Cæcilius
Jucundus, à Pompéi (actuellement conservée
au Cabinet de Naples), propose une scène semblable, avec
une chambrière élégamment vêtue, faisant
face à l'épouse dénudée, assiste sur
le bord de sa couche, dont la main à tâtons cherche
le sexe de son mari couché près d'elle (15).
Ces représentations démontrent qu'au moins au
début du Ier s. de n.E., il n'était pas rare que
des serviteurs assistent leurs maîtres dans leurs ébats
amoureux.
| 
Fresque de la «villa
sous la Farnésine» (d'après John R.
Clarke, op. cit., p. 31). Découverte en 1879
par des ouvriers aménageant les quais du Tibre, cette
villa au pied du Palatin, en-dessous des Jardins Farnèse,
semble avoir appartenu à M. Vipsanius Agrippa, le
bras droit d'Auguste, et à son épouse Julia.
Construite aux alentours de 20 av. n.E., elle fut rapidement
victime d'un débordement du Tibre, et pour cette
raison abandonnée. On notera que si son mari est
complètement nu, cette digne épouse ne s'est
dénudée qu'à moitié (au contraire
de ce que l'on peut voir dans les lupanars de Pompéi)... |
Nous nous sommes demandé s'il fallait
voir une signification particulière dans le fait que ce
n'était pas la domina elle-même qui offrait
ce genre de caresse à son mari. Fellator est une
injure réservée aux hommes (16).
Mais de toute évidence la réprobation s'étend
aussi aux «honnêtes» épouses, bref aux
citoyennes, ce genre de gâterie ne pouvant s'obtenir que
d'esclaves ou de prostitué(e)s. Il faudra alors admettre
que cette série est bien plus subtile qu'il n'y paraît
(17).
Quel dommage que les «critiques» sur le Net se soient
laissés rebuter par la vulgarité systématique
de certains personnages, notamment Batiatus et Crixus, qui ne
peuvent aligner une phrase sans y placer deux ou trois métaphores
sexuelles du genre : «Et les Sénateurs me suceront
la bite !», «Tu es revenu me lécher le trou
?» (18)...
Savourons-en plutôt le bien-fondé : les injures sexuelles
étaient choses ordinaires au Sénat, au temps de
la république finissante.
|
| Suite… |
|
NOTES :
(1) La Guerre sociale que menèrent
les Romains contre leurs alliés italiques, auxquels ils
refusaient le «droit de cité», avait été
gagnée par l'Urbs quelques années plus
tôt. Victorieuse militairement, Rome avait néanmoins
dû s'incliner politiquement et concéder aux Alliés
les droits qu'ils revendiquaient. Mais de la Lucanie au Samnium
en passant par le Marsium, la réforme laissa pour compte
de nombreux mécontents, ruinés, aigris, avides
de revanche... - Retour texte
(2) Bien sûr, c'est surtout
le roman italien... qui va inspirer les cinéastes italiens.
Notons tout de même que le film de Vidali, tout en s'inspirant
de Giovagnoli, a récupéré chez Saurin le
personnage du gladiateur-traître Noricus.
A noter qu'il a été traduit en français
par J. Bienstock : Raphaël GIOVAGNOLI, Spartacus,
Albin Michel, s.d. (1917 ?), 2 vols.- Retour
texte
(3) Déjà en place du
temps de Mussolini, le directeur de la cinématographie
italienne Nicola De Piro estropiera le film pour le vider de
tout son contenu politique. - Retour texte
(4) Le danseur Michael Hurst avait
débuté dans la saga comme acteur, dans le rôle
d'Iolas, l'inséparable compagnon d'Hercule, avant de
passer à la mise en scène de nombreux épisodes.
Dans Spartacus, on lui doit les épisodes 5 «Shadow
Games», 9 «Whore» et 12 «Revelations».
- Retour texte
(5) Pour Spartacus : Blood and
Sand, Chloe Smith est la productrice du second épisode,
«The Red Serpent».
Mais dans l'équipe de Raimi/Tapert, elle a été
la productrice néo-zélandaise d'un épisode
de Cleopatra 2525, productrice en Nouvelle-Zélande
et Unit production manager de vingt épisodes de Xena
: Warrior Princess et line producer de treize d'entre eux.
Toujours comme productrice néo-zélandaise, elle
a encore à son actif un épisode de Hercules
: The Legendary Journeys et, pour la même série
TV, a été Production manager de plusieurs autres
épisodes. - Retour texte
(6) Quoique... Sam Raimi s'étant
fait virer de chez Sony début de cette année n'augure
rien de bon pour la continuation de Spartacus. Mais nul
n'est indispensable, n'est-ce pas ? Enfin bon. On verra... -
Retour texte
(7) Série créée
par Anthony Horowitz. - Retour texte
(8) Quasi essentiellement dans le
premier épisode. - Retour texte
(9) En fait, l'annonce de la décision
de commander une Saison 2 a précédé la
diffusion du clip (23 décembre), puisque sur le Net,
Première en faisait déjà état
la veille (22 décembre). - Retour
texte
(10) Idée reprise également
dans le ballet d'Aram Khatchaturian (créé à
Léningrad en 1956). En dehors du fait qu'à la
mort de Cinna, ayant levé 2.500 clients espagnols avec
lesquels il rallia les rangs de Sylla revenu en Italie (83-82),
il faut rappeler qu'outre la répression de la révolte
servile (72-71), M. Licinius Crassus n'exerça jamais
d'autre commandement militaire qu'en Syrie où d'ailleurs
il trouva la mort entre les mains des Parthes (53). - Retour
texte
(11) M&F (photos: Brie CHILDERS),
«La reine des gladiateurs : Erin Cummings», Muscle
& Fitness (éd. fr.), nÁ 271, mai 2010, p. 160.
- Retour texte
(12) Elle l'aura perdue au plan suivant,
on ne sait trop comment d'ailleurs. - Retour
texte
(13) Ne nous fions pas aux fresques
décorant les lupanars de Pompéi, qui nous montrent
descouples entièrement nus : il s'agit ici de prostituées
officiant dans un lieu de débauche. Nuance. - Retour
texte
(14) John R. CLARKE, Le sexe à
Rome (100 av. J.-C.-250 apr. J.-C.) (2003), Ed. de la Martinière,
2004, p. 32. Les fresques : pp. 30-31, phot. 10 et 11. - Retour
texte
(15) John R. CLARKE, Le sexe
à Rome, op. cit., pp. 33-35, phot. 12. - Retour
texte
(16) Les Romains distinguaient deux
sortes de fellation : passive (fellatio) ou active (irrumatio).
- Retour texte
(17) Même si, de toute évidence,
le peu d'enthousiasme de Lucy Lawless pour les scènes
hot suffirait à expliquer le pourquoi et le comment
de la séquence. - Retour texte
(18) Le regretté Michel Dubuisson,
dans son petit opus consacré au vocabulaire coquin
nous a convaincu de la verdeur du latin de rue (M. DUBUISSON,
Lasciva Venus. Petit guide de l'amour latin, Mons, Talus
d'approche éd., coll. «Libre Choix», nç 10,
2000). - Retour texte
|
| |
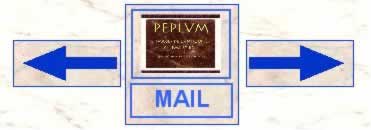 |
|