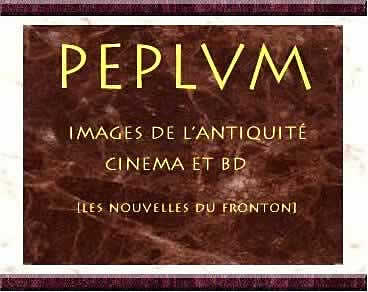 |
| |
| |
Tarek & Vincent Pompetti
La Guerre des Gaules
(Tartamudo éd., février 2012)
[Page 1/2]
CONCOURS - 10 albums à gagner
| date de clôture
du concours : 5 septembre 2012 |
|
|
| |
|
| |
|
| |
Le 28 mars 58,
le proconsul nouvellement promu des Gaules Transalpine (la «Provincia»)
et Cisalpine, C. Julius Cæsar s'oppose au passage en territoire
romain des Helvètes migrant vers les bords de l'Océan.
Sans doute ne se souvient-il que trop bien du «passage»
des Cimbres et des Teutons, que son oncle Marius écrasa
successivement en 102 et 101, après huit années
de déprédations et le massacre de plusieurs armées
consulaires. Après avoir défait les Helvètes,
il règle leur compte aux Suèves d'Arioviste qui
se pressaient juste derrière eux. Arioviste, «allié
et ami du Peuple romain» occupait une partie des territoires
des Séquanes et des Éduens (ces derniers eux aussi
«alliés et amis du Peuple romain»; mais ce
qu'il y a de merveilleux dans la vie c'est que ses «amis»,
on peut les choisir. Enfin, théoriquement !). Jusqu'alors,
les Éduens avaient - 17 ans durant - vainement supplié
le Sénat de Rome de les aider contre les Germains. César
saisit l'opportunité. On songe à la Guerre du Viêt-nam.
Qui étaient les «gentils» ? Qui étaient
les «méchants» ? A chacun sa vérité.
Ensuite donc, César enchaîne avec une campagne contre
les Belges, puis les Armoricains (Vénètes). C'était
en 57.
L'album s'achève sur l'expédition contre les
Morins, fin de l'été 56. Soit les trois premiers
livres de La Guerre des Gaules. Telle est la matière
du premier tome du diptyque de Tarek et Pompetti : Caius Julius
Cæsar. On attend avec intérêt le tome 2
: Vercingétorix.
Cette nouvelle Guerre des Gaules s'insère dans
un courant «documentaliste» du péplum, en l'occurrence
le péplum-BD (1)
(voyez à la TV le nombre incroyable de docu-fictions
depuis la sortie de Gladiator, il y a onze ans). Avec son
dossier pédagogique en conclusion, dont une chronologie
détaillée de la conquête romaine de 59 à
51, l'album de Tarek
et Vincent
Pompetti s'inscrit dans une mouvance dont Le casque d'Agris
(Assor BD éd.) serait la figure de proue.
Après avoir longuement surfé sur
le thème des «contes bleus détournés»,
publiés dans les collections pour la jeunesse d'Emmanuel
Proust éd. (Les 3 petits cochons, Les sept nains et
demi, Rufus le Loup et le Chaperon Rouge, etc.), le scénariste
Tarek - historien de formation, mais aussi chantre du street
art - s'est imposé dans le domaine de la BD historique
avec Raspoutine, dessiné par Vincent Pompetti (3
albums, 2006-2008), Lawrence d'Arabie, dessiné par
Alexis Horellou (2 albums, 2007-2009) ou, à propos des
troupes coloniales dans les conflits des XIXe-XXe s., Turcos,
chez Tartamudo, avec Batist Payen au dessin (2)
(2011) ! Mais le grand titre de gloire de Tarek reste sans doute
son Sir Arthur Benton (6 albums, 2005-2010), honoré
par une exposition au Mémorial de Caen (2008). Dessiné
par Stéphane Perger, un premier cycle concernait la Seconde
Guerre mondiale (1930-1945); un second cycle par Vincent Pompetti,
s'intéressait à la Guerre Froide. Un agent secret
britannique, le colonel Kensington, alias Sir Arthur Benton s'abouchait
avec les nazis pour contrer l'Union soviétique. L'agent
double devra rendre des comptes...
Après avoir déjà réalisé
ensemble plusieurs albums, Tarek et Pompetti s'associent donc
une nouvelle fois pour cette Guerre des Gaules. On aurait
pu s'attendre à une condamnation plus ou moins feutrée,
ou violente, de l'action de César et de la conquête
impérialiste (comme Væ Victis de Rocca et
Mitton ou Vercingétorix
de J. Dorfmann), à moins que ce ne soit son apologie (Les
Maîtres de Rome : La conquête gauloise de Colleen
McCullough), sinon son approbation implicite (J. Martin, «Alix»).
Entre le génocide de la civilisation celtique ou l'apport
civilisateur des Latins, les auteurs ne semblent pas trancher.
Il est vrai que le scénariste Tarek se sent intellectuellement
plutôt proche des Romains, tandis que le dessinateur Vincent
Pompetti a l'âme celte...
L'adaptation
L'écriture d'une BD, et spécialement une BD historique,
relève d'une prodigieuse alchimie où s'entrechoquent
la sensibilité du scénariste et celle du dessinateur.
Mais aussi, ne l'oublions pas - ne l'oublions jamais -, celle
du lecteur. Et il y a toutes sortes de lecteurs ! Plus ou moins
profanes, ou plus ou moins initiés, avec toutes sortes
de nuances intermédiaires. Ceux qui ne recherchent qu'un
moment d'évasion bédéique et ne désirent
que se faire conter une belle histoire, avec une ambiance etc.
Et les autres qui, connaissant un peu le sujet, se demandent comment
il sera traité...
Comme pour Le Casque d'Agris et les autres albums d'Assor
BD - petit éditeur-archéologue spécialisé
dans le Moyen Age normand -, cette Guerre des Gaules, annoncée
en deux tomes, comporte un dossier pédagogique (3).
Cet épisode fondateur de l'Histoire de France (mais seulement
depuis la Guerre franco-prussienne !) qu'est l'épopée
de Vercingétorix est souvent rapporté dans les collections
didactiques du genre «Histoire de France en BD» assorti,
mais pas toujours, d'un petit dossier. Ce fut, par exemple, le
cas pour l'album tiré du film de Jacques Dorfmann (4)
ou, encore récemment, dans L'Histoire de France pour
les Nuls (5). Des albums
en définitive décevants car, en dépit des
prétentions éducatives que suggère la présence
dudit «dossier», ils continuent de véhiculer
les clichés du Second Empire relayés par Astérix.
Habitant de pauvres huttes, des Gaulois chevelus et moustachus,
coiffés de casques cornus ou ailés, brandissent
des armes protohistoriques en bronze - alors que nous sommes à
la fin de La Tène -, sont affublés de pantalons
serrés par des lanières et se font hisser sur un
pavois mérovingien, comme le pauvre Abraracourcix ! Au
mieux, mais pas toujours non plus, les Romains bénéficieront
des récents éclairages de l'archéologie et
troqueront leurs célèbres cuirasses segmentées
contre la cotte de mailles et des casques d'époque césarienne.
Chance dont les Gaulois bénéficient rarement, tant
les clichés romantiques ont la vie dure...
|
De gauche à droite
: 1) la statue de Vercingétorix (click)
sur le mont Auxois, par André Millet (1865) qui lui
prête les traits de Napoléon III; 2) avec ses
cheveux longs et ses belles bacchantes, son nœud suève
(chignon), ses pantalons lacés et son pavois, Christophe
Lambert cultive un look davantage mérovingien
que celtique (Vercingétorix, J. Dorfmann,
2001); 3) le même, vu par J.-M. Michaux dans la BD
tirée du film; 4) ci-dessous : Vercingétorix
vu par Gabriele Parma dans L'Histoire de France pour
les Nuls, 2011.

Toute cette imagerie de la
IIIe République est renforcée par le fait
que les films lives d'Astérix ont en commun
avec le Vercingétorix de Dorfmann de s'habiller
chez le même costumier, Christophe Maratier - une
autorité en la matière, et de renommée
internationale puisque même des productions américaines
viennent s'équiper chez lui - reste que ce qui convient
au caricatural Astérix n'est pas forcément
utile pour une production historique qui se veut sérieuse
! |
Ne nous leurrons pas, les auteurs de romans-BD-films «historiques»
ont une responsabilité lorsqu'ils continuent de véhiculer
des stéréotypes éculés. Une lourde
responsabilité dirions-nous même car, pour une poignée
de lecteurs curieux qui chercheront à se documenter plus
loin, la large majorité se contentera de digérer
ce qu'elle a lu dans l'album et - entre la poire et le fromage
- pérorera : «Dans l'Antiquité, c'était
comme çà !»
Astérix a largement contribué à prolonger
les clichés du XIXe s. Et aussi les premiers «Alix»
qui, dans les années '50-'60, perpétuaient une imagerie
approximative tirée du Hottenroth (1883) et du Racinet
(1876-1888). La gageure tenue par Tarek et Vincent Pompetti est
d'autant plus méritoire !
| 
Des casques gaulois confirmés par l'archéologie
(6),
mais bien loin des stéréotypes de l'imagerie
populaire (V. POMPETTI, La Guerre des Gaules) |
|
| |
La
documentation archéologique
A la lueur des considérations qui précèdent,
on appréciera le souci de précision historique du
scénariste comme le soin apporté par le dessinateur
à la restitution archéologique tant des Gaulois
que des Romains, les casques «Coolus» et «Montefortino»
et les cottes de mailles portées par les légionnaires,
leurs boucliers ovales et convexe, les panoplies celtiques - Romains
et Gaulois se copiaient mutuellement -, la restitution des habitats
et oppida gaulois, le «nœud suève»
coiffant les Germains... tout est finement observé et remet
les pendules à l'heure, même si ici ou là
le connaisseur peut toujours trouver à mégoter sur
la lame d'un glaive ou un plumet de casque... (comme le dessinateur
s'en expliquera dans l'Interview ci-dessous).
Le scénario de Tarek suit très fidèlement
le texte de César, avec des aménagements bien sûr.
Soit pour insérer les personnages de fiction qui sont comme
les coryphées se tournant vers le lecteur, soit parce qu'il
faut bien raccourcir l'interminable litanie des batailles, l'énumération
des peuples soumis par César («des listes de peuplades
qui freinent la lecture. (...) lecture un peu difficile par moments»
[Spooky]).
On se souvient de la chanson d'Henri Salvador, Faut rigoler,
où le crooner d'origine guyanaise rappelait l'Ecole
publique de son enfance où on lui enseignait «Nos
ancêtres les Gaulois», «... Cheveux blonds
et têtes de bois...» etc. Le débat sur
la manière d'enseigner l'Histoire dans une France devenue
multiculturelle et, surtout, multiraciale (7),
doit-il obérer le discours traditionnel ? Le discours lénifiant
d'un Chirac parlant d'une Europe «dont les racines sont
autant musulmanes que chrétiennes», peut bien
effrontément nier la réflexion de de Gaulle sur
la France, «peuple européen de race blanche, de
culture grecque et latine et de religion chrétienne»
(8).
Vision peut-être surannée, qui faisait ironiser le
caporal commandant un peloton de supplétifs annamites :
«J'emmène mes Gaulois...» (dans Diên
Biên Phú, de P. Schoendoerffer). La démarche
de Tarek n'en est que plus estimable; il est vrai que la Guerre
des Gaules était un sujet que le scénariste portait
en lui depuis de longues années. Quant à Vincent
Pompetti - Liégeois établi en Bretagne - il est
fan absolu du monde celtique, et de longue date suit le petit
monde très particulier de la «reconstitution».
Restait à savoir comment, quand l'artiste prend la place
de l'historien, il en développera les événements
sur la feuille blanche. On ne le dira jamais assez : une BD, pas
plus qu'un film, n'est l'«Histoire». Mais bien souvent,
elle donne envie d'en savoir plus, fait éclore des vocations.
Tarek, qui a souvent œuvré dans
des ateliers pour enfants, et son complice V. Pompetti, tentent
de restituer leur vrai visage aux protagonistes guerriers de l'époque,
qu'il s'agisse des Gaulois ou des Romains. Loin des clichés
romantiques hérités du XIXe s. et du Second Empire
- qui firent les délices non seulement d'Astérix,
mais également des premiers Alix - les auteurs se sont
scrupuleusement documentés dans les travaux d'H. Robinson
Russell et ses continuateurs, en particulier les groupes de reconstitution
celtiques ou romains d'archéologie expérimentale,
qui aujourd'hui foisonnent (10).
Dans La vie d'un guerrier gaulois de Ludovic Moignet
(11)
et Yann Kervan, nous retrouverons des détails mis en valeur
par Vincent Pompetti. Même si le Vercingétorix
de Jacques Dorfmann fut un ratage complet, tant du point de vue
cinématographique qu'historique, il faut bien admettre
qu'il fut le premier à montrer les Gaulois habitant autre
chose que des huttes misérables (click),
aspect que, depuis, développent les auteurs de la «BD
archéologique» (click).
Il en va de même pour les Romains. Les légionnaires
de Jules César portent l'équipement tardo-républicain
tel que décrit par les reliefs de l'Autel d'Ahenobarbus
ou de l'Arc de triomphe d'Orange : les cottes de mailles, les
casques «Montefortino» et «Coolus» etc.
|
Il n'existait pas, à
proprement parler, d'«uniforme» romain. Chaque
légionnaire s'équipait en fonction des disponibilités.
Voici, parmi d'autres, le fameux «Coolus-Mannheim»,
un casque bon marché produit en masse, simple bol
de bronze sans porte-cimier et à couvre-nuque réduit.
Le plus souvent sans paragnathides (couvre-joues), celles-ci
étant remplacées par trois anneaux de diamètres
décroissants. Dans les planches de l'album, on va
à maintes reprises les retrouver, dont le modèle
sans couvre-joues |
Toutefois, à côté de ce second modèle
peu spectaculaire, le dessinateur privilégie le «Montefortino»
voire le «Coolus-Buggenum», même époque
mais plus luxueux, plus «romains» - bref, correspondant
davantage à l'attente du lecteur. Mieux, lorsqu'il met
en scène la Xe légion, le dessinateur s'offre la
coquetterie de marquer ses boucliers d'un sanglier qui, effectivement,
était l'un de ses emblèmes.
| 
Les boucliers de la Xe légion,
à l'emblème du sanglier. La Leg. X «dont
César fit sa cohorte prétorienne» fut
celle avec laquelle le proconsul engagea la guerre contre
les Helvètes, puis les Suèves. Parmi ses emblèmes
on remarquera le Taureau, le Sanglier, et plus tard la Galère.
Toutefois, on compte au moins deux légions portant
le matricule X : la X Fretensis (Taureau, Sanglier,
Galère) et la X Gemina (Taureau), probablement
l'une et l'autre issues de la Xe de César. Lépide
puis Marc Antoine compteront successivement la X Gemina
dans leur armée. (Cf. R. CAGNAT, s.v.
«Legio» in DAREMBERG & SAGLIO - Click) |
|
Se souvenant sans doute que
le mot proconsul n'existe pas en latin, mais bien
pro consule (12),
les récitatifs désignent César comme
«proconsul», mais «consul» dans
les phylactères ! Bien observé |
|
Le Vercingétorix
de Dorfmann, s'il véhiculait largement les poncifs
sur les Gaulois, n'était cependant pas sans mérites
au niveau de l'architecture et des habitations. Ci-dessus
- Haut : les portes d'Avaricum, J.-M. MICHAUX, Vercingétorix.
La BD du film. Bas : les portes de Gergovie, V. POMPETTI,
Guerre des Gaules |
|
De confortables maisons à
toit de chaume (J.-M. MICHAUX, Vercingétorix,
Casterman), ou des maisons à colombages (L. LIBESSART,
Casque d'Agris, t. 1, Assor BD, et V. POMPETTI, Guerre
des Gaules, Tartamudo) |
Quelques cases constituent les moments de bravoure de cet album
: scènes de mêlée, bien entendu (p.
15 v. 3 e.a.), mais aussi superbes paysages - les sommets
helvètes (p. 6), la vallée du
Rhin (p. 14), la vallée d'Alsace où
se livre la bataille d'Arioviste (pp. 16 v. 2 &
17 v. 4). D'autres sont plus archéologiques : Noviodunum
l'oppidum suession (p. 44 v. 5), le site de
Gergovie (p. 46), le camp romain (p.
52 v. 6) et l'oppidum des Arvernes (p. 55
v. 1)... tout ceci, cependant, n'exclut pas certains clichés
: le Forum romain doit beaucoup à celui du IVe s. popularisé
par le cinéma d'après les célèbres
et incontournables maquettes de Bigot (1911) ou de Gismondi (1937)
(p. 27) et l'intérieur du Sénat
est circulaire comme sur les toiles de Gérôme ou
de Cesare Maccari (au lieu de rectangulaire).
|
| |
Le
scénario historique
Au niveau du scénario, l'album est principalement fondé
sur la relation de César, Commentaires sur la Guerre
des Gaules, et en suit scrupuleusement le déroulement
tout en insérant ses personnages de fiction comme l'«espionne»
Éponine ou le «général républicain»
Petrus Volusenus (13).
Quelques personnages
En son temps déjà, Jacques Martin répugnait
à mettre en scène dans «Alix» des personnages
historiques : César, Pompée, Vercingétorix,
Cléopâtre apparaissent fugacement dans les aventureuses
péripéties de ses héros de papier. Sa démarche
était, en somme, identique à celle de Vittorio Cottafavi
qui, dans ses péplums romains se distanciait ici de Messaline,
là d'Antoine et Cléopâtre pour suivre le centurion
de service, spectateur impuissant des faits et gestes des grands
de ce monde. On a pu parler à l'endroit de ce réalisateur
célèbre pour ses adaptations théâtrales
pour la R.A.I. de «distanciation brechtiennne». Il
existe certes de nombreuses BD racontant la vie de personnages
historiques, mais y intégrer de la fiction reste et restera
un exercice extrêmement périlleux.
Vercingétorix
César n'est pas très explicite sur la manière
dont le vaincu comparut devant lui : «Le lendemain, Vercingétorix
convoque l'assemblée il déclare que cette guerre
n'a pas été entreprise par lui à des fins
personnelles, mais pour conquérir la liberté de
tous; puisqu'il faut céder à la fortune, il s'offre
à eux, ils peuvent, à leur choix, apaiser les Romains
par sa mort ou le livrer vivant. On envoie à ce sujet une
députation à César. Il ordonne qu'on lui
remette les armes, qu'on lui amène les chefs des cités.
Il installa son siège au retranchement, devant son camp
c'est là qu'on lui amène les chefs; on lui livre
Vercingétorix, on jette les armes à ses pieds. Il
met à part les prisonniers héduens et arvernes (...)»
(G.G., VIII, 89). On imagine sans mal les Gaulois balançant
leurs armes du haut de leurs murailles, puis les légionnaires
pénétrant dans la ville désarmée,
où les attendent Vercingétorix et ses lieutenants.
Les légionnaires les chargent de chaînes et les amènent
au proconsul romain qui les attend dehors, sans doute devant la
porte prétorienne. C'est la version la plus plausible,
que d'ailleurs choisiront d'illustrer Luccisano et Libessart dans
leur Alésia (14)
. Avec le tome 2, l'avenir nous apprendra comment Tarek et Pompetti
auront choisi de traiter l'épisode.
|
Les seuls «portraits» connus de
Vercingétorix sont frappés sur les monnaies
arvernes, tel ce statère d'or - ph. Télérama,
HS octobre 2011, p. 21)... et son interprétation
par Vincent Pompetti : ça nous change des Mérovingiens
chevelus... |
En effet, écrivant un siècle et
demi après les faits, Florus et Plutarque en ont donné
des versions plus spectaculaires, mais qui se contredisent. Pour
Florus, Vercingétorix arriva à pied et décocha
un bref compliment au vainqueur (FLORUS, Hist. rom.). Selon
Plutarque, Vercingétorix arriva à cheval, jeta ses
armes et se mit à genoux en silence, joignant les mains
comme un suppliant (PLUT., Vie de César, XXXV).
Plus tardif encore un quatrième récit nous est donné
par Dion Cassius, trois siècles après les faits.
C'est à ce dernier que nous sommes redevables de la célèbre
et pathétique reddition du généralissime
arverne, qui va inspirer les peintres du Second Empire. Dans son
Histoire romaine, Dion Cassius montre Vercingétorix
arrivant monté sur son plus beau cheval et paré
de ses plus belles armes. Ayant fait deux fois le tour du tribunal
de César, il jette ses armes aux pieds de César,
saute à terre, s'humilie devant le vainqueur mais lui expose
que, confiant en leur ancienne amitié, il espère
la clémence du proconsul. Mal lui en prend : c'est justement
au nom de cette amitié qu'il a trahie, que César
le fait enchaîner et, plus tard, exécuter (DION,
H.R., XL, 41).
| 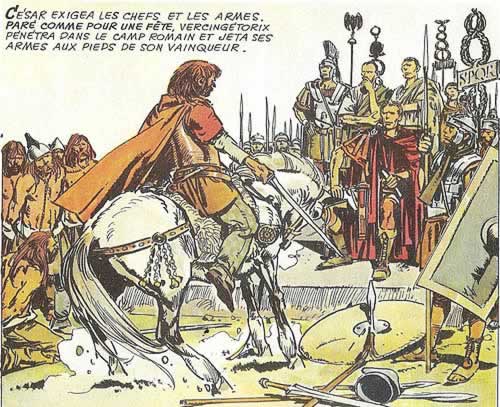
«Relire une trentaine
d'années après sa première édition,
L'Histoire de France en bandes dessinées, parue
chez Larousse en 1980, c'est renouer avec une conception
romantique, et donc un peu obsolète, du passé»,
note en préface Christian Amalvi (univ. Paul-Valéry,
Montpellier III). Le dessinateur espagnol Victor de La Fuente
s'inspire ici de la célèbre toile de Lionel
Noël Royer (1899) (V. de La Fuente, Histoire de
France en bande dessinée, Larousse, 1979 - rééd.
Larousse-Le Monde, mai 2008) |
Cette poignante description n'est probablement
pas fiable, mais on en a retenu l'allusion à l'amitié
passée de Vercingétorix et de César. C'est
sur cette base que l'on conçoit que le prince arverne aurait,
à la tête de quelque troupe auxiliaire, été
l'allié militaire de César dès les premiers
mois de la guerre - chose cohérente, en considération
de l'amitié des Arvernes avec leurs puissants voisins romains
de la Narbonnaise (15).
Relayée par les historiens modernes, elle éclaire
et nuance la «légende urbaine» du pur résistant.
Anne de Leseleuc (scénariste du film)
comme Simon Rocca (Væ Victis), et bien sûr
la présente Guerre des Gaules en ont fait leur bonheur,
et c'est logique. Autrement Vercingétorix n'aurait été
qu'un OVNI confiné au seul livre VII.
(Sur Vercingétorix : (click))
Le «beau Tony»
Moins évidente nous paraît, en revanche, la présence
de Marc Antoine aux côtés de Labienus, juste après
la bataille contre Arioviste (août-septembre 58). En effet,
à ce moment-là Marc Antoine s'apprête à
effectuer un voyage d'étude en Grèce, d'où
il rejoindra le proconsul de Syrie A. Gabinius, sous les aigles
duquel il servira jusque fin 55 (voir Appendice
: A propos de Marc Antoine).
Rapport à l'iconographie du personnage, le lecteur un
peu averti s'étonnera de ce que Vincent Pompetti lui ait
dessiné moustaches et courte barbe. Mais Plutarque accourt
à la rescousse du dessinateur en nous rapportant que, lorsqu'il
était jeune, Marc Antoine - qui, comme tout bon Antonii
se prévalait de descendre d'Hercule - aimait à en
cultiver le look : tunique très courte, mettant
en valeur ses membres musclés, et bien sûr la barbe.
| 
La Guerre des Gaules : Marc Antoine,
moustachu et barbu, et Éponine |
La fille Thénardier : Éponine
En ce qui concerne Éponine, elle aurait tout aussi bien
pu obéir à Labienus, homme habile et énergique
- plutôt qu'à Antoine -, sans que cela change grand-chose
au scénario. Mais peut-être était-ce là
l'occasion d'adresser un clin d'œil à la série
TV Rome, lorsqu'elle décoche à Antoine concupiscent
: «Ah ! Ah ! Ah !... Je ne suis pas une catin que l'on
monte entre deux arbres, tout général que tu es»
(cf. Rome (HBO), Saison
1, ép. 2).
Personnage fictif, Éponine est (nous citons la documentation
de presse) : une «espionne éduenne (...) fille
d'un chef éduen assassiné par un mercenaire séquane,
ennemi de Rome, au service d'Orgétorix. Elle a été
engagée par Antoine pour mener des opérations de
renseignement auprès des tribus récalcitrantes.
Elle travaille avec deux hommes qui lui obéissent et n'hésitent
pas à prendre des risques pour l'aider. Ce sont des guerriers
accomplis. Elle est fascinée par Rome, mais aime un chef
gaulois qu'elle est censée séduire. Avant de mourir,
elle se réconciliera avec sa famille traditionnelle lors
des funérailles de son frère, mort dans le contingent
des alliés romains».
Là nous empiétons nettement sur le tome 2. Ainsi
donc, Éponine mourra au cours du récit ? Et qui
est ce chef qu'elle aime mais doit trahir ?
Onomastiquement, Éponine fait songer à Épona,
l'amante de Vercingétorix dans le film de Dorfmann. Eh
bien oui, toutes les Gauloises ne s'appellent pas nécessairement
Falbala, Sécotine ou Yellowsubmarine ! Épona est
la déesse gauloise des chevaux, qualité qui se prête
à transmettre son nom à une héroïne
celte. Est-ce Vercingétorix qu'elle devra séduire...
peut-être pour le trahir ? L'avenir nous le dira.
Petite précision, que l'on trouve dans la lecture du
tome 1 : on apprend que son père était un Éduen
(16)
qui a été assassiné par le Séquane
Adra, sur l'ordre d'Orgétorix (le roi helvète qui
voulait «traverser» la Gaule...). Qui est cet Adra
? César ne le cite pas dans ses Commentaires, mais
Dion Cassius le mentionne une seule fois : il s'agit du chef de
la coalition belge de 57 (DION CASSIUS, Hist. rom., XXXIX,
4). Le même semble-t-il que celui que César nomme
Galba, roi des Suessions (capitale Noviodunum, dans le Soissonnais)
(G.G., II, 4, 13).
Qui fait quoi ?
Sans doute le tome 1 se contente-t-il de planter le décor;
nous laissant échafauder des hypothèses que le tome
2 démentira peut-être. Ennuyeux, quand il faudra
probablement attendre encore un an pour enchaîner le récit...
Mais pour ce que nous en avons lu, Tarek suit scrupuleusement
les Commentaires (en triant quand même un peu, faute
de place). Cependant, au long des 54 planches qu'il nous a été
donné de lire, ses personnages de fiction ne se
sont guère agités. Pis, certaines interventions/apparitions
sont obscures comme cette femme et son enfant (neveu de César,
semble-t-il) qui reçoivent la visite d'un messager. Ils
ne sont pas nommés.
Il ne peut s'agir de Calpurnia, épouse de César
depuis 59 (mais union stérile), puisque l'enfant demande
des nouvelles de... son oncle.
Peut-être s'agit-il de sa maîtresse Servilia et du
jeune Brutus, l'improbable fils naturel de César ? Mais,
né quelque part entre 85 et 78, Brutus devait - à
l'époque - comptabiliser la trentaine bien sonnée.
Du reste, l'allusion à la malignité de Caton, le
demi-frère de Servilia, nous a sans doute égaré
!
Voyons plutôt les choses sainement : le neveu de César
ne peut-être, évidemment, que le jeune C. Octavius
Thurinus, et sa mère la digne Atia Balba Cæsonia
!
Mais voici une déduction qui n'est pas à la portée
du lecteur moyen, lequel déjà se perd dans les interminables
énumérations de peuples barbares (cf. critique
de Spooky sur BDthèque)
! Le style anglo-saxon de Tarek ! C'est vrai
que par moment on croirait lire un roman croisé entre Len
Deighton (17)
et John le Carré (18).

|
| -----oOo----- |
|
NOTES :
(1) Précédemment, dans
le milieu des années '80, Dargaud s'y était essayé
avec Hérode le Grand, Massada etc. (Jean-Marie
Ruffieux & Claude Moliterni). - Retour
texte
(2) Turcos. Le jasmin et la boue,
d'après une idée de Kamel Mouellef, préface
de Yasmina Khabra. - Retour texte
(3) La Guerre des Gaules, t.
1 : 54 pl. et dossier 14 p. - Retour texte
(4) Claude CARRÉ
(sc.) (d'après le scénario d'Anne de LESELEUC)
& Jean-Marie MICHAUD (d.), Vercingétorix - la
BD, Casterman, 2001 (27 pl. & dossier de 17 p. signé
par A. de Leseleuc). A noter que le dessinateur J.-M. Michaud
plus tard aidera Laurent Libessart et Ludovic Gobbo à
finaliser dans l'urgence Alésia, après
le désistement de Christophe Ansar auteur des 51 premières
planches. - Retour texte
(5) Laurent QUEYSSI (sc.) & Gabriele
PARMA (d.), L'Histoire de France pour les Nuls - 1. Les Gaulois,
Paris, First Editions-Gründ, octobre 2011 (46 pl. &
dossier de 9 p.). - Retour texte
(6) On se reportera, par exemple,
à Franck MATHIEU, Le guerrier gaulois, du Hallstatt
à la conquête romaine, Errance, 2007. - Retour
texte
(7) Cf. Marc FERRO, Comment
on enseigne l'Histoire aux enfants à travers le monde
entier, Payot, 1981. - Retour texte
(8) Cité par Alain PEYREFITTE,
C'était de Gaulle, de Fallois éd., 1994.
- Retour texte
(9) L. MOIGNET et Y. KERVAN, La
vie d'un guerrier gaulois, Calleva, 2011. - Retour
texte
(10) Référencés
dans le dossier, en fin d'album. - Retour
texte
(11) Président de la société
de reconstitution celtique Les Ambiani. - Retour
texte
(12) Le pro consule, qui est
un ancien consul (Jules César, consul en 59, est pro
consule de 58 à 54, puis de 53 à 49 inclus),
agit dans une province donnée à la place des deux
consuls en charge. De même qu'un «sous-lieutenant»
est interpellé comme «lieutenant», celui
qui agit comme substitut du consul sera apostrophé :
«consul» (merci à Fal pour ses bons avis).
- Retour texte
(13) Dans La Guerre des Gaules,
il est question d'un tribun de César nommé C.
Volusenus Quadratus, qui en 56 va reconnaître les côtes
de Bretagne en éclaireur de la flotte de César;
préfet de cavalerie d'Antoine il est, en 53, grièvement
blessé de la main de Commios l'Atrébate. En 43
il sera tribun du peuple et chaud partisan d'Antoine.
A charge du scénariste - qui en a repris le gentilice
pour nommer son «général» de fiction
P. Volusenus - observons que le prénom «Petrus»
est inconnu en latin classique, celui de l'époque de
César. Il n'apparaîtra que beaucoup plus tard,
sans doute sous l'influence du christianisme. - Retour
texte
(14) Dans son Alésia,
dessiné par Christophe Ansar, L. Libessart & alii,
Silvio Luccisano rejette la mélodramatique reddition
de Vercingétorix «selon Dion Cassius». -
Retour texte
(15) De fait, les Arvernes comme
les Éduens étaient amis des Romains. Ce qui, après
Alésia, dans un geste d'appaisement vis-à-vis
de ses anciens alliés autorisa César à
libérer ses prisonniers arvernes et éduens - livrant
à l'esclavage tous les autres captifs. - Retour
texte
(16) La BD n'en dit pas plus, mais
ce pourrait être - pourquoi pas ? - le druide Diviciacos,
chef du parti éduen pro-romain, opposé à
son frère Dumnorix, gendre d'Orgetorix, chef du parti
éduen anti-romain. C'est lui qui a convaincu César
d'intervenir en Gaule. Après l'exécution de Dumnorix
(automne 55), César ne parle plus de lui. - Retour
texte
(17) Auteur de romans d'espionnage
réputé pour céler à ses lecteurs
certaines informations. - Retour texte
(18) Autre auteur britannique d'espionnage,
chez qui - au contraire du précédent - l'action
est statique. - Retour texte
|
| |
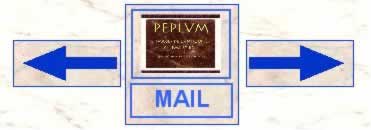 |
|