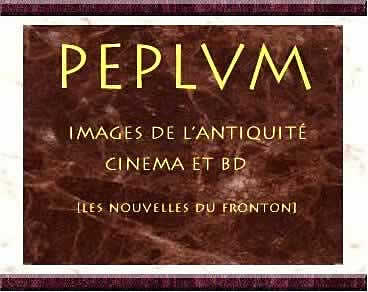 |
| |
| |
22 septembre 2011
Alésia
Silvio Luccisano & Christophe Ansar
(BD Assor-Hist éd., 2012)
|
|
| |
|
| |
An 702 A.U.C.
(Ab Urbe Condita - «depuis la fondation de Rome»),
le 2e jour après les Calendes de Quintilis, c'est-à-dire
le 30 juin 52 av. n.E. Quinze jours auparavant, César et
ses légions ont essuyé un cuisant échec devant
Gergovie, capitale des Arvernes. Ses alliés éduens
lui ayant fait défection, le proconsul - retranché
au sud du territoire de ses alliés lingons (le plateau
de Langres) - cherche à gagner la Provincia romaine
pour se réorganiser après avoir fait jonction avec
son lieutenant Titus Labienus, accouru du nord où il a
défait les Parisii. Par la vallée de l'Armançon,
les deux armées réunies se dirigent vers l'Arar
(la Saône), battant en retraite par la naturelle voie d'invasion
de la Gaule : la vallée du Rhône. Harcelée
par les 15.000 cavaliers gaulois de Vercingétorix la longue
colonne romaine riposte victorieusement grâce à l'intervention
de sa cavalerie mercenaire germanique. La proie est devenue le
chasseur, et Vercingétorix court s'enfermer dans l'oppidum
des Mandubiens : Alésia...
Tel est le sujet d'Alésia, troisième et
dernier volet de la trilogie (1)
Roma : Ab Urbe Condita qui, pour des raisons stratégiques
sur lesquelles nous reviendrons plus loin, sort avant les deux
premiers albums de la série (click).
| 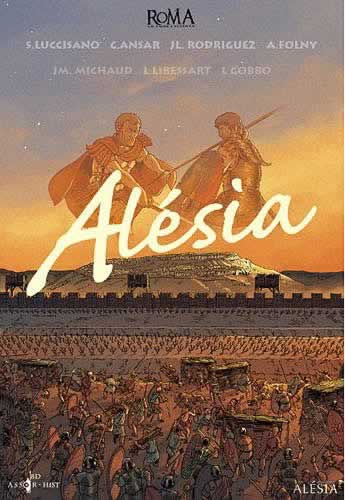
Un album de 82 pages dont
66 planches dessinées et un cahier historique, co-édité
par BD Assor-Hist et MuséoParc Alésia. Scénario
: Silvio Luccisano et J.-L. Rodriguez. Dessins : Christophe
Ansar (pl. 1 à 51), terminé par Jean-Marie
Michaud (Vercingétorix.
La BD du film), Laurent Libessart (Le Casque
d'Agris) et Ludovic Gobbo. Couleurs : Aurore Folny (site).
En collaboration avec Cl. Grapin, conservateur d'Alésia,
et les reconstituteurs Franck Mathieu et François
Gilbert.
Présentation vidéo sur Youtube |
Après les pédants «romans
de professeurs» qui fleurirent au XIXe s. (2),
voici venu le temps de la «BD d'archéologues».
Il s'agit cette fois non plus de faire étalage d'érudition
littéraire, mais d'appuyer le récit graphique par
un dossier pédagogique succinct en offrant une représentation
fiable (en l'état de nos connaissances actuelles) et non
plus hasardeuses comme a pu l'être, par exemple dans les
années '80, L'Histoire de France en BD de Larousse.
Cependant, force est de reconnaître que l'élément
fictionnel s'y intègre parfois avec une certaine gène
aux entournures. Alors que Le Casque d'Agris était
une pure fiction basée sur les strictes contingences de
l'état actuel de l'archéologie en matière
de la Civilisation gauloise du IIIe s., l'Alésia
du même scénariste, Silvio Luccisano, souffre quelque
peu de l'introduction dans une trame historique connue, de personnages
fictionnels censés tenir le rôle de coryphées
(3),
tout en suivant leur aventure personnelle. La raison est simple
: la série a été publiée à
rebours du fait que ce troisième tome Alésia
devait sortir conjointement avec l'inauguration du MuséoParc
Alésia, qui en était le co-éditeur avec Assor-BD.
1. Prolégomènes
: L'Antiquité en BD
1.1. Le pionnier de l'Antiquité-BD : Jacques Martin
Il y avait d'abord eu Jacques Martin avec «Alix» en
1948. Avec d'abord de premiers tâtonnements sous l'égide
du Hottenroth, du Racinet, du National Geographic et du Daremberg
& Saglio - fonction des sources disponibles à l'époque.
Ce fut le «Cycle épique d'Alix». Martin actualisa
ensuite sa documentation en même temps qu'il affinait son
dessin pour nous donner l'«Age d'Or d'Alix», qui court
des Légions perdues (1962) à Iorix le
Grand (1971). Sur les conseils de l'archéologue Jean-Pierre
Adam, qui travaillait sur un corpus de quelque 360 stèles
de légionnaires romains trouvées en Gaule, il commença
par reconsidérer les équipements des soldats romains
à l'époque de Jules César (à partir
de Vercingétorix, 1985).
Pourtant, de par la nature erratique de sa saga, Alix s'était
condamné à demeurer l'archéologue spatio-temporel
(4)
d'une Antiquité rêvée où, le temps
d'un album, il exhumait telle civilisation disparue - Sumer, Egypte
pharaonique, Grèce classique, Carthage punique - qui s'apprêtait
à redisparaître à jamais dans une formidable
conflagration : cas de figure incontournable de la littérature
d'aventure (Bob Morane, Kim Devil etc.). Sa documentation était
pourtant excellente, par exemple les travaux du précité
Adam sur l'architecture militaire grecque (5).
Alors bizarrement, la Gaule de Iorix le Grand (1971) se
couvrait de forteresses... hellénistiques, quand ce n'étaient
pas les fortifications d'«Altus Rhenus», sur le Rhin,
qui étrangement ressemblent à celles de Xanten (6)
(Colonia Ulpia Traiana), qui sont du IIIe s. de n.E. (Les
Barbares, 1996). Bref, une Antiquité fantasmée
et uchronique, où se mélangeaient sources archéologiques
et paléo-science-fiction débridée.
1.2. Quarante ans après...
Depuis 1968, la BD a grandi avec ses lecteurs; elle est devenue
adulte, c'est-à-dire plus politique et contestataire (Goscinny
est écarté de la direction de Pilote par
une junte de jeunes auteurs émargeant à Hara-Kiri).
En même temps, elle perd son jeune lectorat, la nouvelle
génération lisant de moins en moins. Désormais,
les auteurs de BD historique visent des situations plus réalistes...
sur tous les plans. Mais il n'y a pas que la sexualité
et la violence : on se documente mieux aussi. Pour autant les
plus érudits des scénaristes/dessinateurs ne sont
pas nécessairement des spécialistes. Au début
des années 2000 toutefois, ils vont se tourner vers les
professionnels, historiens ou archéologues. Quand ce ne
sont pas les spécialistes eux-mêmes qui s'y collent :
| — |
Le Casque d'Agris/1. Le Sanctuaire
interdit - Silvio LUCCISANO (sc.), Laurent LIBESSART (d.)
- Assor Histoire et BD éd., 2005 |
| — |
Le Casque d'Agris/2. L'or des
Sénons - Silvio LUCCISANO (sc.), Laurent LIBESSART
(d.) - Assor Histoire et BD éd., 2008 |
| — |
Arelate/1. Vitalis
- Alain GENOT (sc.), Laurent SIEURAC (d.) - Idée+ éd.,
2009; rééd. Cleopas, 2012 |
| — |
Roma. Ab Vrbe Condita/3 : Alésia
- Silvio LUCCISANO (sc.), Christophe ANSAR (d.) - Assor Histoire
et BD, SEM Alésia éd., 2012 |
| — |
La Guerre des Gaules/1 : Caius
Julius Cæsar - TAREK (sc.), Vincent POMPETTI (d.)
- Tartamudo éd., 2012 |
| — |
Arelate/2. Auctoratus
- Alain GENOT (sc.), Laurent SIEURAC (d.) - Cleopas éd.,
2012 |
| — |
Le Casque d'Agris/3 - Silvio
LUCCISANO (sc.), Claire BIGARD (d.) - Assor Histoire et BD
éd. (à paraître : septembre 2012 ?) |
| — |
Les empereurs gaulois -
Silvio LUCCISANO (sc.), Jean-Marie WOEHREL (d.) - Assor Histoire
et BD éd. (à paraître : 2013 ?) |
| — |
Casque d'Agris/4 - Silvio
LUCCISANO (sc.) (scénario bouclé - janvier 2012.
La série sera alors complète) |
| — |
Roma. Ab Vrbe Condita/? : Vorenus.
L'otage éduenne - Silvio LUCCISANO (sc.), Laurent
LIBESSART & Ludovic GOBBO (d.) - Assor Histoire et BD
éd. |
| — |
Roma. Ab Vrbe Condita/? : Gergovie
- Silvio LUCCISANO (sc.), ? (d.) - Assor Histoire et BD éd. |
| — |
La Guerre des Gaules/2 : Vercingétorix
- TAREK (sc.), Vincent POMPETTI (d.) - Tartamudo éd.
(à paraître) |
De la série au feuilleton
Autre particularité de cette mutation : entre 1948 et 1968,
la bande dessinée - qui n'était pas encore reconnue
comme un «9e Art» - se voyait considérée
avec méfiance par les pédagogues. La rédaction
du journal Tintin, par exemple, imposait à ses auteurs
un cahier des charges très précis : des aventures
en 62 planches de quatre strips horizontaux en vue d'une - éventuelle
- publication par demi-planches dans la presse quotidienne; et
aussi l'obligation d'un certain quota de textes explicatifs redondants,
afin d'affirmer le caractère «littéraire»
de ces «illustrés». Il y avait encore l'obligation
de trouver une «chute» à la fin de chaque planche,
en raison de la publication hebdomadaire de celles-ci.
C'est néanmoins dès 1962 que Martin entamait la
sixième aventure d'Alix en imposant un nouveau découpage
en trois strips horizontaux, canevas dont il semble être
l'initiateur - en cela bien vite imité par ses confrères.
De nos jours, ces contraintes sont bel et bien
révolues. La prépublication hebdomadaire n'existe
plus, faute d'hebomadaires. Les mensuels, les bi- et trimestriels
BD prépublient par salves de six-sept-huit pages, ce qui
laisse beaucoup plus de liberté aux auteurs; et de nombreux
albums sortent sans même jamais avoir été
prépubliés ! Après le régime des 62
planches (1948), puis de 54 planches (1969) on en arrive à
46 planches (1974) - mais certains éditeurs comme Glénat
reviennent parfois à 54 pl. (Les Boucliers de Mars),
ou Dargaud 56 pl. (Les Aigles de Rome). Exceptionnellement,
on s'en offre un nombre plus élevé (Glénat
: Julius/Le Troisième Testament, 76 pl.).
Le résultat est que nombre d'auteurs préférant
l'«art pour l'art» au détriment de l'efficacité
et de l'économie de moyens, trop contraignantes, produisent
des histoires en deux, trois, voire six albums. Quelques sagas
sont de véritables feuilletons tenant leurs lecteurs en
haleine de bout en bout, n'eusse été le désagrément
de devoir attendre un an pour connaître la suite (Væ
Victis, 15 albums 1991-2006).
Les séries d'autrefois (albums indépendants
les uns des autres autour d'un héros récurrent comme
Alix ou Timour), sont devenues d'interminables feuilletons
à lire nécessairement dans l'ordre chronologique.
C'est ainsi que L'Expédition, par ailleurs superbement
dessinée par Marcello Frusin, voit l'intérêt
du lecteur se diluer au fil des kilomètres déroulés
le long du Nil par le scénario de Richard Marazano. De
fait, dans ce premier tome où les personnages se mettent
en place, il ne se passe rien, absolument rien, sinon des gros
bras qui se castagnent. Ce récit d'une exploration des
sources du Nil, ou plutôt d'une chasse au trésor
organisée par une bande de ruffians déserteurs -
des légionnaires agissant pour leur compte personnel -,
consiste en une «histoire en costumes d'époque»,
non une «BD historique», comme aurait pu l'être,
par exemple, l'évocation d'une bien réelle expédition
africaine commanditée par Néron (7).
Ce genre de défaut se retrouve souvent dans la «BD
d'archéologues», mais avec l'excès inverse
: des personnages fictionnels ternes et effacés meublent
tant bien que mal les transitions entre les moments historiques.
1.3. Heurs et malheurs de la fiction historique
L'exégète se heurte à la contradiction qu'est,
en soi, le concept antithétique de «fiction historique».
Entre le fan lambda qui préfère la légende
si elle est plus belle que la réalité et boude la
«pédanterie du spécialiste», et le même
qui entre la poire et le fromage vous ressortira de vieux clichés
vus au cinéma ou dans une BD parce que «dans l'Antiquité,
c'était comme ça», le connaisseur - parfois
- ne sait plus où me mettre.
On s'émerveille d'entendre dire que,
pour Murena, Philippe Delaby ait pu caler pendant des semaines,
sinon des mois, sur des cothurnes (comment étaient-elles
à telle époque, telle saison), ce qui ne l'empêchait
pas, à l'occasion, de dessiner - dans une BD globalement
très respectueuse - des chars romains attelés sans
joug de garrot, mais avec palonniers (8),
ou de bizarres panoplies de gladiateurs s'étripant au milieu
d'une arène transformée en improbable barbecue (9).
Des équipements militaires aux mentalités (10),
en passant par les bateaux, la cuisine etc., chaque lecteur un
peu amateur a ses petites marottes. A fortiori les archéologues.
En effet, même archéologues, les auteurs de BD ne
peuvent veiller à tout (11)
!
Autre exemple. Le précité Væ Victis
est une saga éminemment réjouissante, admirablement
servie par l'époustouflant talent de Mitton au dessin.
C'est aussi une BD qui suit assez fidèlement le récit
de César, hormis l'insertion à toute force de l'héroïne
Boadicæa supposée être la grand-mère
de la Boadicæa (ou Boudicca) historique, qui ferait parler
d'elle 120 ans plus tard. Mais c'est aussi une BD contrariée
dans sa représentation conventionnelle des Gaulois (souvent
armés de haches !) ou de légionnaires romains d'époque
impériale tout droit sortis de Ben Hur - choix délibéré,
voulu et assumé de Mitton, du reste au grand dam du scénariste
Simon Rocca (Georges Ramaïoli) dont la documentation pointue
semble avoir été négligée (12).
Mais une BD est avant tout destinée à plaire au
plus grand nombre... et tant mieux si elle peut susciter le questionnement
du lecteur, lui donner l'envie d'en savoir plus... |
| |
2.
Alésia
| 
Le site d'Alésia, d'après
J. Le Gall (Alésia, Guides Archéologiques
de France, 1985). Nous avons fluoté en rose les
camps romains (A, B, 11, 15, C, 18, 1, K [attention : sur
le plan nous ne disposions que de minuscules «Lettraset»]
- selon la nomenclature de l'Histoire de Jules César
de Napoléon III). Celui de César est le B
[S.], et peut sans doute communiquer par signaux optiques
avec le C de Labienus [N.E.], distant d'un peu plus de 3
km.
Au N.O., quelque part sur le flanc du mont Réa, le
camp D de Reginus et Rebilus (non indiqué). Marc
Antoine et C. Trebonius devaient probablement se tenir dans
la circonvallation à la hauteur des camps I et K.
En vert, l'oppidum d'Alésia. Les lignes de niveau
resserrées nous montrent que le sud du plateau est
une falaise assez abrupte. Une croix verte indique l'emplacement
probable de la cavalerie de Vercingétorix, avant
son renvoi. Une flèche verte indique l'arrivée
de l'armée de secours, et la flèche bleue
le mouvement tournant de Vercassivellaunos. |
| 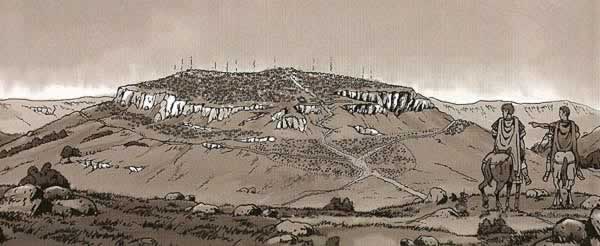
Alésia et ses falaises, vues du sud
(Luccisano & Ansar, Alésia) |
A. LES FAITS HISTORIQUES
2.1. Le site d'Alésia
Le site d'Alésia se présente comme un éperon
orienté vers le S.E. et adossé au levant par le
mont Pernelle (au début du siège, la cavalerie gauloise
campe sur ce flanc-là avant d'être renvoyée
par Vercingétorix). L'oppidum est encadré au nord
par la rivière Oze, au sud par l'Ozerain qui rejoint la
Brenne : toutes deux coulent E.O. en direction de la plaine des
Laumes qui s'étire à l'ouest d'Alésia.
Au nord d'Alésia, et d'ouest en est, nous avons le mont
Réa [N.O.], avec à sa base le camp D (commandé
par Reginus et Rebilius), le village de Grésigny-Sainte-Reine
[N.] avec le camp G, par où sont arrivées les légions
romaines sur les traces de Vercingétorix, puis la montagne
de Bussy [N.E.] où se dresse le camp C - celui de T. Labienus,
le second en importance.
Au sud de l'oppidum, et toujours d'ouest en est, juché
sur la montagne de Mussy (ou mont du Purgatoire [13]),
se trouve la commune de Mussy-la-Fosse par où arrivera
l'armée de secours gauloise, forte de 250.000 h dont 8.000
cavaliers; puis, en bas et en face, le camp K [S.O.]; vient ensuite
la montagne de Flavigny avec côte à côte les
camps A [S.] et B [S.], ce dernier, le plus important, étant
de toute évidence celui de César.
| 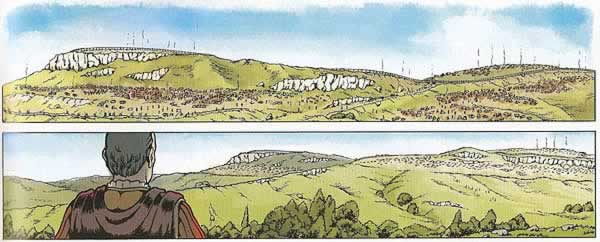
L'oppidum d'Alésia, vu des lignes
romaines. |
A l'ouest/sud-ouest de l'oppidum s'étend, donc, la plaine
des Laumes dominé, au N. par le mont Réa et le camp
D de Reginus et Rebilius (14),
et au S. par la montagne de Mussy, auquel fait face dans la plaine
le camp K. Ces fameux camps K, I et H de la plaine des Laumes,
reconnus par les fouilleurs de Napoléon III, sont à
l'extérieur des lignes romaines. «Construits probablement
dès les premiers jours du siège pour bloquer la
plaine, ils ont ensuite été abandonnés dès
l'achèvement de la contrevallation et de la circonvallation.
En effet, le dispositif des fortifications se suffisant à
lui-même, les troupes ont dû être réparties
ailleurs. César ne les cite pas durant les phases de la
bataille ce qui confirme leur abandon. Ils ont été
remplacés par les fameux fortins. Notons que, pour le moment,
et compte tenu de l'occupation urbaine de la plaine, leur présence
n'a pu être attestée par les dernières fouilles
(mais ils n'étaient pas recherché)», précise
le scénariste, S. Luccisano. Les camps K, I et H nous laissent
perplexe : si César les a rapidement abandonnés
pour les raisons sus-évoquées, il a dû aussitôt
les démanteler : d'une part pour en récupérer
les matériaux (le bois), d'autre part pour ne pas laisser
à l'ennemi la possibilité d'occuper ces bastions.
Mais il est probable que c'est dans l'un d'eux que se cachait
la cavalerie germanique qui prit à revers l'armée
de secours et la massacra.
Entre l'oppidum et la contrevallation, les Romains ont accumulé
pièges et fossés; de même le long de la contrevallation
pour prémunir contre une attaque de l'extérieur.
2.2. Le siège et la bataille finale
Le siège dura environ deux mois mais, hors quelques escarmouches
pendant la réalisation des travaux obsidionaux, le siège
d'Alésia se joua en trois jours de combats, une fois arrivée
l'armée de secours.
J -3. Le premier jour, l'armée de secours descendit
dans la plaine des Laumes et se heurta à C. Trebonius et
Marc Antoine. L'intervention des cavaliers germains les repoussa.
J -2. Le deuxième jour il ne se passa rien : l'armée
de secours l'occupa à préparer claies, passerelles
et harpons pour franchir les pièges. Mais la nuit venue,
elle attaqua de l'extérieur - soutenue par les assiégés
contre-attaquant de l'intérieur. En vain.
J -1. Le troisième jour, ayant détecté
que le point faible du dispositif romain était, au flanc
du mont Réa, le camp D de Reginus et Rebilius en contrebas,
les chefs envoient Vercassivellaunos - cousin de Vercingétorix
- avec 60.000 hommes. Les Gaulois, qui ont nuitamment contourné
la montagne, démarrent leur attaque à midi. César
[S.] commande à Labienus [N.] de voler au secours de Reginus
et Rebilius [N.O.] pris entre deux feux (15),
avec un renfort de 6 cohortes (G.G., VII, 86), puis 39
cohortes supplémentaires prises au front N.E. qui n'est
pas menacé (G.G., VII, 87).
S'il aime un peu calculer, le lecteur réalise à
ce moment que : 6 + 39 cohortes, ça fait plus de quatre
légions (16)...
or à Alésia César n'en avait que onze, peut-être
douze !
Ce troisième jour de la bataille, c'est donc Labienus qui
principalement endiguera les assauts de l'armée de secours.
La BD rend très bien la situation désespérée
des Romains, mais aussi leur sang froid. Celui de César.
Et celui des légionnaires !
Lui-même attaqué par Vercingétorix qui engage
une diversion au sud, César a d'abord dû régler
leur compte aux assiégés devant ses camps A et B,
avant de lui-même se porter - drappé dans son beau
manteau rouge - au secours de Reginus, Rebilius et Labienus, avec
toutes les troupes disponibles. César emprunte bien entendu
l'espace entre les murs de contrevallation et de circonvallation,
laissant son camp derrière lui, à la garde de Q.
Cicéron avec seulement cinq cohortes (17).
La BD rend très bien cet état de confusion des
combats sur plusieurs fronts et le lecteur se perdrait quelque
peu dans ces cohortes qui, passant d'un point à l'autre
du champ de bataille, fusent de partout, si, cartes à l'appui
et renvois aux pages BD, le dossier ne venait ensuite tout clarifier.
Il est à noter que l'album était initialement prévu
en 54 pl., mais qu'à la demande du MuséoParc il
a été régulièrement augmenté
de quelques planches (pour arriver à 66 pl. dessinées)
afin d'y développer de la manière la plus précise
possible la restitution du déroulement de la bataille.
2.3. La stratégie de Vercingétorix
Alors que d'autres comme Jean Lartéguy ou Simon Rocca -
qui pourtant ne priaient pas dans la même chapelle - descendaient
en flammes le fier héros gaulois du Second Empire et de
la IIIe République (18),
les scénaristes Luccisano et Rodriguez révisent
à la hausse le portrait du stratège Vercingétorix.
Et le dessinateur Christophe Ansar quant à lui, sur la
base des fameux statères du Musée de Saint-Germain-en-Laye,
lui restitue un visage glabre et aux cheveux courts plus vraisemblable.
L'image est inusuelle et déconcerte sans doute (click
et click). Ainsi sur
le forum «Passion-Histoire»,
un visiteur, «Bob d'Artois», écrit : «Bien
que justifiée, l'image de Gaulois non moustachus passe
un peu difficilement au départ, mais on finit par l'admettre.»
Bien connue des spécialistes, la thèse de S. Luccisano
n'est pas nouvelle - mais après l'impérissable baba-cool
zen Vercingétorix
de J. Dorfmann, il était bon de la repréciser auprès
du public. Vercingétorix avait sans doute soigneusement
médité le piège d'Alésia pendant que
ses émissaires achevaient de réunir la totalité
de ses contingents alliés. Ayant réussi à
amener César et l'ensemble de son armée à
se concentrer sur cet abcès de fixation qu'était
Alésia, il n'avait plus qu'à attendre que l'«armée
de secours» vienne envelopper les Romains sans que ceux-ci
puissent alors espérer la moindre aide de l'extérieur.
Hélas pour lui, le couvercle du piano devait lui retomber
sur les doigts ! La fortune de la guerre ! Le lendemain de J
-1, il ne lui restera plus qu'à rendre la garnison
affamée... et se livrer à César.
(Sans doute eut-il dû être plus prévoyant en
stockant davantage de vivres dans l'oppidum des Mandubiens. Sans
doute aussi, pendant que son cousin Vercassivellaunos s'acharnait
contre Reginus et Rebilius, l'étrange inertie du restant
de l'armée de secours, qui laissa faire, pourrait-elle
s'expliquer par le fait qu'elle était, outre Commios l'Atrébate,
commandée par les Éduens Viridomaros et Eporédorix
- qui probablement estimèrent qu'il valait mieux laisser
tirer leur plan à leurs vieux rivaux arvernes.)
| 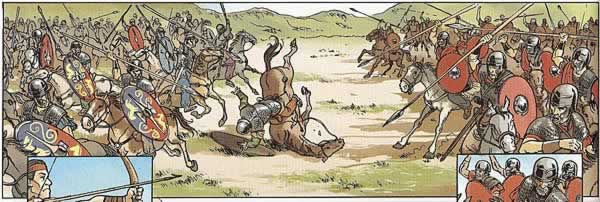
|
|
| |
B.
L'ALBUM
2.4. Silvio Luccisano & alii
Une foultitude d'intervenants ont encadré le dessinateur
Christophe Ansar. D'abord les scénaristes : Silvio
Luccisano, un passionné d'archéologie (19),
et J.-L. Rodriguez. Luccisano assumant l'aspect technico-archéologique
et Rodriguez, pour sa part, assurant la réflexion tactico-stratégique
avec la bénédiction de Christian Goudineau,
du Collège de France. L'amitié de Chr. Goudineau
est à mettre en relief : après le film de J. Dorfmann,
nombre de scientifiques faisaient le gros dos quand on leur parlait
de cinéma ou de BD. Les deux compères sont épaulés
par un comité scientifique composé de l'archéologue
Claude Grapin (conservateur en chef du site d'Alésia),
d'un spécialiste des armements celtiques Franck Mathieu
(20)
(président des «Leuki», archéologie
expérimentale) et d'un spécialiste des armements
romains François Gilbert (21)
(centurion de la Leg. V Alaudæ [Lyon], président
de «Pax Augusta», archéologie expérimentale).
Les six sous la supervision de l'éditeur Eriamel
[Thierry Lemaire], c'est-à-dire Assor-BD (22)
- un éditeur spécialisé dans les BD didactiques
sur le Moyen Âge normand (23).
Et encore faut-il à Luccisano coordonner le travail de
la coloriste Aurore Folny, puis pour les quinze dernières
planches celui des dessinateurs Jean-Marie Michaux (crayonnés),
Laurent «Agris» Libessart (qui anime les personnages
de Vercingétorix et César) et Ludovic Gobbo
(encrage).
Sur scénario du même Silvio Luccisano, Laurent Libessart
avait déjà dessiné les deux premiers tomes
du Casque d'Agris, précédemment parus chez
le même éditeur Assor-BD. Partant d'un casque cultuel
de fer et bronze doré (ca 350) trouvé par
des spéléos dans la grotte des Perrats (Charente)
(24),
Le Casque d'Agris brodait une histoire située en
pays sénon, à la fin du IIIe s. av. n.E. (Second
âge du fer, -450/-30). Un dessin précis et carré,
des faciès patibulaires mais qui pour autant ne manquent
pas d'élégance -, le tout admirablement servi par
les coloristes Robakowski et Mambba lesquels assurèrent
les couleurs respectivement des tomes 1 et 2.
| 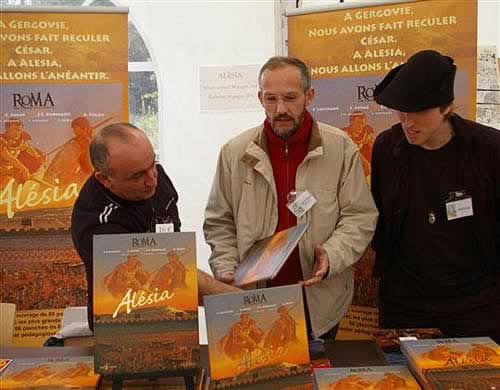
De gauche à droite : S. Luccisano,
Chr. Ansar et L. Libessart (phot. SDR) (extr. Arbre
Celtique) |
L'album étant réalisé
en coédition avec le MuséoParc Alésia, et
le soutien du conseil général de la Côte d'Or,
Assor-BD était tenu à un délai de livraison
de l'ouvrage terminé, sous peine de prendre des pénalités
de retard. Le délai initial était fixé à
juillet 2010. Ce dernier a ensuite été repoussé,
du fait du retard pris par les entreprises sur la construction
du musée, à juillet 2011. Or, début 2011,
Christophe Ansar accusait un léger retard et, compte tenu
du fait que l'éditeur avait demandé aux auteurs
de davantage détailler les dernières scènes,
il fallut progressivement passer de 54 à 66 planches. Dans
ces conditions, Christophe n'aurait jamais pu être dans
les délais et Assor Hist et BD se serait vu appliquer des
pénalités de retard.
C'est alors que Thierry Lemaire prit l'heureuse initiative de
faire appel à «l'armée de secours»,
c'est-à-dire trois dessinateurs supplémentaires
dont Laurent Libessart. Rodé à la question de la
documentation historique et archéologique, ce dernier a
pu terminer les encrages sur un crayonné de Michaud peu
poussé dans ce genre de détail. De son côté,
Christophe Ansar a pu terminer les planches qui lui étaient
imparties - pendant que Michaud attaquait déjà la
suite - ce qui fait qu'il s'est arrêté à la
planche 51. Pour sa partie artistique, l'album a été
terminé en juin 2011 et aussitôt expédié
à l'imprimeur pour une sortie en septembre. Bien évidemment,
pour achever l'opus Alésia, Laurent Libessart et
ses deux complices durent s'adapter au style graphique de Ansar,
plutôt «ligne claire».
|
Deux ennemis s'affrontent dans une lutte inexpiable
: Jules César, proconsul de Rome, et Vercingétorix,
chef des Arvernes et généralissime des Gaulois
révoltés (extrait du site de la coloriste
Aurore
Folny) |
2.5. Christophe Ansar
Depuis 1996 assistant de Gilles Chaillet, Christophe Ansar a participé
aux décors du Fantôme de Bruges, enchaînant
coup sur coup six «Vasco» et les quatre premiers tomes
de La Dernière Prophétie, soit dix albums.
Ensuite, Chaillet lui donna sa chance en lui proposant de dessiner
entièrement, mais sur son scénario, le «one-shot»
Dioclétien - Le Trésor des Martyrs (2011). «Il
m'a laissé entière liberté pour le choix
de mes cadrages. Bien sûr, je lui montrais les planches
crayonnées et il corrigeait mes faiblesses de dessin, surtout
sur les premières planches. Ce fût une très
belle collaboration riche d'enseignement pour moi et dans une
ambiance de travail que je regrette», rappelle Chr.
Ansar (25),
qui ajoute : «Il est certain que la complicité
qui nous unissait facilitait le travail. Le grand professionnalisme
(préparation irréprochable du synopsis, du découpage
du scénario complet avant départ, une documentation
claire, simple et efficace) de mon ami me permettait de dessiner
l'esprit libre et de me concentrer sur mes problèmes de
dessin. Gilles m'a fait un superbe cadeau en me donnant ma chance.
Que Jupiter Très Bon et Très Grand accueille à
sa table cet ogre généreux» (26).
| 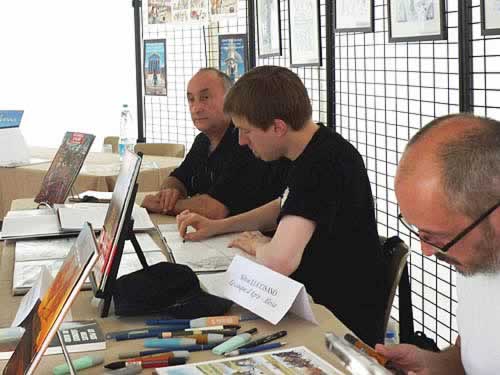
De gauche à droite : S. Luccisano,
L. Libessart et L. Gobbo en dédicaces à «Archéo-culte»,
Forum de Bavay, samedi 30 juin 2012 (phot. MCW) |
Et arriva ce qui devait arriver. Encore un peu emprunté
dans le dessin de ses personnages, notre ancien décoriste
s'attaque à Alésia, bientôt rejoint
par les spécialistes militaires qui prennent le train en
marche. «Malheureusement j'ai pris le train en marche,
à mon arrivée quelques planches étaient déjà
faites, regrette F. Mathieu. Vu les délais,
il n'a pas été possible d'accomplir le travail indispensable
de préparation en amont, il a fallu traiter les planches
une par une et faire rectifier les erreurs, malgré les
dossiers que nous avions rendu François et moi, assez précipitamment»
(27).
Pour Alésia, la musique ne fut pas la même
que pour le Dioclétien avec Chaillet. Le trop grand
nombre d'interlocuteurs posait problème au dessinateur.
«La grande quantité de documentation que je devais
engloutir était souvent rediscutée avant même
que j'aie eu le temps de la digérer», déplore
Christophe Ansar. Rien que pour les Gaulois, un dossier
de 150 pages, principalement des dessins, apprend-on sur le site
Arbre
celtique.
«La préoccupation des ces spécialistes
était non pas le scénario et sa tenue d'ensemble,
mais la véracité historique et surtout archéologique.
Je me suis gardé d'intervenir dans ces débats pour
tenter de protéger ma bulle dessin. (...)
«Il n'en reste pas moins que les allers-retours des
crayonnés de planches avec leur cortège de remarques
ont fini par émousser mon bel enthousiasme du début.
Le temps de travail s'en est aussi trouvé multiplié»
(28).
«Très exactement 4.058 heures de temps de travail
! Qui se sont étalées sur deux ans et demi. Il faut
compter en moyenne 60 heures par planche, entre le crayonné,
la mise en place, les corrections, l'encrage...», déclare
le dessinateur sur le site Arbre
celtique. N'oublions pas qu'un dessinateur est payé
à la planche, pas à l'heure - quel que soit le nombre
d'heures.
«J'ai même redessiné les cinq premières
pages de l'album car les nombreux spécialistes voulaient
tous s'exprimer et faire passer leur point de vue. C'était
un carnage, plus de la moitié des pages étaient
couvertes de texte. (...) J'ai donc exigé qu'elles
soient refaites, c'est peut-être la seule fois où
j'ai été écouté dans cette histoire...»,
regrette Ansar (29).
«La méthode de travail de Christophe Ansar amenait
des crayonnés très aboutis, rendant le travail long
et peu productif; du retard s'est donc accumulé et il a
fallu passer à la vitesse supérieure pour tenir
les délais. Malgré tout, le résultat est
très satisfaisant, même si pour un reconstituteur
comme moi bien des choses pourraient encore être améliorées,
confirme F. Mathieu. Je crois qu'à ce niveau,
la bataille de la BD Le Casque d'Agris/2 est le travail
de conseil que j'ai le plus abouti, et la compréhension
et la plume de Laurent Libessart ont dépassé ce
que j'avais imaginé, permettant de donner vie à
une vision que j'échafaude avec mes collègues depuis
de nombreuses années; j'en tire aujourd'hui une certaine
fierté...» (30).
«À la décharge des scénaristes,
qui sont des amis, il faut dire que cette BD [Alésia]
doit être tout public, alors qu'aujourd'hui, elle est
de plus en plus à destination des adultes. Il faut donc
qu'elle soit très consensuelle, concède F.
Gilbert. (...) Le dessinateur a souffert, car il avait
trois personnes (dont moi) qui passaient tout à la moulinette,
obligeant à refaire et refaire les détails (les
casques d'officiers, ma bête noire !). (...) Le second
dessinateur qui a fait les dernières planches a travaillé
plus vite, et son trait est plus dynamique» (31).
«La collaboration entre les différents intervenants
pour l'élaboration de cette BD ne fut pas sans encombre,
résume F. Mathieu. Comme les effets spéciaux
au cinéma, la reconstitution ne doit pas se faire au détriment
du scénario, l'effet spécial appuie le scénario
tout comme la reconstitution la plus précise possible vient
renforcer le réalisme de l'histoire racontée...
(...) Il a fallu traiter une masse de données très
importante et effectuer un travail qui n'avait jamais été
fait auparavant pour les Gaulois (comme pour les Romains) : armement,
architecture, art de la guerre, dialogue - par exemple : éviter
de placer dans la bouche de Vercingétorix le terme «Gaulois»
- vêtements, code couleur et symbole pour reconnaître
les peuples au sein des armées gauloises, etc.» (32)
. (A propos des motifs des vêtements gaulois, cf. Appendice).
2.6. La reconstitution archéologique
Dessiner un album tel qu'Alésia exige un maximum
de documentation, et pas uniquement au niveau des artefacts archéologiques
(armes, vêtements, architecture), mais aussi au niveau des
paysages. Christophe Ansar a dessiné Bibracte (33)
et Alésia d'après photos, mais la topographie de
la vallée de l'Armançon (p. 17)
a été imaginée à partir d'une carte
IGN en se basant sur les courbes de niveaux, de même pour
la topologie de la grande double page représentant le panorama
d'Alésia (pp. 54-55).
«Cet album a nécessité plus de trois années
de travail (pour la partie dessins) et le résultat final
peut sans doute être discutable au niveau des dessins et/ou
du scénario - note Silvio Luccisano, scénariste
et initiateur du projet -, mais je pense qu'il est, à
ma connaissance, aujourd'hui le seul album BD à traiter
du sujet de façon aussi sérieuse et documentée.
« Pour une fois, nous avons ici des représentations
les plus juste possible, en l'état actuel de nos connaissances,
sur le sujet : légionnaires césariens portant un
casque type «Coolus-Mannheim» (34),
typique de la guerre des Gaules (le «Montefortino»
semblant plus ancien), un glaive type «Délos»
ou «Ljublijanica» (click).
pour les fourreaux et dont la lame mesure environ 60 à
65 cm, à double tranchant et comportant un léger
rétrécissement sur son premier tiers inférieur
(et non plus les glaives impériaux type «Pompéi»,
plus courts et à bords parallèles), des boucliers
cintrés et arrondis de forme non pas rectangulaire mais
ovale, un umbo caractéristique de cette période,
etc.
« Pour les Gaulois nous avons la même chose avec des
casques type «Alésia» pour la plupart des guerriers,
des cottes de mailles, des umbo de bouclier caractéristiques
également de notre période, et des épées
plus longues à pointe arrondie. Bref, du matériel
militaire typique de ces années-là. Un œil
averti notera également l'utilisation d'armes de «récupération»
sur l'ennemi, que ce soit par les Romains ou plus particulièrement
par les Gaulois.»
| 
De la fondation de la République
(Ve s.), à la chute de l'Empire romain d'Occident
mille ans plus tard, on s'est représenté le
légionnaire sous l'aspect immuable de la Colonne
trajane. On sait - depuis pas mal de temps, déjà
- que son équipement a évolué et que,
selon les époques, son look devait sensiblement
s'éloigner de ce que l'on peut voir dans les péplums.
Le légionnaire de Jules César n'était
pas celui de Scipion l'Africain (-202), ni celui de Tibère
(+14), moins encore celui de Marc Aurèle (+180) ou
de Flavius Aetius (+451).
En regardant ce dessin de Laurent Libessart, on peut sans
peine imaginer l'effet qu'aurait produit sur un Romain de
l'an 52 av. n.E. un légionnaire sorti, par exemple,
de films comme Cléopâtre ou Ben Hur
: une capote bleu-horizon de 14-18, avec un bonnet de grenadier
du Premier Empire, des bottes du XVIe s. et un fusil d'assaut
moderne ! |
«Fini également la représentation
du Gaulois chevelu, moustachu et barbu pour aller vers des personnages
plus raffinés, bien habillés, ajoute Silvio
Luccisano.
« Tout cela est le fruit de mon travail de recherche
sur la question, travail entrepris depuis de longues années.
Étant donné que l'album est réalisé
en co-édition avec le MuséoParc Alésia, j'ai
bien entendu recherché la collaboration de Claude Grapin,
le conservateur du musée d'Alésia (pour tout ce
qui concerne l'archéologie du site) ainsi que celle de
deux amis spécialistes de l'armement antique [les précités
F. Mathieu et F. Gilbert - NDLR]. Mon objectif, avec cet album,
a été avant tout de réactualiser cette bataille
en tenant compte des dernières données de la recherche.
| 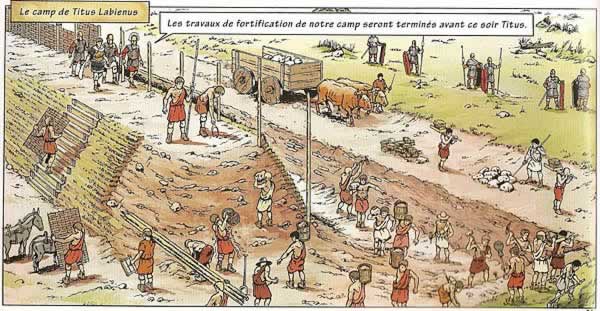
La construction du vallum : creusement
des fossés et élévation des talus,
ainsi que la récupération des mottes de gazon,
selon l'éclairage des plus récentes recherches
sur le site d'Alésia (Luccisano & Ansar, Alésia,
p. 32) |
« Par exemple, nous montrons comment les Romains ont
édifié les fortifications avec des remparts en mottes
en gazon et élevé des tours à un seul étage
et non plus à 2 ou 3 comme montré jusqu'à
présent. Les fouilles nous renseignent également
sur la forme et la taille des fossés, ainsi bien ceux de
la contrevallation que ceux de la circonvallation, et que nous
avons reproduit à l'identique (35).
« De même, ces fouilles ont démontré
la présence d'au moins un petit fortin romain entre les
deux lignes, dans la plaine, fortin que nous avons reproduit à
l'identique également [p. 58, 4e v. -
NDLR (36)].
Idem pour les portes des camps de hauteur, fouillés
également. Les représentations du cœur de l'oppidum
sont également le fruit des fouilles, tout comme celles
des murs et des portes des fortifications» (37).
| Les
tours défensives romaines à Alésia
: (1) à trois étages, telles qu'on les
imaginait autrefois; (2) à un seul étage,
telles qu'on peut les voir aujourd'hui au MuséoParc
d'Alésia, inauguré le 22 mars 2012;
(3) Ci-dessous et telles que reconstituées
dans l'album Alésia (Assor-BD, 2012),
les tours de la contrevallation dont les auteurs ont
pris en compte les plus récents acquis des
fouilles archéologiques
------
(1) Couverture de Joël LE
GALL, Alésia, Guides archéologiques
de la France, Ministère de la Culture, Imprimerie
Nationale, 1985.
(2) Photo C. Jachymiak, SEM Alésia, extraite
de «Alésia», Archéologia,
HS ní 14, avril 2012, p. 79. Notez aussi les différences
dans l'interprétation des parapets, simples
rondins alignés ou claies tressées :
il aurait fallu déforester à des dizaines
de kilomètres à la ronde dans le cas
de la précédente hypothèse.
(3) S. Luccisano, Chr. Ansar & alii, Alésia,
p. 56 |
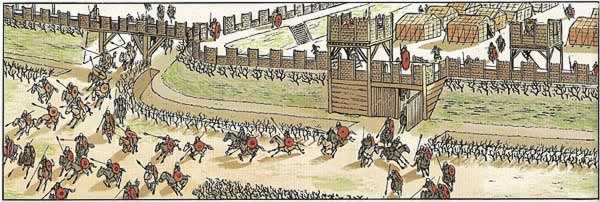 |
|
| 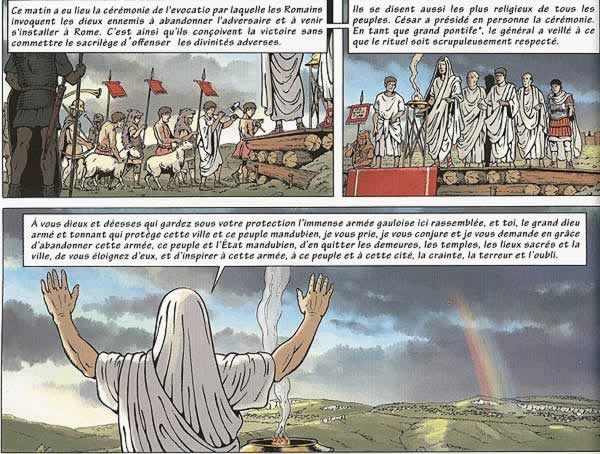
Autre trouvaille astucieuse, S. Luccisano
a imaginé ce rituel dont César ne souffle
mot, sans doute parce qu'il allait de soi : l'evocatio,
qui consiste à offrir l'hospitalité romaine
aux dieux ennemis, dont on s'apprête à saccager
la ville - et sans doute les sanctuaires - en échange
de leur bienveillance |
2.7. Les personnages fictionnels
A priori nous sommes favorable à des albums de ce
genre, qui sont à la BD ce que le docu-fiction est au téléfilm.
Pourtant, la «BD didactique» induit un sentiment de
raideur, et les personnages de fiction ont l'air «parachutés».
Le scénario est un peu déconstruit par l'introduction
des deux «correspondants de guerre» grecs (Timée
chez les Gaulois et Likhas chez les Romains, ainsi que leur amie
Gaëlla - qui, elle, espionne pour le compte des Gaulois),
dont la présence est certes utile de par leurs commentaires
«pédagogiques», mais dont l'aventure personnelle
au fil de la lecture n'est ni très clair, ni très
passionnant. Le problème vient en partie du fait que la
trilogie n'ayant pas été éditée dans
l'ordre chronologique, ces personnages fictionnels n'ont pas bénéficié
de la mise en place normale, comme il en est dans toute BD. Mais,
au début de l'album, un petit résumé des
«épisodes précédents» (38)
non encore écrits ni dessinés nous explique le rôle
de ces fictionnels Timée, Likhas et Gaëlla.
|
L'espionne de Vercingétorix, la gauloise
Gaëlla - compagne du grec marseillais Likhas, apprenti
historien qui observe les Romains de l'intérieur,
et cousin de Timée (qui lui observe du camp gaulois).
Un personnage fictionnel introduit dans l'album à
l'aide d'un chausse-pied ? |
Le souci archéologique n'exclut
pas l'humour. On appréciera l'allusion au centurion Vorenus
: clin d'œil à la série TV Rome
(HBO) ? En réalité, il était déjà
le héros d'un premier scénario de S. Luccisano,
écrit il y a 25 ans - et que le scénariste vient
de «remettre sur le métier», avec L Libessart
et L. Gobbo au dessin (Vorenus. L'otage éduenne).
Sa présence à Alésia en 52, quoique non attestée,
est plausible (en 54, Vorenus était centurion de Q. Cicéron
en son camp sur la Sambre) (G.G., V, 44).
Il en va de même en ce qui concerne Caius Arpineius, le
Romain prisonnier qui préfère la mort à la
liberté (39)
: ce caractère bien trempé était digne d'un
Atilius Regulus ! Dans César, le chevalier romain C. Arpineius
est envoyé comme ambassadeur à Ambiorix par son
ami Sabinus (G.G., V, 27-28); on ignore s'il périt
dans le massacre qui s'ensuivit des quinze cohortes de Sabinus
et Cotta mais, pour les besoins de l'album, S. Luccisano l'a supposé
avoir été fait prisonnier et lui a inventé
une camaraderie d'armes avec Vercingétorix.

Post-scriptum
Il est également question, chez Casterman, d'un Alix
raconte : Alésia, dessiné par Wyllow
sur scénario de Pascal
Davoz; ce dernier est déjà auteur, dans la galaxie
martinienne, d'un Jacques Martin présente : Napoléon
Bonaparte dessiné par Jean Torton (un tome paru, sur
les quatre annoncés). Le projet semble toutefois avoir
pris du retard.
| 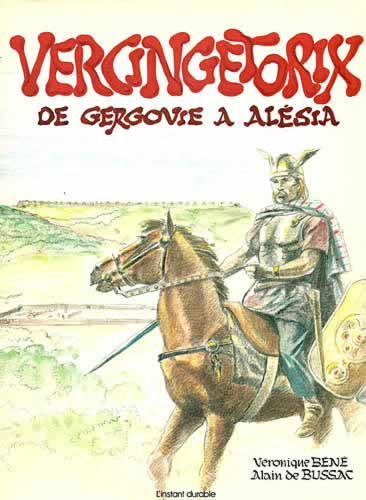
Une image traditionnelle de Vercingétorix
en armes de l'Age du Bronze. Alain de Bussac (sc.) &
Véronique Béné (d.), Vercingétorix.
De Gergovie à Alésia, Clermont-Ferrand,
SOPREP éd., coll. «L'Instant durable»,
1982, 32 p. |
|
| |
Appendice
: les étoffes gauloises
A regarder «Astérix», on croirait que les
Gaulois - dont le goût pour les coloris voyants, les étoffes
de couleurs vives est bien connu - ne connaissaient que les tissus
à grosses rayures. Dans le film Vercingétorix,
la costumière Edith Vesperini avait choisi de croiser en
carreaux des couleurs chaudes (rouge-vert-jaune) pour les Arvernes
et froides (vert-bleu-noir) pour les Eduens, leurs rivaux du nord-est.
Il s'agissait de les différencier aux yeux des spectateurs.
De fait, on ne sait rien, absolument rien des «tartans»
gaulois (40).
Colleen Mc Cullough avait poussé l'ironie jusqu'à
affubler les Eburons, tribu belge, de rouge-jaune-noir, c'est-à-dire
les couleurs de l'actuel drapeau belge (!). Il n'y a pas qu'au
cinéma que la question se soit posée. Dans les troupes
de reconstitution celtiques les plus sérieuses, les Gaulois
aiment porter des motifs à carreaux qui font penser aux
Écossais, mais sans être tout-à-fait pareils.
Spécialiste de la reconstitution gauloise
et consultant de la BD Alésia, Franck Mathieu résume
la situation : «A propos des étoffes à
carreaux : le domaine du vêtement est un des moins connu.
Il existe quelques éléments archéologiques
attestant de ces carreaux, on sait que les tisserands et tisserandes
celtes utilisaient un métier à tisser vertical
à poids (jusque vers les années 1950 encore
utilisé en Laponie) et qu'ils tissaient en sergé
2/2 permettant les motifs en chevrons et les chevrons opposés
donnant donc des losanges. En mélangeant plusieurs couleurs
par exemple plusieurs fils rouges côte à côte
suivis de plusieurs fils bleus côte à côte
et ainsi de suite et que les fils de chaînes verticaux et
les fils de trames horizontaux se croisent perpendiculairement
les fils de trame et de chaîne d'une même couleurs
se croisant donneront des carreaux bleus ou rouges... Par exemple
le prince de Hochdorf (Ier Age du Fer) est enterré avec
plusieurs étoffes (dont la matière n'est pas tranchée
aujourd'hui par les spécialistes) dont une était
à carreaux rouges et bleus...» (41).
Nous avons également consulté
Dominique et Jean Matthieu («La Couenne»), artisans-reconstituteurs.
«Les Gaulois connaissaient en effet les tissus écossais,
des fragments d'étoffes non pas gauloises mais celtes ont
été retrouvés, de l'époque du Premier
âge du fer, à Hallstatt en Autriche, ainsi qu'au
Danemark et en Allemagne du Nord, dans les tourbières.
En ce qui concerne les textiles gaulois à proprement parler,
les archéologues n'ont pas retrouvé pour le moment,
à ma connaissance, de textiles «écossais»
en Gaule.
| « Les conditions nécessaires
pour retrouver des textiles sont : |
| — |
soit une atmosphère
saturée d'humidité (tourbières, zones
lacustres, puits, rivières voir glace ou neige [ötzi],
|
| — |
soit, à l'opposé,
une atmosphère dénuée d'humidité
(Egypte par exemple ou grâce à la présence
du sel comme en Autriche à Halstatt), |
| or ce se sont pas les milieux
que l'on retrouve le plus souvent en Gaule... |
« On peut supposer toutefois que si
leurs ancêtres pratiquaient ces techniques, ils les connaissaient
aussi. Il est certain que les Celtes, lors de leur premier flux
migratoire, sont partis vers la Belgique puis la Grande Bretagne.
Rien ne s'oppose donc à ce qu'ils aient apporté
ces techniques et que les Ecossais ou du moins leurs ancêtres
aient découvert l'écossais à cette occasion»
(42).
«Pour ce qui est du sergé :
le sergé est une armure spécifique (une armure
est un mode d'entrecroisement des fils de chaîne et des
fils de trame), qui permet de réaliser des obliques comme
les toiles de jeans.
Pour réaliser du sergé sur un métier à
tisser vertical il faut un métier à trois barres
minimum, voire quatre. Les Celtes maîtrisaient déjà
cette technique dès le Premier âge du fer, comme
le prouvent les fragments de tissus retrouvés à
Hallstatt.
|
Quatre fragments de textiles
de Hallstatt (extraits de : Peter BICHLER, Karina GRÖMER,
Regina HOFMANN-DE KEIJZER, Anton KERN & Hans RESCHREITER
(édit.), Hallstatt Textiles. Analysis, Scientific
Investigation and Experiment on Iron Age Textiles) |
|
|
|
A gauche, la robe de Huldremose
datée du Ve s. av. n.E., retrouvée dans une
tourbière et visible au Musée national du
Danemark, atteste aussi de la présence de rayures
verticales et horizontales (extr. : Karina GRÖMER,
Prähistorische Textilkunst in Mitteleuropa),
tout comme - à droite - le manteau d'apparat de Thorsberg
(extr. : Der Thorsberger Prachtmantel, Forderverein
Textilmuseum Neumünster). |
|
|
|
En ce qui concerne le sergé
2/2, on peut voir le tartan ci-dessus et son tissage
: deux fils de trame devant, deux fils de trame derrière,
avec un décalage à chaque fil de trame. Selon
cet ouvrage Weaving methods, le tartan apparaîtrait
dès 1.200 av. n.E. sur certaines momies, ainsi qu'à
Hallstatt.
Il y est confirmé que le tartan est un sergé,
que l'on peut par conséquent réaliser sur
un métier à tisser vertical à trois
ou quatre barres (extr. : Christina MARTIN, Weaving methods,
patterns & traditions of ancient art) |
«Le tartan venait-il des Celtes ou d'ailleurs,
personne n'est en mesure de l'affirmer, mais les Celtes savaient
le faire !», conclut la tisserande Dominique Matthieu
(«La
Couenne») (43). |
|
NOTES :
(1) Qui ne sera peut-être qu'un
diptyque : s'il semble que l'on puisse espérer un 2.
Gergovie, le 1. Avaricum est plus incertain. - Retour
texte
(2) Le fleuron du genre étant
sans doute Kampf um Rom (1876) (inédit en français,
à notre connaissance), écrit par un professeur
de grec hambourgeois, Felix Dahn : version grand public de sa
«kolossale» histoire des rois germains en dix volumes.
Mais avec un mot latin toutes les deux lignes le vrai pompon
de la pédanterie sera décerné à
Jean Lombard (L'Agonie (1888); Byzance (1890)),
qui du reste n'était pas professeur mais ouvrier-orfèvre
[... «en la matière», a-t-on envie d'ajouter].
- Retour texte
(3) Comme on sait, dans la tragédie
grecque, le coryphée mène le chœur
dont les interventions commentent les actions des protagonistes.
- Retour texte
(4) M. ÉLOY, «Alix, archéologue
spatio-temporel», in Les Expéditions d'Alix,
Centre belge de la bande dessinée (CBBD) & La Poste,
Bruxelles, 2007, pp. 29-58. - Retour texte
(5) J.-P. ADAM, L'architecture
militaire grecque, Picard, 1982. L'ouvrage est sorti en
librairie dix ans après Iorix le Grand (1971-1972).
Mais Adam - fouilleur de Pydna [Kydna] en Lycie - s'était
mis en rapport avec Martin dès la publication du Dernier
Spartiate (1967), à propos de l'architecture militaire
grecque précisément.
Hors les oppida gauloises - d'un tout autre style architectural,
du reste - la Gaule ne se fortifia pas avant le IVe s. de n.E.
pour faire face aux invasions barbares. - Retour
texte
(6) Telles que reconstituées
à l'Archäologische Park de Xanten, en 1974. - Retour
texte
(7) Dans ses Questions naturelles,
Sénèque a rapporté l'expédition
ordonnée en 61 par Néron pour retrouver les sources
du Nil; après avoir séjourné chez la reine
Candace de Méroé, puis remonté le Nil Blanc
jusqu'à son confluent avec le Bahr el-Ghazal, dans les
marais du Sudd - elle ne rentrera, décimée, qu'au
printemps 63. Sur le mode didactique, elle a été
retracée par André BÉRÉLOWITCH (sc.)
& Carlo MARCELLO (d.), «Aux sources du Nil»,
Découverte du Monde en BD, ní 18, Larousse, 1980,
23 pl.
(En 24 av. n.E., une précédente expédition
de 10.000 hommes avait été dirigée contre
l'Ethiopie par C. Petronius, préfet d'Egypte.) - Retour
texte
(8) D'après des photos de Ben
Hur (1924)) dont, du reste, on retrouvait aux deux extrémités
de la spina une libre interprétation des colosses
M.G.M. de 1924 et 1959 (Murena/5 : La Déesse Noire,
pp. 15-25). - Retour texte
(9) «Barbecue» éminemment
fantasmatique, comme nous l'a confirmé en souriant le
scénariste, Jean Dufaux. L'idée des deux ponts
se croisant au milieu de l'arène était un clin
d'œil au décor de la venatio dans Barabbas
(1961), sauf que dans le film il n'y avait que des fauves sous
les ponts (Murena/4, pl. 20 à 27). Clin d'oeil
également à Gladiator (2000) où
l'on voit bizarrement un provocator armé d'une
arme d'hast à cinq dents tout droit sortie de l'arène
de Zucchabar... affrontant un rétiaire... coiffé
d'un casque de secutor (Murena/4, Ceux qui vont mourir,
pl. 25, v. 6). - Retour texte
(10) La confusion d'Hadès
avec Satan dans les péplums hollywoodiens, p. ex.
Ces scénaristes ne parviennent pas à (ou supposent
le public incapable de) concevoir que les Enfers mythologiques
ne sont pas le lieu de relégation des méchants
(c'est le rôle du Tartare), au contraire de l'Enfer judéo-chrétien.
A noter que Jacques Martin a commis la même bévue
dans Le Cheval de Troie, où la présence
d'une patte de bouc est assimilée à celle du Diable.
- Retour texte
(11) Comme le reconnaît, par
exemple, Jean-Jacques Grizeaud, archéologue INRAP, chercheur
associé UMR 5608 TRACES Toulouse, conseiller sur les
deux albums du Casque d'Agris. (J.-J. GRIZEAUD, «Ce
que le travail d'un archéologue peut apporter à
la réalisation d'une bande dessinée antique :
l'exemple gaulois du Casque d'Agris», in Antiquité
et bande dessinée (textes réunis par Régis
Courtray), Toulouse, ARTELA, 2008, pp. 21-30. - Retour
texte
(12) Reconnaissons qu'il y a au moins
une vignette où l'on voit les légionnaires coiffés
du casque «Montefortino» ! (Væ Victis/2,
pp. 41-42). - Retour texte
(13) Nom alternatif : cf.
abbé Joseph JOLY, Le guide du siège d'Alésia,
Dijon, 1966. - Retour texte
(14) «Le fameux camp de
Reginus, au pied du Réa, n'a pu être reconnu en
fouilles, le site étant occupé actuellement par
l'emprise SNCF; cependant, il devait certainement, comme les
fortins de la plaine, être compris entre les lignes, ce
que nous avons reproduit dans l'album», précise
S. Luccisano (e-mail 24 juillet 2012). - Retour
texte
(15) Vercingétorix, descendu
de l'oppidum, les attaquant dans le dos, sur la contrevallation.
- Retour texte
(16) Une légion se compose
de dix cohortes. - Retour texte
(17) César ne mentionne ni
Cicéron ni ses cinq cohortes. C'est une hypothèse
de la BD. - Retour texte
(18) Dans Tout Homme est une Guerre
Civile, Jean
Lartéguy évoque Vercingétorix comme
un épouvantail fabriqué de toutes pièces
par César afin de magnifier sa propre victoire; pour
Rocca/Ramaïoli, l'Eburon Ambiorix avait montré plus
de talents et d'acharnement que ce traîneur de sabre incompétent
(Væ Victis). - Retour texte
(19) Fouilleur bénévole,
S. Luccisano est président du GRAM (Groupe de Recherche
archéologique de Melun). - Retour
texte
(20) F. MATHIEU, Le guerrier gaulois
du Hallstat à la conquête romaine (préf.
F. Gilbert), Errance éd., 2007, 143 p. - Retour
texte
(21) F. GILBERT, Le soldat romain
à la fin de la République et sous le Haut-Empire
(préf. Christian Goudineau), Errance éd., 2004,
192 p. - Retour texte
(22) AssoR Hist & BD :
«Association Recherches Historiques & bandes dessinées»,
à St-Martin-du-Bec ( www.assorbd.com ). - Retour
texte
(23) On trouve à son catalogue
: Moi Svein, compagnon d'Hasting - Italia Normannorum - La
saga de Bósi - Chroniques anglo-saxonnes - L'Epte, des
Vikings aux Plantagenets - Les riches heures d'Arnaud de Bichancourt
- Le Cœur de Lion... - Retour
texte
(24) Actuellement au Musée
d'Angoulème. - Retour texte
(25) E-mail Chr. Ansar, 23 janvier
2012. - Retour texte
(26) E-mail Chr. Ansar, 6 janvier
2012. - Retour texte
(27) E-mail F. Mathieu, 6 janvier
2012. - Retour texte
(28) E-mail Chr. Ansar, 6 janvier
2012. - Retour texte
(29) E-mail Chr. Ansar, 23 janvier
2012. - Retour texte
(30) E-mail F. Mathieu, 6 janvier
2012. - Retour texte
(31) E-mail F. Gilbert, 27 décembre
2011. - Retour texte
(32) E-mail F. Mathieu, 6 janvier
2012. - Retour texte
(33) Alésia, p. 6,
dernière vignette. - Retour texte
(34) Le «Coolus» et le
«Mannheim» sont très semblables de forme
(c'est le type : «toque de jockey», sans couvres-joue),
mais le premier est plus léger (entre 500 et 800 g) et
le second plus lourd et plus finement travaillé (plus
de 1.000 g) (click).
Après les réformes de Marius, l'armée romaine
équipe elle-même les légionnaires, et ses
manufactures produisent en grande série des casques bon
marché, consistant le plus souvent en une simple calotte,
sans couvres-joue et avec un très étroit couvre
nuque.
Bien que plus ancien, le type «Montefortino» d'origine
italique conservera la faveur «rétro» des
Prétoriens aux débuts de l'Empire.
Sur l'évolution des casques grecs, celtiques et romains,
cf. Michel FEUGÈRE, Casques antiques. Les visages
de la guerre, de Mycènes à la fin de l'Empire
romain, Errance, 1994; rééd. 2011. - Retour
texte
(35) La contrevallation est
la ligne défensive entourant l'oppidum assiégé;
la circonvallation est la ligne défensive garantissant
l'assiégeant contre une attaque venue de l'extérieur.
- Retour texte
(36) Le fortin de l'Épineuse.
«Ce fortin compris entre les lignes est bien de forme
carrée, avec des côtés d'environ 100 m,
la fouille le confirme. Des portes en chicane sont aménagées
aux angles. Pouvant accueillir une cohorte, il est probable
qu'il y en ait eu d'autres implantés à égale
distance sur toutes les fortifications de la plaine. Il sert
certainement de coin de repos aux légionnaires de garde
sur ce secteur. Il porte le nom du carrefour routier près
duquel il a été retrouvé» (e-mail
S. Luccisano, 24 juillet 2012). Ce type de redoute permet un
cloisonnement transversal pour empêcher que l'adversaire,
s'il arrivait à percer la ligne de défense, ne
puisse impunément se répandre dans l'espace entre
la circonvallation et la contrevallation (cf. «Alésia»,
Archéologia, HS ní 14, avril 2012, p. 66, et Michel
REDDÉ, Alésia. L'archéologie face à
l'imaginaire, Errance, 2003, p. 178 sqq.). - Retour
texte
(37) E-mail S. Luccisano, 29 janvier
2012. - Retour texte
(38) A ne zaper sous
aucun prétexte, ou vous êtes fichu ! - Retour
texte
(39) Ce personnage fictionnel
est censé avoir combattu aux côtés de Vercingétorix,
au temps où il était l'allié de César,
et lui a même sauvé la vie. Désireux de
s'acquitter de sa dette, le chef arverne désire le faire
évader pendant qu'on exécute ses compagnons pour
satisfaire à la vengeance de ses officiers. - Retour
texte
(40) Tartan :
le terme est écossais, mais nous l'utiliserons ici -
faute de mieux - pour désigner les étoffes aux
couleurs claniques des Gaulois du continent. - Retour
texte
(41) E-mail F. Mathieu,
6 janvier 2012. - Retour texte
(42) E-mail «La
Couenne», 1er janvier 2012. - Retour
texte
(43) E-mail «La
Couenne», 15 janvier 2012. - Retour
texte
|
| |
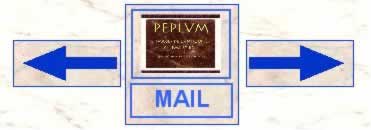 |
|