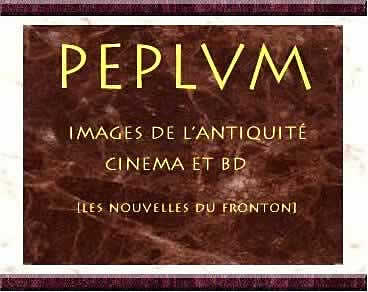 |
| |
| |
Apostat
Ken Broeders
[Page 3/3]
|
|
| |
|
|
|
Bibliographie
| Un incontournable ouvrage de référence
: |
- Joseph BIDEZ, L'empereur Julien ou le conflit de
l'hellénisme et du christianisme, Paris, Delpeuch,
1929; rééd. La vie de l'empereur Julien,
Belles Lettres, 2012, 420 p.
Fruit de longues années de recherche et de réflexion,
cette synthèse historique solide retrace l'étonnante
carrière de Julien, homme de lettres et empereur,
par une succession de chapitres courts. Le gros de l'ouvrage
porte sur la brève période de la vie de
Julien où ce dernier, devenu empereur, s'est appliqué
à restaurer l'hellénisme, à réformer
le paganisme par une théocratie et à lutter
contre le christianisme. L'apport de Joseph Bidez est
de montrer que le combat contre le christianisme n'est
pas le fruit d'un plan établi d'avance et réalisé
par étapes mais la résultante d'une succession
de mouvements et de revirements divers au gré des
circonstances de l'époque.
Biographie de l'auteur - Historien et
philologue belge, Joseph Bidez a été l'un
des plus éminents chercheurs de l'histoire de l'Antiquité
tardive. Formé à la philologie par H. Diels
à Berlin, il enseigna à l'université
de Gand dès 1894. Il fut président de l'Académie
Royale de Belgique (1934). Aux Belles Lettres, on lui
doit la traduction des œuvres complètes de
l'empereur Julien (CUF) et Les Mages hellénisés
en collaboration avec F. Cumont (1938, rééd.
2007).
|
| |
| Et pour «contextualiser
un peu» : |
- Peter BROWN, Genèse de l'Antiquité
tardive (préf. Claude Veyne - trad. Aline Rousselle),
NRF/Gallimard, 1983, 197 p.;
- Pierre CHUVIN, Chronique des derniers païens.
La disparition du paganisme dans l'Empire romain, du règne
de Constantin à celui de Justinien, Les Belles
Lettres/Fayard, coll. «Histoire», 2009, 378
p.;
- Lucien JERPHAGNON, Vivre et philosopher sous l'Empire
chrétien, Privat, 1983, 215 p.;
- Pierre MARAVAL, Théodose le Grand (379-395).
Le pouvoir et la foi, Fayard, 2009, 381 p. (celui
qui, définitivement, mit fin au paganisme);
- Henri-Irénée MARROU, Décadence
romaine ou Antiquité tardive ? (IIIe-IVe siècle),
Seuil, coll. «Points - Histoire», ní H29,
1977, 183 p.;
- Vincent PUECH, Constantin. Le premier empereur chrétien,
Paris, Éllipses éd., coll. «Biographies
et Mythes historiques», 2011, 391 p. (celui
qui introduisit le ver dans le fruit).
|
| |
| Militaria
: |
- Philippe RICHARDOT, La fin de l'Armée romaine
(284-476) - 3e édition revue et augmentée
avec une traduction de la «Notitia Dignitatum»,
Économica éd., coll. «Bibliothèque
stratégique», 2005, 408 p.;
- Alain ALEXANDRA & François GILBERT, Légionnaires,
auxiliaires et fédérés sous le Bas-Empire
Romain (Dessins des boucliers de la «Notitia
Dignitatum» : François Gilbert), Errance
éd., coll. «Histoire Vivante», 2009,
111 p.
|
| |
| 
Légionnaire en tenue de repos; il est
coiffé de la toque pannonienne qui peut aussi servir
de sous-casque (ph. François Gilbert) |
|
| |
| Quelques classiques : |
- GREGORIUS NAZIANZENUS (saint Grégoire
de Nazianze), Discours contre l'Empereur Julien l'Apostat,
Inde, Nabu Press, 2011, 410 p.
Il s'agit, en fait, d'une réédition anastatique
des Discours de Saint Grégoire de Nazianze contre
l'Empereur Julien d'Apostat, avec des remarques (Lyon, Marcellin
Duplain éd., 1735);
- JULIEN, Lettres : Edition bilingue français-grec,
Belles Lettres, 2008, 250 p.
Considérés dans leur ensemble, ses écrits
offrent un aperçu de Julien l'Apostat sans équivalent
pour aucun autre personnage antique, hormis Cicéron.
Dans ce corpus singulier, fait de traités (le Misopogon
ou le Contra Galileos), de polémiques, de panégyriques
ou de discours, les lettres, qui s'étendent de sa mission
en Gaule en tant que César (355) à la proclamation
de Lutèce, puis au séjour à Antioche et
à Constantinople et enfin à la campagne de Perse
(363), forment un ensemble exceptionnel. Avec un art d'écrire,
dont Alexandre Kojève a souligné la singularité,
Julien l'Apostat s'y révèle et expose sa vision
ambiguë du christianisme et du judaïsme, et surtout
son adhésion au paganisme. Ces lettres sont des documents
rares permettant de suivre les méandres d'une pensée
d'un apostat qui peine à s'émanciper de la religion
qu'il a quittée et dont le syncrétisme ne convainc
ni les païens ni les chrétiens. Au-delà de
l'échec de la restauration du paganisme, elles donnent
de l'Empire, à la veille de sa christianisation définitive,
une vision fort différente de la légende noire
de l'Apostat, tissée notamment par un ancien condisciple,
le Père de l'Eglise Grégoire de Nazianze;
- JULIEN, Défense du paganisme :
Contre les Galiléens, Fayard/Mille et Une Nuits,
«La Petite Collection», ní 575, 2010, 112 p.
C'est à Antioche, quelques mois avant sa mort tragique,
que l'Empereur Julien (331-363) rédige un pamphlet Contre
les Galiléens, qui dénonce avec vigueur la
prétention à l'universalité de la petite
secte chrétienne. Mais au-delà de la critique
de cette nouvelle religion, c'est à une véritable
apologie du paganisme qu'il se livre.
Il n'était alors pas trop tard pour empêcher le
triomphe annoncé du christianisme, mais le règne
de Julien fut beaucoup trop bref. S'il l'avait emporté,
la face du monde en eût été changée
et il ne serait pas resté dans l'Histoire comme l'Apostat...
Rétrospectivement, ce texte apparaît donc comme
le chant du cygne de la religion grecque;
- JULIEN, Misopogon, Belles Lettres,
2003, 96 p.
C'est à Antioche, ville-phare de l'Orient christianisé,
qu'en février 363 un homme laisse exploser sa colère
dans un discours, le Misopogon (l'«Ennemi de la
barbe»), qui a traversé les siècles sans
perdre de sa force. Quand tant d'autres ont disparu, ce document
fut conservé par la grâce des dieux, peut-être,
mais surtout du fait de l'étonnante personnalité
de son auteur qui ne laissait personne indifférent, pas
même ses pires détracteurs. L'homme n'est rien
moins que l'empereur Julien, dit l'Apostat. Son discours, magnifiquement
authentique car si peu conventionnel, éclaire le rendez-vous
manqué entre les valeurs qui l'animaient, novatrices
autant que réactionnaires, et la réalité
complexe d'une civilisation en marche malgré lui. Il
souligne aussi la tension entre son idéal philosophique,
teinté de mysticisme ambitieux, et la mission du chef
d'État qui aurait dû continuer d'œuvrer à
l'unité impériale dans le respect des différences
et dans une relative acceptation des médiocrités
humaines. Discours d'adieu : Julien tourne le dos à Antioche
pour suivre les traces d'Alexandre le Grand et mourir, quelques
mois plus tard, sous les traits des Perses.
Littérature
L'empereur Julien apparaît dans de nombreux romans que
Danny Hesse a passés en revue : |
- Danny HESSE, «Roman-péplum : une figure, l'empereur
Julien l'Apostat», in Cahiers des para-littératures,
ní 1, Liège, C.L.P.C.F. / Céfal, 1989, pp. 57-78.
|
| |
| Retenons seulement : |
- Dmitri MEREJKOWSKI (1865-1941), 1. Julien l'Apostat, ou
La mort des dieux (Smert' bogov : Julian Otstupnik)
(1895 ?) (St-Peterbourg, 1906), Paris, Bossard éd., 1927,
468 p. (trad. Henri Mongault); rééd. Gallimard,
1957; nouvelle édition Calmann-Lévy (trad. Jacques
Sorrèze - peu satisfaisante !). Premier volume d'une
trilogie Christ et Antéchrist : 2. Les dieux ressuscités
: Léonard de Vinci (1902), 3. L'Antéchrist
: Pierre et Alexis (1904);
- Gore VIDAL, Julien (Julian, 1962), R. Laffont,
1964 & 1966, 616 p. (trad. Jean Rosenthal)
- Jacques BENOIST-MÉCHIN (1901-1983), L'empereur
Julien, ou Le rêve calciné, Librairie Académique
Perrin, 1977, 478 p.;
- Claude FOUQUET, Julien. La mort du monde antique (introd.
Pierre Grimal), Belles Lettres, 1985, 364 p.;
- Lucien JERPHAGNON, Julien, dit l'Apostat. Histoire naturelle
d'une famille sous le Bas-Empire, Seuil, 1986, 308 p.
|

M. Valerius Pius, centenier de la Leg.
II Herculia (Herculiani seniores) avant que de devenir
héros de polars-péplums publiés chez
Calleva. Notons, sur le bouclier, l'emblemata de
l'aigle noir sur fond rouge d'après la Notitia
dignitatum (ph. Coll. P. Demory) |
Une mention spéciale pour deux romans
policiers «en péplum» ayant pour cadre le règne
du César Julien (un troisième opus est en
cours d'écriture, centré sur la bataille d'Amida,
en Mésopotamie, mais où Julien n'apparaîtra
pas beaucoup) : |
- Patrick DEMORY, Le
Feu de Mithra - Une enquête du centurion Marcus Valerius
Pius, Strasbourg, Calleva éd., coll. «Traces»,
2009, 350 p.
Aurelius Carro, officier du César Julien, a été
sauvagement assassiné selon un rituel particulièrement
pervers... Le centurion Marcus Valerius Pius se voit confier
l'enquête. Il se retrouve rapidement sur la piste d'un
complot de très grande envergure autour d'une arme nouvelle
et terrible, qu'on nomme le «feu de Mithra».
Marcus Pius et ses hommes doivent alors faire face, au péril
de leur vie, à un ennemi redoutable et sournois, qui
agit dans l'ombre des ruelles de Lutèce, qu'on commence
tout juste à appeler Paris.
Entre enquête policière et espionnage, le mystère
du feu de Mithra les poursuivra jusqu'à la bataille d'Argentoratum
(Strasbourg), dans les derniers soubresauts de l'Empire romain
d'Occident qui joue sa survie face à la menace barbare;
- Patrick DEMORY, Peur
sur Lutèce - Une enquête du centurion Marcus
Valerius Pius, Strasbourg, Calleva éd., coll. «Traces»,
2011, 270 p.
Lutèce, capitale des Gaules, janvier 358 de n.E. Victorieuses
des envahisseurs alamans, les légions du César
Julien passent un hiver de repos sur les bords de la Seine.
Le César lui-même a été rejoint par
son épouse, Hélène, qui porte en son sein
un fils, peut-être un futur empereur.
Mais même au plus froid de l'hiver, peut-on jamais trouver
la paix ? Dans les faubourgs de la cité des Parisii,
des jeunes femmes agonisent dans d'atroces souffrances, victimes
d'une maladie étrange.
Sortilège ou empoisonnement ? Magie noire ou complot
? Comme celle du César, toutes ces femmes étaient
enceintes...
|
| |
Filmographie
Au cinéma, Julien se trouve au centre de deux films
seulement : Ugo FALENA, Giuliano l'Apostata (IT - 1919)
& Giuseppe Maria SCOTESE, L'Apocalypse (L'Apocalisse,
IT - 1946). L'essentiel de ce qui suit est repris d'un dossier
publié ailleurs (1).
Giuliano l'Apostata |
Italie, 1919
|
Giuliano l'Apostata
Prod. : Bernini-Film (Rome) / 2.178 m
Fiche technique
Réal. : Ugo FALENA; Scén. : Ugo FALENA (Sujet tiré
du «poème symphonique en quatre visions» de
Luigi MANCINELLI et Ugo FALENA); Images : Tullio CHIARINI; Décors
: Duilio CAMBELLOTTI & Camillo INNOCENTI.
Fiche artistique
Guido GRAZIOSI (Julien l'Apostat) - Ileana LEONIDOFF (Eusébie)
- Silvia MALINVERNI (Hélène) - Ignazio MASCALCHI
(empereur Constance) - Marion MAY (page Tajano) - Rina CALABRIA
(Isa, esclave noire) - Filippo RICCI (Athanase) - Claude CAPARELLI
(Oribase) - Mila BERNARD (une Galiléenne) - Vincenxo D'AMORE
- Pietro PEZZULLO - Eduardo SCARPETTA - Lorenzo BENINI.
DISTRIBUTION
IT/ Cito-cinéma (sortie à
Rome, 31 mai 1920) (visa de censure : 14.598 du 1er septembre
1919)
SCÉNARIO
Julien, dont la famille a été exterminée
par l'empereur Constance, devient, grâce à ses mérites,
commandant des légions romaines destinées à
défendre les Gaules. Attiré par Eusébie,
femme de Constance, une païenne, Julien est au contraire
obligé par l'empereur à épouser sa sœur
Hélène, femme modeste et pieuse.
Eusébie, quand la fortune de Julien, qui a soumis les barbares
en Gaule, est à son comble, fait tuer Hélène
par l'esclave Isa, tandis que Constance, craignant le pouvoir
croissant de Julien, cherche à lui retirer ses meilleures
légions pour les destiner à un autre front, mais
elles se soulèvent et proclament Julien empereur.
Constance décède de maladie, cependant qu'Eusébie
cherche dans le suicide l'expiation de sa faute. Devenu César,
Julien décide de restaurer le paganisme. Mais, après
le premier et éphémère accord de la plèbe,
sa croisade contre la prophétie du Christ se révèle
irréalisable.
Une flèche, décochée par Tajano, le page
d'Hélène, le frappe mortellement pendant la campagne
de Perse. S'entretenant stoïquement avec ses amis de l'immortalité
de l'âme, Julien achève sa vie sur les paroles :
«Tu as vaincu, Galiléen», dans lesquelles
se résume sa tragédie et qui signent la victoire
définitive du christianisme.
CRITIQUES
«Ugo Falena a su faire œuvre d'imagination, sans
fausser l'histoire : en l'interprétant, au contraire, avec
une sensibilité exquise. Il a voulu recomposer l'image
du héros fou, du mystique «à l'envers»,
comme il ressort des pages qui nous restent de lui, en la soustrayant
aux splendeurs excessives de ses apologistes et aux nombreux voiles
opaques des ses détracteurs... L'imagination tendue vers
le passé lumineux d'une époque toute en lueurs et
en fantasmagories, vivant avec les forces vives de son cœur
dans la réalité historique de son siècle,
païen dans ses aspirations et inconsciemment galiléen
en réalité, redonnant en vain la vie à des
choses illustres mais mortes, la refusant à des choses
nouvelles mais vivantes, romain dans les songes de son imagination
et byzantin dans l'action concrète, Julien est le «héros-symbole»
de toute l'instabilité humaine devant l'éternel
mystère de la vie.
Placer une telle figure dans les limites des figurations matérielles
du cinéma, était vraiment une entreprise à
faire trembler. Pourtant, ce Julien est une construction
pleine de vie et de vitalité : pour être appelée
œuvre d'art, on n'en perçoit pas moins, parfois, les
palpitations haletantes de l'écran. Du prologue à
l'épisode final, le travail est organisé merveilleusement,
avec un sens aigu et profond de la technique théâtrale...
La réalité historique et la légende, avons-nous
dit. Eh bien, ces deux noms qui reviennent fréquemment,
dans la tradition historique, à coté de celui de
Julien (Hélène et Eusébia), ces noms des
deux figures impériales énigmatiques et fermées
sur lesquelles s'est accumulé, à travers les siècles,
un monceau de doutes, d'accusations, d'hypothèses et de
justifications, Ugo Falena a voulu en faire des héroïnes
palpitantes, réelles et consistantes, de telle sorte qu'il
en fait des stimulants puissants pour les contrastes spirituels
et la dynamique réaliste.
Quant au déroulement de l'action, il n'y a que cela à
dire : peut-être la première et la dernière
parties pèchent-elles par le fait que l'exposition est
plus narrative que dramatique, et va jusqu'à assumer un
caractère quelque peu statique et monotone; mais le caractère
grandiose des visions variées, leur intensité dramatique
sévère, la richesse intelligente des décorations,
des habits, l'interprétation toujours efficace des acteurs,
constituent des mérites si grands et si rares qu'on est
en droit de retenir que ce Julien est une œuvre au-dessus
de toute conception d'opportunisme mercantile, et qui va au-delà
des façons de procéder dans l'ars minor du
cinéma.»
|
Angelo PICCOLI, Apollon, Rome, 30 juin
1920
|
| |
«Les défauts que l'on
remarque dans cette représentation historique d'Ugo Falena
sont communs à tous les films du même genre et tiennent
par-dessus tout au vieux critère immuable selon lequel les
travaux eux-mêmes sont exécutés et projetés.
Quand on entreprend l'exécution d'un film de thème
historique, chez nous comme ailleurs, il me semble qu'on perd généralement
de vue le but final auquel ce film doit servir. Tous les soins sont
tournés exclusivement vers l'habit scénographique,
ou à donner le maximum d'ampleur aux éléments
chorégraphiques. Presque tous les efforts se concentrent
pour reconstruire les éléments d'architecture et pour
rassembler les troupes les plus denses de figurants : on oublie
au contraire la partie la plus importante, je dirais vitale, du
travail, c'est-à-dire le sujet et les interprètes...
Le public, au cinéma comme au théâtre, veut
être ému ou intéressé; il accorde plus
d'attention aux cas des personnages, à leurs expressions
qu'à leurs vêtements ou à leur environnement.
Peu importent l'époque, les coiffures ou les lieux, pourvu
que s'y adapte le fait dramatique, ou mieux, humain, sur lequel
faire converger son attention, et qui puisse passionner ou distraire.
Par conséquent, la première chose qui arrive dans
un film, quel qu'en soit le genre, est un bon sujet, puis des interprètes
excellents, et enfin une mise en scène qui serve à
mettre en valeur et en évidence l'un et les autres...
Ce qui est insuffisant dans Julien l'Apostat, c'est précisément
le sujet et l'interprétation; leur faiblesse est d'autant
plus évidente que la mise en scène est plus somptueuse.
On ne peut expliquer comment Ugo Falena, qui est un homme de théâtre
et connaît les exigences de la scène, a pu construire
une telle trame sans se rendre compte que non seulement elle ne
présentait aucun intérêt particulier, malgré
l'argument dramatique, mais qu'elle manquait de toute perspective
scénique. Où est l'action dramatique dans Julien
l'Apostat ? A quoi aboutit le formidable contraste religieux
et passionnel ? Comment, à travers quel processus spirituel,
s'accomplit l'apostasie de Julien, et par-dessus tout, quels sentiments
l'animèrent quand il restaura les dieux païens et combattit
le galiléisme constantinien.... En somme, le sens théâtral
de la représentation s'est égaré; on n'a pas
l'impression d'assister à un film, mais à une vision
de lanterne magique, qu'un guide élégant et distingué
illustrerait et commenterait...
On ne pouvait choisir interprètes plus malheureux : Ileana
Leonidoff, comme Silvia Malinverni... non seulement manquent d'une
plastique appropriée et d'une beauté typique, mais
encore révèlent un art médiocre et pauvre en
expression. Leurs sentiments, jalousie sombre et inexorable, amour
ardent, soif de pouvoir chez l'une, affection timide et dévouée,
résignation douloureuse chez l'autre, ne donnent aucun résultat.
On peut dire la même chose de Guido Malinverni, qui fait de
Julien, plutôt qu'une figure vivante, en accord avec lui,
animée de pulsions guerrières et de passions tourmentées,
un fantoche insignifiant, une espèce d'automate. Ses gestes,
ses actions, sont un radotage perpétuel. Seul Ignazio Maschalchi
imprime des traits virils et vigoureux au sournois Constance.» |
ANONYME, La rivista cinematografia (Turin),
25 avril 1923 (2)
|
| |
Apocalypse
(L')
Apocalypse (L') [FR]
Apocalypse
(L') [BE] |
Italie, 1946
|
|
Apocalisse (L')
Apocalisse (L') [IT]
Rom in Flammen [AL]
Apocalipsis [SP]
Prod. : Exceptionnal Films (Rome) - Lux / N&B / 90' (ou 100'
?)
Fiche technique
Réal. : Giuseppe Maria SCOTESE; Scén. : Pier Maria
ROSSO di SAN SECUNDO, Aldo RACITI, Giuseppe Maria SCOTESE &
Henry CLARK HAG (d'après un sujet de ce dernier); Images
: Aldo TONTI (& Leonida BARBONI [séq. antiques]), Renato
DEL FRATE [séq. modernes]); Renato BASSOLI (Exceptionnal
Films); Mont. : Otello COLANGELI; Décors : Antonio TAGLIOLINI,
Enrico VERDOZZI (collab. : Vittorio VALENTINI); Constructions
monumentales : Ugo NICCOLAI; Cost. : Gino C. SENSANI, Anna Maria
FEA; Dir. prod. : Giuseppe FATIGATI, Evaristo SIGNORINI; Assist.
réal. : Antonio MUSU, Girogio LASTRICATI; Musique : Ed
(Edoardo) MICUCCI.
Fiche artistique
Massimo SERATO (tribun Marcus Tullius) - Lilia LANDI (Julia) -
Tullio CARMINATI (préfet Astérius) - Alfredo VARELLI
(empereur Julien) - Vera BERGMAN - Laura REDI - Jone [Ione] SALINAS
- Enrico GLORI - Silvana PAMPANINI - Carlo TAMBERLANI - Marcello
GIORDA - Pietro [Peter] SHAROFF - Nando TAMBERLANI - Laura GORE
- Sandro RUFFINI - Umberto SPADARO - Peter SZLATARY - Guglielmo
BARNABÒ - Paolo CARLINI - Bianca DORIA - Luigi TOSI - Francesco
GRANDJAQUET - Dianora VEIGA - Liana DEL BALZO - Loris GIZZI -
Raimondo VAN RIEL - Guglielmo SINAZ - Claudio ERMELLI - Giorgio
MOSER - Leonilde MONTESI - Renata MUSSO - Francesca BIONDI - Dedi
RISTORI - Franco PESCE.
DISTRIBUTION
AL/ Lloyd-Film (sortie en Allemagne,
15 juillet 1949)
BE/ Cosmopolis
FR/ C.I.D. - Compagnie indépendante
de distribution de films (Une sélection Cosmopolis films)
(sortie, 22 février 1950)
IT/ Artisti Associati - Reg.
Cin.co ní 1.413
NOTES
Incasso : 324.400.000 L.It.
Dialogue fr. : Roland DORGELÈS (de l'Académie Goncourt)
- avec le concours de Jean YONNEL (Sociétaire de la Comédie
française).
BIBLIOGRAPHIE
O'BRADY, «Julien l'Apostat et la bombe atomique se sont
donnés rendez-vous dans... L'Apocalisse»,
Cinémonde, 30 septembre 1947; «Rom in Flammen»,
Illustrierte Film-Bühne, ní 373; Gremese 2,
p. 42.
SCÉNARIO
(Fin du règne de Julien l'Apostat, en 363.)
1938, Rome. Au Parlement comme dans la rue est prêchée
une doctrine de violence. La Science a résolu le problème
de la désintégration de l'atome, découverte
qui peut mener l'humanité à sa destruction. L'industrie
de l'armement accueille les bras des déracinés qui
ont fuit leurs campagnes natale. Les paysans échoués
dans les villes découvrent le vice et la prostitution.
En vain des prédicateurs élèvent leur voix
contre la violence et la déchéance. Il y a 2.000
ans, à Pathmos où l'avait exilé Domitien,
l'apôtre Jean, le compagnon préféré
de Jésus, avait eu la vision des sept péchés
capitaux sous la forme d'un dragon à sept têtes,
et avait vu quatre Cavaliers d'Apocalypse : la Famine, la Guerre,
la Peste et la Mort se répandant sur la terre. Rome, la
nouvelle Babylone, était en train de sombrer et en pleine
décadence.
363, Rome. Luxure, violence, perversité et corruption
dominent Rome. Le préfet Astérius s'intéresse
uniquement à sa maîtresse, et n'est là pour
personne ayant quelque affaire sérieuse à traiter.
L'empereur Julien fait campagne contre la Perse, l'ennemi extérieur;
mais à l'intérieur de l'Empire il s'acharne à
combattre les chrétiens. Ayant annulé l'Edit de
Constantin, il a décidé de rétablir de culte
des anciens dieux. Il charge de cette mission son aide de camp
le plus fidèle : Marcus Tullius. Ce tribun a reçu
tous les pouvoirs pour faire exécuter les nouveaux ordres
par le préfet de Rome, Astérius. Sur le chemin qui
mène à Rome, Marcus Tullius a à l'esprit
l'image de Julia. Celle-ci est la fille du sénateur Maximus,
l'un des hommes les plus riches de Rome, connu comme Epicurien,
mais qui s'est convertit au christianisme pour plaire à
Constantin.
| 
Marcus (Massimo Serato) & Julia (Lilia
Landi) : deux âmes dans la tourmente de la fin d'un
monde... |
Ayant transmis les ordres de l'Empereur, Marcus Tullius se rend
auprès de Julia. Mais c'est une toute autre Julia qu'il
retrouve. Elle est encore plus belle, plus épanouie qu'avant
son départ - mais elle s'est laissée totalement
corrompre par les plaisirs des sens.
Le nouvel édit impérial est publié par le
préfet, et ses ordres exécutés. Les chrétiens
sont poursuivis et emprisonnés (et parmi eux Maximus).
Dans les temples réouverts, on sacrifie aux anciens dieux.
Une fête populaire, une bacchanale termine cette journée
en orgie. Marcus Tullius en reste abasourdi et plein de répugnance.
Mais lorsqu'il aperçoit Julia ivre, déambulant d'un
pas mal assuré dans la rue au bras d'un patricien, il est
saisi d'épouvante. Il adresse des reproches au préfet
au sujet de la décadence morale, et quitte Rome avec un
sentiment de révolte.
De retour auprès de l'Empereur Julien, Marcus Tullius
découvre les légions décimées (les
Perses en retraite ont empoisonné les puits). Julien s'obstine
à continuer cette campagne si mal engagée, malgré
les conseils d'en finir, que lui prodigue Tullius. Julien croit
obstinément au triomphe final de l'endurance du légionnaire
romain sur les fuyards Perses, comme en la justesse de sa cause
contre la doctrine du Christ - du Galiléen, qu'il méprise.
Mais la nuit venue, son sommeil est troublé par la vision
des quatre cavaliers de l'Apocalypse, doit il perçoit le
bruit des sabots. Arrive un courrier qui annonce l'imminence du
combat. Eléphants, chars de guerre, chevaux et piétons
romains forment leurs rangs. L'armée romaine ne brille
pas par l'enthousiasme; néanmoins, au prix d'un effort
titanesque, elle arrive à contraindre les Perses à
battre à nouveau en retraite. Mais Julien est trouvé
mourant sur le champ de bataille, et s'éteint avec le sentiment
d'avoir été vaincu par le «Galiléen».
Les légions rentrent à Rome : mais elles ne sont
plus qu'une horde désordonnée. Ces hommes qui avaient
si vaillamment combattu pour elle se rebellent et détruisent
la ville. Les statues des anciens dieux sont renversées,
leurs temples pillés; les chrétiens sont délivrés
et leur religion rétablie.
Marcus Tullius retrouve Julia mourante; elle reconnait ses erreurs
et expire chrétienne. C'est une nouvelle bacchanale qui
commence - celle de la destruction : Rome brûle et, bientôt,
n'est plus que cendres.
1945. Des siècles se sont écoulés.
Le savoir humain s'est accru - mais la Connaissance n'a fait qu'élever
le niveau de la bassesse humaine, de la vulgarité et de
la corruption, de la cruauté. L'égoïsme, la
cupidité pousse les hommes à s'entre-déchirer.
La force triomphe, la guerre éclate. Et à nouveau
s'impose l'image de l'Apocalypse de saint Jean et de ses tragiques
cavaliers. Une nouvelle ère de malheur commence cependant
que se profile la bombe atomique.
| 
|
CRITIQUES
Scotese, «après avoir dépeint en couleurs
sombres la civilisation moderne en marche vers l'autodestruction,...
évoquait la tentative de restauration païenne de Julien
l'Apostat, la mort de l'Empereur, les révoltes et les invasions
des barbares, la décadence de l'Empire romain.»
|
V. SPINAZZOLA, Cinéma 64, ní 85,
p. 62
|
| |
| ANALYSE
Les prédictions apocalyptiques ont de tout temps fasciné
les hommes. Souvent perçu comme cet Antéchrist dont
la venue avait été annoncée par le Livre
de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, Julien l'Apostat
en voulant rétablir le culte des dieux pour faire échec
au christianisme prélude à la chute de l'Empire
romain. De la chute de celui-ci à l'ère moderne,
avec la Seconde guerre mondiale et les menaces atomiques... que
de catastrophes se sont succédées. La science et
l'intelligence humaine matérialistes ne risquent-elles
pas de causer définitivement la destruction de l'humanité
?
Etonnante dénonciation d'une certaine «science
sans conscience», juste après Hiroshima. Hélas,
l'histoire est fort malmenée. Si Julien prit des mesures
contre les chrétiens, il le fit avec modération,
sans bourreaux ni geôliers comme le rappelle Eutrope, qui
avait accompagné Julien dans l'expédition contre
les Perses. Après son expédition en Mésopotamie
où il trouva la mort, ses troupes ne pillèrent pas
Rome. Une certaine image sulpicienne de mauvais aloi préside
à cette peinture de l'Apostat, de la même veine que
ces visions sulfureuses et démoniaques, pleines de jeunes
vierges égorgées sur l'autel des dieux de Rome que
l'on peut voir dans la littérature «édifiante»
(cf. par exemple, L. LE LEU, Le triomphe de la Croix.
Les fastes de l'Eglise, Casterman, 1912, p. 67 et ill. p.
161).
|
| |
Bio-Filmographie
de Giuseppe Maria Scotese
(26 janvier 1916, Acquario (Monte Prandone, Italie) - Rome,
19 mai 2002)
Réalisateur, scénariste et producteur
Né dans la province d'Ascoli Piceno, dans les Marches,
le 26 janvier 1916, il vient à Rome, encore tout jeune,
avec l'intention de devenir peintre. Il était en train
de se faire connaître parmi les jeunes de la via Margutta
quand il changea d'idée, se passionna pour le cinéma
et s'inscrivit au Centre Expérimental pour y suivre les
cours de mise en scène. Il produisit d'abord quantité
de documentaires. Et en 1941, il publia un ouvrage Introduction
au cinéma qui fut apprécié pour la clarté
de ses idées et qui fait partie aujourd'hui encore de toutes
les bibliothèques spécialisées. Il devint
metteur en scène tout de suite après la guerre avec
Il Sole di Montecassino et Il modelle di via Margutta
réalisés tous deux en 1945 dans les conditions difficiles,
puisque les studios étaient détruits et le matériel
technique introuvable. Il dirigea ensuite plusieurs films de tous
genres parmi lesquels l'intéressant Carmen proibita,
transposition moderne de la nouvelle de Mérimée,
réalisée presque entièrement en Espagne.
Ces deux dernières années, il semble s'être
orienté vers les films d'aventures à grand spectacle
et il en a réalisés deux l'un après l'autre.
Il n'arrive pas souvent qu'un peintre abandonne ses pinceaux
et sa palette pour la caméra; Scotese est peut-être
le seul à avoir fait un décalage aussi brusque.
Il était à craindre que son goût décoratif
ne le pousse à soigner dans ses films les valeurs esthétiques
plutôt que le développement de l'action. Mais cela
n'arriva pas et Scotese réussit à se surveiller,
car ses films sont surtout des films d'action. L'ex-peintre réapparaît
quelquefois dans la composition de quelques plans, dans le choix
de quelques extérieurs (ceux de Carmen proibita
sont splendides) : ce film, malgré des déséquilibres
et une actrice peu qualifiée, fut très intéressant
parce qu'il réussit à traduire en termes réalistes
une des plus célèbres histoires romantiques. Auparavant,
Scotese avait déjà essayé de déromantiser
Venise en la présentant sans ses lieux communs de carte
postale, avec une compréhension intelligente de la ville
et de ses habitants, dans Fiamme sulla Laguna. Après
plusieurs expériences et des essais réussis dans
la cinématographie purement commerciale, le metteur en
scène a été attiré par les films d'aventure,
d'action et de fantaisie, et il les réalise en couleurs
avec l'œil du peintre, rare dans ce genre de films. |
Les réalisateurs italiens, Unitalia,
1958, pp. 183-184.
|
| |
|
|
| |
| 1945 |
Saint Bénédicte / Il Sole di Montecassino
- San Benedetto, dominatore dei barbari (biographie)
N&B (réal., scén.). Avec : Fosco Giachetti,
Adriana Benetti, Liliana Laine, Nino Pavese, Alfredo Varelli
- 93'
|
| 1946 (1945 ?) |
Le Modelle di via Margutta (drame) N&B (réal.,
hist., scén.). Avec : Liliana Laine, Claudio Gora,
Carlo Campanini, Vera Carmi, Wanda Capodaglio, Fausto
Guerzoni - 93'
|
| 1947 (1946 ? 1948 ?) |
L'Apocalypse (L'Apocalisse) (péplum)
N&B (réal., scén.). Avec : Tullio Carminati,
Massimo Serato, Alfredo Varelli, Lilia Landi, Enrico Glori
- 90'
|
| 1946 (1947 ?) |
La Grande Aurore (La Grande Aurora) (comédie)
N&B (réal., hist., scén.). Avec : Rossano
Brazzi, Renée Faure, Pierino Gamba, Giovanni Grasso,
Loris Gizzi, Fausto Guerzoni - 90'
|
| 1949 (1948 ?) |
Le(s) Pirate(s) de Capri (I Pirati di Capri) (aventure)
N&B, de Giuseppe Maria SCOTESE (réal. [non
crédité dans la version US]) & Edgar
G. ULMER. Avec : Louis Hayward, Binnie Barnes, Mariella
Lotti, Massimo Serato, Eleonora Rossi Drago, Franco Pesce
- 90'
|
| 1951 (1949 ? 1952 ?) |
Alerte à l'Arsenal (Fiamme sulla Laguna - Venezia,
rio dell'Angelo) (drame) N&B (réal., scén.).
Avec : Leonardo Cortese, Luca Cortese, Lauro Gazzolo,
Lea Padovani, Sandro Ruffini - 92'
|
| 1954 (1952 ?) |
Carmen, Fille d'Amour (Carmen Prohibida / Siempre
Carmen) (drame) N&B (réal., hist., scén.).
Avec : Ana Esmeralda, Fausto Tozzi, Mariella Lotti, Umberto
Spadaro - 80'
|
| 1955 |
Les Révoltés / Le Manteau Rouge (Il
Mantello Rosso) (réal., scén.). Avec
: Patricia Medina, Bruce Cabot, Fausto Tozzi, Domenico
Modugno, Lyla Rocco. Avventura, durata 92'
|
| 1957 (1959 ?) |
La Belle et le Corsaire (II Corsaro della Mezzaluna)
(réal., hist., scén.). Avec : John Derek,
Ingeborg Schöner, Gianna Maria Canale, Alberto Farnese
- 90'
|
| 1958 |
El Hombre del Paraguas Blanco (assist. réal.)
|
| 1959 (1960 ?) |
Dans les Griffes des Borgia (La Notte del Grande Assalto)
N&B, de Giuseppe Maria SCOTESE (prod., réal.,
hist., scén.) & Louis DUCHESNE. Avec : Agnès
Laurent, Fausto Tozzi, Kerima, Sergio Fantoni - 92'
|
| 1959 |
Yo y las mujeres (réal.). Avec : Amador
Bendayan, Susana Duijm, Nyta Dover
|
| 1960 (1961 ?) |
Les Amants de la Terre de Feu (Questo Amore del Mondo
ai confini / Questo Amore ai confini del Mondo) (?)
(drame) (réal., scén.). Avec : Antonio Cifariello,
Dominique Wilms [Dominique Williams], Fausto Tozzi, Aegle
Martin - 94' [Italie-Argentine]
|
| 1961 (1960 ?) |
Les Nuits d'Amérique (America di Notte)
(documentaire), de Giuseppe Maria SCOTESE (réal.,
scén.) & Carlos Alberto de SOUZA BARROS. Avec
: Elizeth Cardoso, Ellen de Lima, Lionel Hampton - 117'
|
| 1962 |
Le Dolci Notti (documentaire), de Vinicio MARINUCCI
(SCOTESE : hist., scén.)
|
| 1964 (1963 ?) |
Filles sans Voiles (I Piaceri nel Mondo), de Vinicio
MARINUCCI (SCOTESE : scén.)
|
| 1964 |
Le Città Proibite (documentaire) (prod.,
réal., hist., scén.) - 90'
|
| 1968 (1967 ?) |
Acid - Delirio dei Sensi (drame) (prod., réal.,
scén., adaptation). Avec : Bud Thompson, Bruna
Caruso, Annabella Andreoli, Valentino Macchi - 92'
|
| 1968 |
Il Pane Amaro / Le Vergogne del Mondo (documentaire)
(réal., hist., scén.) - 93'
|
| 1971 |
Il Giorno della Violenza lungo / Il Giorno della lungo
Violenza / Il lungo Giorno della Violenza (?) (réal.,
hist., scén.). Avec : Eduardo Fajardo, George Carvell,
Charo López
|
| 1974 |
I Miracoli Accadono Ancora (drame) (réal.,
scén.). Avec : Susan Penhaligon, Graziella Galvani,
Paul Muller - 94'
|
| 1983 |
Cannibali Domani (documentaire) (réal.,
hist., scén.) - 85'
|
|
|
NOTES :
(1) Michel ÉLOY, «Julien
l'Apostat - Filmographie», in Cahiers des para-littératures,
ní 1, Liège, C.L.P.C.F. / Céfal, Liège,
1989, pp. 91-100. - Retour texte
(2) D'après Vittorio MARTINELLI,
Il cinema muto italiano - Il film del dopoguerra / 1919,
Rome, Bianco e Nero, 1980, XLI, 1/3, pp. 125-129 (traduction
: Nadine SIARRI). - Retour texte
|
|