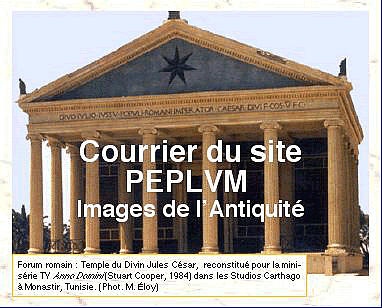|
| |
| 9 avril 2008 |
| LA
VENGEANCE DE LA FORÊT : ARBRES ÉTRANGLEURS,
CANNIBALES ET AUTRES MÉTAMORPHOSES |
| Francois
a écrit : |
| Je recherche
un film mythologique que j'ai vu entre 1960 et 1970 (je
suis né en 52) et qui m'avait marqué à
l'époque par la forêt - ou le marais - dans
laquelle les arbres étaient vivants : les branches
étaient animées et quand le héros
(était-ce Hercule ou un autre ?) en casse une,
du sang se met à couler... |
| |
| |
| RÉPONSE
: |
Des arbres vivants et agressifs
?
Je verrais : Le voleur de Bagdad (CLICK,
CLICK
& CLICK)
(1960 [mais aussi les autres versions d'avant 1960 ou
d'après 1970]) (DVD espagnol chez Impulso),
Les amours
d'Hercule (sort en DVD VF chez René
Chateau fin de ce mois) et Hercule
contre les Vampires (DVD VF chez Opening
depuis l'année passée).
Le voleur de Bagdad
Dans Le voleur de Bagdad (1960), Karim (Steve
Reeves) et ses compagnons partis à la recherche
de la rose bleue, bivouaquent dans une petite forêt,
après avoir franchi la Première porte
du royaume enchanté. Pendant la nuit, les arbres
rampent sur leurs racines et leurs branches se transforment
en tentacules qui cherchent à étrangler
les hommes. Karim les combat avec une torche, réussissant
à enflammer quelques rameaux. A l'aube, la lumière
du jour vient figer l'activité des monstrueux
végétaux qui reprennent leur apparence
normale.
Dans ce film les arbres ne saignent pas mais craignent
le feu et la lumière. Ils rampent sur leurs racines
comme les Ents du Seigneur des Anneaux, lesquels
- eux - sont en outre capables de parler.
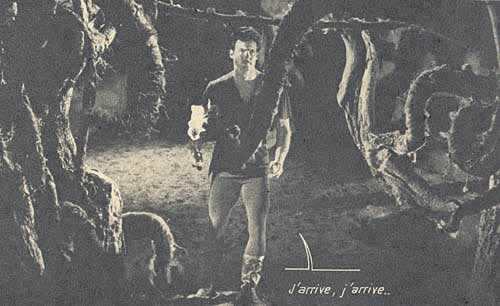 |
Hercule contre les Vampires
Hercule est descendu aux Enfers. Il ne s'agit pas d'un
arbre vivant (animé), mais de sortes de sarments
de vigne, dont Hercule fait une corde pour franchir
un fleuve de lave, le Styx. Il les coupe, donc, du sang
s'écoule et l'on entend un cri de douleur.
Il y a ici un télescopage entre le thème
classique des hommes changés en arbres (voyez
Ovide, Les Métamorphoses) et le fil de
la Destinée que tissent les Parques : lorsqu'elles
coupent le fil, un homme meurt. Hercule remplace ici
allusivement les Parques.
Cependant, il est possible que vous ayez vu cette même
séquence dans un autre film : Le Défi
des Géants. Un film-patchwork bidouillé
avec un tiers d'Hercule à la conquête
de l'Atlantide, un tiers d'Hercule
contre les Vampires, et un tiers original.
Comme ça doit bien faire un peu plus de 35 ans
que je n'ai vu ce dernier film, je ne puis vous garantir
si la séquence y figurait aussi, ou non. Quand
diable, un éditeur DVD aura-t-il la bonne idée
de rééditer Le Défi des Géants,
avec l'excellent Reg Park ? Nom de Zeus !
|

Hercule et Thésée
descendus aux Enfers, trouvent d'étranges
plantations dans le marais d'Achéron (Hercule
contre les Vampires, Mario Bava, 1961) |
Les amours d'Hercule
Dans Les
amours d'Hercule, Hippolyte reine des Amazones
(Jayne Mansfield et ses boîtes à lait !)
métamorphosait en arbres les amants dont elle
était lasse. Errant dans la forêt des amants
maudits à la recherche d'Hercule qui la fuit,
elle est happée au passage par l'un d'eux, qui
se venge en l'étouffant dans ses bras... enfin,
entre ses branches, veux-je dire. Je crois bien qu'il
y a aussi un rameau cassé, d'où coule
du sang.
|
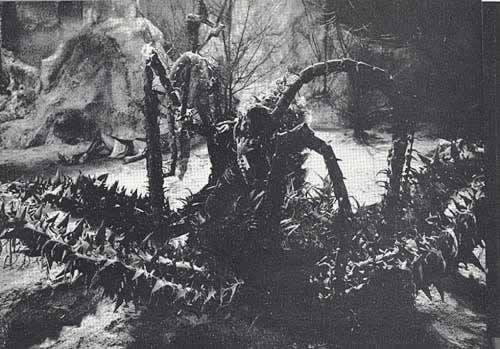
La plante carnivore du Jardin de
Proserpine dans La vengeance du Colosse (Mars,
Dieu de la Guerre) (Marcello Baldi, 1962)
- phot. extr. Midi-Minuit Fantastique,
nÁ 9
|
Hors ça, il doit y avoir des arbres agressifs
ou cannibales dans d'autres films border-line
du péplum qui ne me viennent pas à l'esprit
pour l'instant. Les arbres cannibales ou plantes carnivores
sont une tarte à la crème des romans-BD-films
d'aventures qui se sont complus à grossir les
sarracénies et autres dionées gobe-mouche
(cf. Le monde perdu [Irwin Allen, 1960], ou encore
l'hammerien Peuple des Abîmes [Michael
Carreras, 1968] et ses sargasses envahissantes, pour
ne citer que ces deux là). Justement, c'est à
une sorte de dionée géante que l'on sacrifie
à la déesse Vénus des jeunes vierges,
dans La vengeance du Colosse (Mars, Dieu de la Guerre),
un des rares péplums des Sixties que je
n'ai toujours pas vu, avec Roger Browne dans le rôle
de Mars. Il y a eu une photo de la bête... de
la plante veux-je dire, au milieu du Jardin de Proserpine
dans un Midi-Minuit fantastique, l'introuvable
numéro 9 (j'ai donc reproduit la photo ci-dessus)
! Il faut savoir que dans la mythologie grecque, Vénus-Aphrodite
est fille de Jupiter-Zeus et de... Dioné. C'était
donc tentant de rapprocher dans un film fantastico-mythologique
l'humble Dionée-tue-mouches des botanistes et
la nymphe Dioné, aimée de Zeus et - en
fait - sa parèdre (si vous avez fait du grec,
vous savez que «Dio-» est la forme déclinée
du nominatif «Zeus»), pour imaginer ce pittoresque
culte de la déesse Vénus. Et «pittoresque»
est, en effet, le moins qu'on puisse en dire !
| |
Forêt |
Branche qui saigne |
Tueuses |
Cannibales |
Parole |
| SOUVENIR |
oui |
oui |
- |
- |
- |
| Le Voleur de Bagdad |
oui |
non |
oui |
non |
non |
| Hercule contre les vampires |
non
(Hadès) |
oui |
non |
non |
oui |
| Les amours d'Hercule |
oui |
oui |
oui |
non |
oui |
Voilà, j'espère que ces quelques indications
sauront orienter vos recherches. Comme vous me dites
que c'est un héros du genre Hercule qui était
agressé par l'arbre qui saigne, je serais prêt
à parier qu'il s'agit d'Hercule contre les
Vampires, même si Hercule n'est pas réellement
agressé. Toutefois, ce sont Les amours d'Hercule
qui réunissent le plus de paramètres probants
(forêt, branches animées et qui saignent)
sauf que c'est la reine Hippolyte et non Hercule qui
périt étranglée entre les branches
vengeresses...
La Divine comédie
La description des Enfers dans le film de Mario
Bava, Hercule contre les Vampires (Ercole all'
centro della Terra) emprunte beaucoup à la
vision de son compatriote Dante, La Divine Comédie,
notamment cette vision d'un Enfer monde de flammes et
de démons, qui est une conception chrétienne.
Telle n'était toutefois pas la conception des
Gréco-Romains. Dans le film de Bava, le Styx
est une illusion : feu en apparence, mais eau douce
quand on s'y plonge.
Mais il ne faut pas être Prix Nobel pour identifier/rectifier
celui que le film nomme le «Styx» : il s'agit
du Phlégéthon ou Pyriphlégéton,
le fleuve de feu qui coule aux Enfers, affluent du Styx.
Les Anciens ne nous décrivent jamais le Styx
comme un fleuve de feu, mais plutôt comme une
eau incorruptible (chez les Grecs) ou fangeuse (chez
les Romains, ces invertis qui ne font jamais rien comme
les Grecs, Hi Hi Hi !).
|
Gauche. Accusé
de félonie, Pierre Desvignes, chancelier
de l'empereur Frédéric II Hohenstauffen,
est placé aux Enfers par Dante et métamorphosé
en arbre qui saigne lorsqu'on lui rompt un rameau.
Droite. Dans la conception chrétienne,
les cercles des Enfers sont dominés par
les flammes, les fours, les brasiers. Bava s'en
est souvenu (et peut-être aussi du Voyage
au centre de la Terre de Jules Verne, pour
imaginer ses fantasmagories. Mais dans les neuf
cercles du Styx de la mythologie grecque, il n'en
était pas question. Dans la conception
grecque, les Enfers sont un lieu froid et sombre,
du moins de Tartare, lieu de relégation
des méchants. Séjour des justes,
les Champs-Elyséens, avec leurs prairies
d'asphodèles, semblent plus avenants...
|
Dans son poème eschatologique, Dante place aux
Enfers des damnés qui - comme Pierre Desvignes
- ont trahi leur maître : «Les feuilles
n'avaient pas la couleur de la verdure ordinaire, mais
une sorte de couleur noirâtre. Les rameaux étaient
noueux et embarrassés, privés de fruits,
souillés d'épines et de substances vénéneuses.
(...) J'avançai la main, et je rompis un rameau
d'un grand arbre. Le tronc cria sur-le-champ : «Pourquoi
me déchires-tu ?» En même temps
un sang noir coula le long de l'écorce, et le
tronc recommença ainsi : «Pourquoi
me blesses-tu ? n'as-tu aucun sentiment de pitié
? Nous fûmes des hommes, nous sommes aujourd'hui
des troncs animés. Ta main devrait encore nous
respecter, quand même nos âmes eussent été
celles de vils reptiles.» De même qu'un
rameau vert présenté à la flamme
fait entendre, par le côté opposé,
le bruit de l'air qui s'en dégage, de même,
de ce tronc sortaient à la fois du sang et des
paroles, et, dans un mouvement de crainte, je laissai
tomber la branche que j'avais rompue» (L'Enfer,
XIII - trad. Artaud de Montor).
Dryope
Ces damnés ont été changés
en arbres. Cependant, dans la mythologie grecque, ce
n'est pas aux Enfers mais dans notre monde de tous les
jours que nous risquons de rencontrer des arbres ou
autres végétaux qui naguère furent
des êtres humains. La plupart du temps, ils l'ont
été en divine punition, à moins
que ce ne fusse par compassion : la nymphe Daphné
fut changée en laurier par le dieu Apollon à
qui elle se refusait; pleurant des larmes d'ambre leur
frère Phaéton, les Héliades furent
métamorphosées en peupliers; et l'aimé
d'Apollon, Cyparissus, devint cyprès, et l'incestueuse
Myrrha myrte.
De même Dryope fut métamorphosée
en chêne en punition d'avoir blessé la
nymphe Lotis elle-même changée en lotos
(nénuphar). Les Dryades ou Nymphes des chênes
tirent d'elle leur nom et Thomas Burnett Swann fera
de celles-ci les héroïnes de son Cycle
du Latium. Jeune maman voulant amuser son bébé,
la princesse d'Œchalie Dryope cueillit pour lui
une fleur «couleur de pourpre tyrienne, (...)
un lotus ami de l'eau. (...) La vérité
était, comme, comme les paysans trop tard nous
l'apprennent enfin, que la nymphe Lotis, fuyant l'insistance
obscène de Priape, s'était métamorphosée
en cet arbre, tout en conservant son nom.»
Alors, sous les yeux de son époux, «ses
pieds [ceux de Dryope] restèrent fixés
au sol par une racine. Elle fait tous ses efforts pour
s'en détacher, mais ne peut mouvoir que le haut
du corps. Par le bas pousse l'écorce qui, peu
à peu, la recouvre entièrement d'une flexible
enveloppe jusqu'aux aines. Quand elle s'en aperçut,
elle s'efforça, de sa main, de s'arracher les
cheveux, mais n'emplit cette main que de feuilles»
(OVIDE, Métamorphoses, IX, 331-342 - trad.
J. Chamonard).
|
.Pour avoir cueilli
un lotus habité par une nymphe, Dryope
est transformée en chêne sous les
yeux de son mari Andræmon et de son bébé
Amphissos. Gravure de Peter van der Borcht.
Pleurant leur frère, les sœurs de
Phaéton sont métamorphosées
en peupliers. Doc. Bibliothèque nationale,
Paris. Extr. M. GRANT & J. HAZEL, Who's
who de la Mythologie, Seghers, 1975 |
Dans la tragédie de Shakespeare
Titus Andronicus, Lavinia, fille de Titus, est
violée par les ennemis son père, ses deux
mains sont coupées ainsi que sa langue afin qu'elle
ne puisse révéler ni son déshonneur
ni le nom des coupables. La scène se passe dans
la forêt : survient son oncle Marcus, qui la découvre
toute ensanglantée : «Parle, gentille
nièce, quelles mains atrocement cruelles t'ont
mutilées et dépecées ? Quelles
mains ont dépouillé ton corps de ses deux
branches, de ces douces guirlandes, dans le cercle ombré
desquelles des rois ont ambitionné de dormir,»
etc. (acte II, sc. 4). Immédiatement, Marcus
comprend qu'il est arrivé à sa nièce
la même chose qu'à Philomèle et
sa sœur Procné, violées et réduites
au silence par le mari de la première. Plus tard
(acte IV, sc. 1), en désignant l'épisode
de Procné et Philomèle dans un exemplaire
des Métamorphose d'Ovide, trouvé
dans la bibliothèque paternelle, Lavinia fera
comprendre à Titus ce qui est arrivé.
Julie Taymor, qui porta à l'écran cette
tragédie gore, utilisera comme métaphore
l'épisode de Daphné, tiré du même
Ovide : après l'avoir outragée, Démétrius
et Chiron, les fils de Tamora, s'enfuient, laissant
leur victime juchée sur une souche d'arbre dont
elle semble être le prolongement; des poignets
sectionnés de Lavinia sortent déjà
de sombres rameaux. A moins d'avoir ajouté au
grand guignol shakespearien quelque supplice bantou
qui n'y figurait point, le corps mutilé de Lavinia
paraît être en train de se changer en arbre.
S'y prête le décor boueux d'une clairière
peuplée d'arbres dépouillés par
l'hiver, silhouettes noirâtres et ricanantes...
(De fait, dans la mythologie, on
ne se métamorphose pas qu'en végétaux
: Arachné est transformée en araignée,
Philomèle en rossignol; les compagnons d'Ulysse
en porcs; les victimes de la Méduse en statues
de pierre. Ovide en cite d'autres : le bouvier Battus
en rocher (Mét., II, 676-707), Atlas en
montagne (Mét., IV, 604-662). Il faut
citer ici une curieuse séquence d'un autre péplum,
Hercule à la conquête de l'Atlantide
de Cottafavi : la princesse Ismène est sacrifiée
à Protée, dont les brumes dissimulent
l'Atlantide aux yeux des navigateurs importuns. Protée,
dans le film, est le dieu d'une île-vampire dont
les victimes s'incorporent à la falaise. Le corps
d'Ismène est en train de se minéraliser
lorsqu'arrive Hercule qui tue le dieu aux nombreuses
métamorphoses. Alors le fils de Zeus détache
la jeune fille de la parois où elle laisse autant
de marques sanglantes, empreintes de son corps... Très
belle séquence.)
Polydore et le cornouiller
Le prince troyen Polydore, assassiné, se perpétua
à travers un cornouiller. Virgile nous conte,
en effet, que débarqué sur le rivage de
la Thrace, Enée voulut offrir un sacrifice aux
dieux et leur élever un autel. «Il y
avait, par hasard, tout près un tertre et, sur
le sommet, un cornouiller et un myrte dru hérissé
de tiges comme des hampes. Je m'en approchai, et, lorsque
j'essayai d'arracher du sol ces branches vertes pour
couvrir l'autel de rameaux feuillus, je vis un incroyable,
un horrible prodige. La première branche que
j'arrache en brisant ses racines laisse égoutter
un sang noir et corrompu qui souille la terre. Une froide
horreur secoue mes membres, et, d'épouvante,
mon sang se fige, glacé. Je recommence; je veux
arracher une autre branche flexible et pénétrer
les causes de ce mystère. Un sang noir s'échappe
encore de cette autre écorce. L'âme bouleversée,
je suppliais les Nymphes agrestes et le vénérable
Mars Gradivus, qui protège les champs des Gètes,
de rendre, comme ils le peuvent, ce prodige favorable
et d'en conjurer la signification. Mais lorsqu'une troisième
fois, d'un plus grand effort, je m'attaquai aux tiges
de l'arbrisseau, agenouillé et luttant contre
le sol - faut-il le dire ou le taire ? - j'entendis
des entrailles du tertre un gémissement lamentable,
et une voix monta vers moi : «Enée,
pourquoi déchirer un malheureux ? Cesse; épargne
un homme enterré; garde tes mains pieuses d'un
sacrilège. Troyen, je ne suis pas un étranger
pour toi, et ce sang ne coule pas du bois d'un arbre.
Hélas, fuis ces terres cruelles; fuis ce rivage
de l'avarice. C'est moi Polydore : la moisson de fer,
dont les traits ici même m'ont percé et
recouvert, a pris racine et grandit en javelots aigus.»
Et moi, j'étais là, hésitant
d'effroi, frappé de stupeur, les cheveux hérissés,
la voix arrêtée dans la gorge»
(VIRGILE, Enéide, III, 19 - trad. André
Bellessort).
Ce Polydore était le plus jeune des fils de
Priam. En prévision de la guerre, son père
l'avait mis en sécurité auprès
de son allié, le roi thrace Polymestor. Mais
celui-ci, auri sacra fames, massacra son hôte
pour s'emparer de ses richesses et abandonna son corps
percé de lances en bois de cornouiller, lesquelles
fichées dans la chair du jeune homme, nourries
de son sang reprirent vie.
Lucien de Samosate
Dans la tradition gréco-romaine, les humains
changés en arbres sont somme toutes débonnaires
avec nous, pauvres mortels. Bien sûr, les arbres
se vengent parfois en nous faisant partager leur sort,
comme ce fut le cas de Dryope. Le philosophe grec Lucien
s'en amuse. Dans son petit roman L'Histoire vraie,
Lucien de Samosate s'amuse à parodier les récits
de voyages merveilleux aux confins du monde. Les voyageurs
découvrent ainsi «une espèce
de vigne tout à fait merveilleuse. La partie
qui sortait du sol, le tronc même était
un gros cep d'une belle venue; le haut était
une femme dont tout le corps à partir de la ceinture
était d'une beauté parfaite. C'est ainsi
que nos peintres représentent Daphné métamorphosée
en arbre à l'instant où Apollon va l'atteindre.
Les rameaux sortaient de l'extrémité de
leurs doigts et ils étaient remplis de raisins.
Leurs têtes, au lieu de cheveux, étaient
couvertes de vrilles, de feuilles, de grappes. Quand
nous nous sommes approchés d'elles, elles nous
saluèrent, nous tendirent la main et nous parlèrent,
les unes en lydien, les autres en indien, la plupart
en grec. Elles nous baisaient sur la bouche et celui
qui avait reçu leur baiser devenait ivre sur-le-champ
et chancelait. Mais elles ne permettaient pas que l'on
cueillît leurs fruits et criaient de douleur,
si on les arrachait. Certaines d'entre elles avaient
grande envie de s'unir à nous. Deux de nos compagnons,
s'étant approchés d'elles, ne purent s'en
détacher et restèrent liés par
leurs parties sexuelles; ils se fondirent avec elles
et poussèrent des racines avec elles; en un instant
leurs doigts furent changés en rameaux et enlacés
dans des vrilles et ils étaient sur le point,
eux aussi, de porter des fruits» (LUCIEN,
Hist. vraie, I, 8 - trad. Emile Chambry).
Les arbres anthropophages
Chez Lucien, donc, le monde végétal est
capable d'agresser les humains : les compagnons de Lucien
qui s'unissent sexuellement aux femmes-vignes s'incorporent
à elles, sont perdus pour notre monde. Chez Ovide,
Dryope qui en a blessé une, partagera désormais
leur sort. Nous sommes encore assez loin des arbres
agressifs dont traite le cinéma SF ou fantastique,
dont des différentes versions du Voleur de
Bagdad : arbres étrangleurs voire carnivores.
Différents voyageurs - plus ou moins sérieux
- en ont pourtant signalé l'existence. Le premier
à en avoir parlé fut semble-t-il, en 1581,
un certain capitaine Arkright, qui situe dans l'atoll
d'El Bannor (Pacifique Sud) une plante aux couleurs
vives, dont le parfum capiteux étourdit l'homme
qui, l'ayant respiré, tombe entre les pétales
qui se referment sur lui.
Ensuite ce fut le botaniste allemand Carl Liche qui
assista, en 1868, chez les Mkodos - dans le S.-E. de
Madagascar - au sacrifice annuel d'une jeune fille livrée
par ses congénères à la voracité
d'un arbre cannibale, lequel était ensuite brûlé,
d'où sa raréfaction.
En 1882, un planteur américain W.C. Bryant
raconta avoir failli être dévoré
par un arbre haut de douze mètres à Mindanao
(Philippines).
En 1913, au Nicaragua, un chasseur américain
nommé Dunstan arracha son chien aux lianes-tentacules
d'un curieux végétal. L'animal portait
des marques de ventouses sur tout le corps (!). Plus
proche de nous - dans les années '40-'50 ? -,
l'explorateur brésilien Mariano da Silva vit
chez les indiens Xatapu, à la frontière
guyano-brésilienne, un petit singe avalé
par des mâchoires végétales dentelée
(du genre Dionée), dont le squelette parfaitement
nettoyé fut régurgité trois jours
plus tard...
Certaines de ces descriptions peuvent être mises
en relation avec des espèce insectivores bien
connues comme la Droséra (la variété
la plus grande, en Australie, mesure trente centimètres
en hauteur); la Dionée ou Vénus-attrape-Mouche
(qui peut même avaler de petites grenouilles);
l'algue utriculaire qui s'attaque aux insectes aquatiques
et à de minuscules poissons; ou encore les Sarracénies
ou «plantes-estomacs» dont le calice peut
mesurer jusqu'à soixante-dix centimètres
de profondeur, sur trente de largeur... La plus grande
de cette dernière espèce, le Népenthès
Rajah, était capable - selon le chasseur français
Max Dervaux qui l'observa à Bornéo, en
1902 - d'avaler de petits écureuils ou des oiseaux.
|
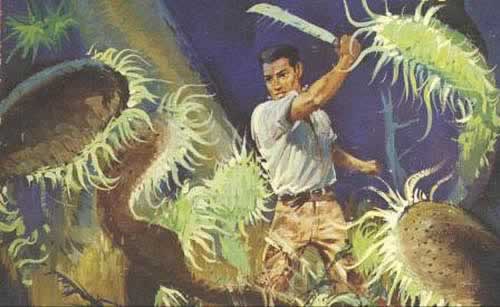
Bob Morane affronte
à la machette les Dionées cannibales
de l'Amazonie centrale particulièrement
agressives : peinture de Dino Attanasio (cv. [détail]
de la BD Henri VERNES (sc.), Dino ATTANASIO (d.),
Bob Morane et La Terreur Verte, Marabout,
1963) (prépubl. in Femmes d'aujourd'hui,
août 1960-févr. 1961).
Dans son livre A la recherche du Monde Perdu,
Ray Stevens (plus connu, depuis, sous le nom de
Henri Vernes) a consacré tout un chapitre
aux plantes cannibales : «Quand les plantes
dévorent les hommes» (1)
|
NOTE :
(1)
Ce texte parut d'abord sous forme d'article : Charles
Henri DEWISME, «La vérité sur
les plantes carnivores», in Secrets du Monde,
nÁ 14 (2e an.), février 1952; Star Ciné-Cosmos,
nÁs 79-80-81, octobre 1964; Henri VERNES, L'orchidée
noire (Marabout chercheur Bob Morane), Marabout
Junior, 1958. Repris in Ray STEVENS, A la recherche
du Monde perdu (Mumbo-Jumbo), Paris, André
Bonne, coll. «Records», 1954; rééd.
Henri VERNES, A la recherche du Monde Perdu (Les
origines de Bob Morane/1), Bruxelles, Ananké,
2004. - Retour texte
|
| |
| |
|
|

|
|
| |
| 19 avril 2008 |
| PÉPLUM
GRATOS : THE GREAT COMMANDMENT (1939) |
| Georges
a écrit : |
| Sur
le site www.archive.org
il y a des films tombés dans le domaine public,
dont The Great Commandment d'Irving Pichel (1939).
Tu connais ? Une histoire de zélotes et de Romains
à l'époque du Christ et sur la conversion
de Longinus... Tu peux les visionner ou les charger gratos. |
| |
| |
|
|

|
|
| |
| 14 mai 2008 |
| PETITE
SOIRÉE POMPÉIENNE... |
| Cathy
a écrit : |
J'aimerais
acquérir le film documentaire en français
Les derniers jours de Pompéi et éventuellement
toutes les explications qui vont avec. Je vais organiser
une soirée pour mes amies le 11 juin prochain.
Est-ce possible et combien m'en coûtera-t-il, expédition
comprise ? |
| |
| |
| RÉPONSE
: |
Je suppose que vous voulez
parler du docu-fiction de 2003, Le dernier jour de
Pompéi ? Vous trouverez toutes les explications
historiques utiles ici : CLICK.
A noter qu'on trouve aussi en DVD des versions «fiction»
de 1935 (Schoedsack), 1948
(Marcel L'Herbier), et 1960
(Mario Bonnard - Sergio Leone)...
Il existe même, également, Les
derniers jours d'Herculanum dans la collection
Fabbri, mais ils ne vendent qu'en France Métropolitaine
(existe en espagnol chez Impulso
Records).
Quand à l'acquisition de ces DVD, qui se trouvent
(ou se sont trouvés) dans le commerce, j'ai le
regret de vous rappeler que je ne fais aucun business,
ni échanges, ni copies. Juste de l'exégèse
et de l'information (CLICK).
Voyez donc avec votre dealer habituel. Mon
conseil : tapez amazon.fr
(vente) ou dvdfr.com
(professionnel) et sélectionnez la catégorie
«péplum», et vous verrez ce qui existe
sur le marché. |
| |
| |
|
|

|
|
| |
| 2 juin 2008 |
| ALEXANDER
THE GREAT DE PANAYOTI KAROUSOS, À L'OPÉRA
À NEW YORK ! |
| Peter
Karoussos a écrit : |
Please
include at your web site the marvelus opera of Greek-Canadian
composer Panayoti Karousos'. The opera presented in
french in Montreal Canada and in english in Chicago
USA with big success. Here the info : CLICK
& CLICK.
| 
Giorgos Orfanos congratule le compositeur
Panayotis Karousos |
Ryan Gintoft [tenor] : Alexandre
Francesca Lunghi [mezzo] : Olympias
Michael Brown [baryton] : Philippe
Benjamin Leclaire [basse] : Aristote
Kevin Siembor [tenor] : Hephæstion
Kristina Pappademos [alto] : Sisygambis
Greer Brown [soprano] : Cléopâtre, Roxane
Orchestre conduit par David Stech.
Sur ce site :
|
| |
| |
|
|

|
|
| |
| 6 juin 2008 |
| L'EMPIRE
DES CONTRESENS |
| Georges
a écrit : |
| Je viens
de trouver un double DVD Empire. J'avais essayé
de suivre la mini-série sur M6, mais mon M6 marche
tellement mal que ce qui en sortait était inexploitable
et ce me semblait très loin du «top»
de Rome. Là, bien que double DVD avec VO
& VF, je crois que je me suis fait avoir (pas pécuniairement
: 10 EUR) mais, d'après ton étude sur le
site,
il me semble que ce soit un raccourci de la série
: 4 épisodes de 40' au lieu de 6 de 60'... La fin
est la même que ce que tu décris donc ils
ont taillé dedans... et je déteste ça
! Je râle déjà sur les films raccourcis
de quelques minutes, alors une telle amputation ! |
| |
| |
| RÉPONSE
: |
En ce qui concerne Empire,
je n'ai rien pigé à la diffusion DVD.
Tu n'es pas le seul à t'en plaindre. Un autre
de mes correspondants semble avoir eu le même
problème que toi : un coffret de quatre épisodes,
donc incomplet. Moi, j'ai acheté un coffret rassemblant
trois DVD séparés, et possède donc
les six épisodes. Je ne les ai pas encore regardés,
ayant à l'époque travaillé à
partir de la VF enregistrée sur la TV M6 (ainsi
que les DVD néerlandais). Tu dis, donc, qu'il
s'agit d'épisodes de 40' au lieu des 60' que
j'ai annoncés ? Faudrait s'entendre sur ce qu'il
faut comprendre, en langage de programmation télévisuelle
: 60' c'est, le plus souvent, 50' de film + 10' de pub
et autres cornichonneries).
Va donc voir la page M6 sur dvdfr.com
et tu constateras qu'ils ont bizarrement modulé
la diffusion de la série. Ce que tu possèdes,
à mon avis, c'est tout simplement les deux premiers
DVD, il te manque donc le troisième. Mais il
n'y a rien de coupé/raccourci.
(...)
La différence entre 60' ou 40' par épisode
doit s'expliquer par le fait que, compilant diverses
sources, j'en aie étourdiment intégré
une arrondissant abusivement les épisodes à
60'. D'ailleurs, si tu examines bien ma fiche, tu verras
que j'indique que le DVD VO st/NL - que je possédais
alors pour établir mon dossier - indique une
durée totale avoisinant les 250'; si tu divises
par 6 épisodes, tu obtiendras env. 40' par épisode.
Donc la durée serait OK.
Reste que tu n'es pas le premier à me dire
qu'il a acheté une série incomplète,
ne contenant que les quatre premiers épisodes
en deux disques.
Tyrannus quitte deux fois Rome pour aller à Chypre
: la première fois à la fin du 4e épisode
(parce qu'Octave l'a «remercié»),
la seconde fois à la fin du 6e (parce que l'aventure
est finie). A mon avis, il te suffirait de te mettre
en quête du volume III, qui est vendu séparément
tout comme le I et le II, du reste, et tu aurais ainsi
la série complète. Mais quelle idée
incongrue, chez M6, de proposer sous un coffret la série...
incomplète. C'est d'autant plus désobligeant
que l'adresse e-mail de ces frileux est quasiment introuvable
sur le Net ! «Il y a plus de choses en ce monde,
Horatio, que ne peut en concevoir ta philosophie !»
Description sur DVDfr :
Empire - 2005
Série / Drame, Mini-series / Feuilletons / M6
Vidéo / Réalisateur : John Gray / Sorti
le 8 novembre 2006 / Acteur principal : Santiago Cabrera
Empire - Volume I - 2005
Série / Drame, Mini-series / Feuilletons / M6
Vidéo / Réalisateur : John Gray / Annoncé
Date non communiquée / Acteur principal : Santiago
Cabrera
Empire - Volume II - 2005
Série / Drame, Mini-series / Feuilletons / M6
Vidéo / Réalisateur : John Gray / Annoncé
Date non communiquée / Acteur principal : Santiago
Cabrera
Empire - Volume III - 2005
Série / Drame, Mini-series / Feuilletons / M6
Vidéo / Réalisateur : John Gray / Annoncé
Date non communiquée / Acteur principal : Santiago
Cabrera
|
| |
| |
|
|

|
|
| |
| 8 juin 2008 |
| RESONABILIS
ECHO (CLAUDE AUBERT, CH - 2009) |
| Claude
Aubert a écrit : |
| Au soir
du quatrième jour important de tournage de Resonabilis
Echo (et au risque de doublonner avec des envois précédents
- cf. La
12e HEURE), il me semble intéressant de
vous envoyer en pièces attachées un petit
florilège de nos photos de tournage. Je n'ai que
l'embarras du choix, tant sont nombreuses les vues splendides
que nous avons prises jusqu'à maintenant. |
| |
| |
| RÉPONSE
: |
Les décors agrestes
sont superbes (en particulier la cascade). Juste un
bémol pour les robes des trois nymphes.
Les robes antiques étaient des espèces
de sacs qui se galbaient sur le corps au moyen d'un
système de rubans. Mais on ne fait pas toujours
ce qu'on veut, j'imagine. Le choix d'étoffes
«qui tombent bien» est aussi très
important. Quand je vois ce qui se portait au temps
du cinéma muet... on est très loin des
tenues seyantes et sexy des Golden Sixties, qui
elles-mêmes prenaient des libertés avec
nos sources iconographiques. Ah, les drapés des
frises du Parthénon ! Et la «Diane chasseresse»
dite de Versailles !
Toutes mes félicitations et encouragements
pour cette initiative qui prolonge les Amours d'Astrée
et de Céladon. Le film sera-t-il sonore ou
muet ? Court-métrage ?
En Belgique, on avait eu dans les années 80'
un certain Guy Licoppe (U.L.B.) et son association Mélissa,
qui avaient tourné en latin une adaptation du
Rudens (1983) de Plaute.
|
| |
| |
| |
| CLAUDE
RÉÉCRIT : |
Un
sujet mythologique prête à beaucoup de
liberté pour les costumes : entre les représentations
des vases grecs, des frises du Parthénon, des
fresques pompéiennes, des sculptures romaines,
du classicisme et du romantisme français, des
divers péplums et j'en passe, l'imagination a
champ libre pour des créations lumineuses ou
ternes, fantaisistes ou réalistes. En voyage
archéologique en Algérie en mars, j'ai
pu constater que les représentations de nymphes
sur les mosaïques romaines passaient allègrement
de costumes très prudes de matrones romaines
quasi préislamiques à une nudité
presque totale que ne cachaient nullement des voiles
transparents flottant largement au vent. Si un sujet
historique suppose un grand respect des costumes, nous
revendiquons face à un sujet mythologique cette
liberté que bien d'autres se sont arrogée
avant nous et ont interprétée de multiples
façons.
Par contre, le scénario
de notre film respectera au mieux (tout en étant
une interprétation filmique) un texte du poète
Ovide, et sera dans un registre très différent
des Amours d'Astrée et de Céladon,
qui ne puise pas son inspiration dans l'Antiquité,
mais dans l'interprétation qu'Honoré d'Urfé
en a faite au début du dix-septième siècle.
Seule la tonalité «pastorale» sera
commune avec l'œuvre d'Eric Rohmer.
Il est un peu tôt pour
en dévoiler plus sur ce moyen métrage,
dont nous espérons finir la postproduction en
mars 2009.
| RESONABILIS
ECHO
un film de Claude Aubert
Visionnez la bande-annonce
: CLICK
Commandez le DVD : CLICK
|
|
| |
| |
|
|

|
|
| |
| 3 juin 2008 |
| DÉFENSE
ET ILLUSTRATION DU CINÉMA HISTORICO-MYTHOLOGIQUE |
| Erwan
a écrit : |
J'ai
toujours privilégié un plaidoyer pour
le péplum et le film en costume et à reconstitutions,
en insistant sur l'instrumentalisation du passé
par le présent, l'image du passé au présent,
les mensonges des arts populaires, dont le cinéma
& TV, par rapport à ceux (non moins énormes)
de l'Histoire, e.a. D'autres exégètes
préféreront sans doute, hélas,
montrer plutôt le côté risible d'un
DeMille et des péplums fauchés, ce qui
est facile. Sans doute, à leur manière,
aiment-ils beaucoup le genre - pas de doute - mais c'est
un peu un amour de potache. Alors qu'il y aurait quand
même mieux à faire et à dire que
de simplement se moquer des stéréotypes
et des trucs bâclés.
(...) Quel numéro de
trapèze d'essayer de combiner les points de vue
du cinéphile, de l'historien, du conteur et du
passionné de films historiques, mais il n'y a
pas de raisons pour que ce ne soit pas possible. Certains
exégètes présentent le péplum
à une audience lambda, qui n'en sait pas grand
chose (une litote), en mettant en avant non les erreurs
historiques (ce qui serait légitime, voire intéressant),
mais les égarements de goût, le kitsch,
les idioties, afin de faire rigoler les intellos. A
trop insister sur les ridicules, j'estime qu'on défend
bien mal ce qu'on aime. J'ai toujours préféré
démontrer aux gens qu'ils avaient des idées
toutes faites, des parti-pris, et que le péplum
- toute question d'esthétique mise à part
- recelait des aspects passionnants, qui méritaient
le détour, même (et surtout) pour des gens
intelligents.
|
| |
| |
| RÉPONSE
: |
Quand on est historien
(les archéologues et les philologues sont généralement
plus indulgents), il est difficile de ne pas épingler
les errements du péplum. C'est un travers personnel
contre lequel je dois moi-même lutter. Vous n'imaginerez
jamais le bonheur que ce fut pour moi de travailler
sur la série Rome
(HBO) : enfin un truc intelligent. Bien sûr,
j'essaie de voir plus loin, et je crois que j'y ai réussi
particulièrement à propos de 300.
Le regard du cinéphile est, évidemment,
plus pur. Il ne se soucie pas de savoir si la fibule
de l'imperator est plus toltèque que romaine,
ou si réellement les riches romains s'essuyaient
les doigts dans la chevelure des jeunes échansons,
cliché dont nous sommes redevables, pourtant,
à un grand historien (Jérôme Carcopino).
Le cinéma crée sa propre vérité.
Et le regard cinéphilique se moque de la référence
historique, ne voyant ici que la manifestation du déni
de la dignité humaine, qu'il transpose de l'Antiquité
dans son époque à lui.
A l'opposé de la vision cohérente du
cinéphile, la mienne est quelque peu schizophène.
|
| |
| |
|
|

|
|
| |
| 9 juin 2008 |
| «IL
N'Y AURA PLUS JAMAIS DE MASADA (1)» |
| Satya
a écrit : |
| Je reviens
d'Israël où j'ai longuement visité
Masada. Comment dois-je faire pour me procurer la version
cinématographique ou autre version de cet emblématique
endroit ? |
| |
| |
| RÉPONSE
: |
Je ne sache pas qu'il existe
une version VF DVD/VHS du film de cinéma Les
Antagonistes (Masada) (env. 2h), mais il semble
qu'on ait enfin sorti en VO aux USA un DVD de la version
TV (plus intéressante, puisqu'elle fait le triple
en durée). Elle était en vente sur Amazon.com.
Voyez ici, mon courrier de janvier
2008.
Evidemment, cette édition est en VO et ne comporte
pas de VF; et il n'y a pas non plus de sous-titrage
en français, pour autant que je sache.
Hors ça, j'ai énuméré
dans ma biblio - si j'ai bonne mémoire - l'ouvrage
incontournable de Ygaël Yadin, le fouilleur de
Masada, et les romans de Guy Rachet (un bon vulgarisateur
archéologique, passé au roman historique)
chez Lattès, et Ernst K. Gann (chez Stock; en
poche chez J'ai Lu), Duel à Masada / Les Antagonistes
dont le film a été tiré.
Il existe aussi une BD française : Claude MOLITERNI
(sc.) & Jean-Marie RUFFIEUX (d.), Massada (Flavius
Josèphe, Juif et citoyen romain - La première
guerre des Juifs contre les Romains), Dargaud, coll.
«Histoire», avril 1988, 42 pl. (60 p.).
Avec une préface de Pierre Vidal-Naquet.
N'oublions pas, non plus, le superbe «Pilotorama»
de J.L. DEVAUX, «Masada», Pilote,
nÁ 481 (11e an.), 23.01.1969.
Voilà, j'espère que ces pistes vous aideront
à revivre votre voyage. Mais dites-moi : est-ce
que les machines de guerre romaines utilisées
dans le film, et abandonnées sur le site pour
l'étonnement des touristes, sont encore visibles
?
NOTE :
(1)
Serment des paras israéliens. - Retour
texte
|
| |
| |
|
|

|
|
| |
| 18 juin 2008 |
| JEUNES
TALENTS : KRISTINA PARIS, BETTINA PARIS, GINA NALAMLIENG
ET JOSEPHINE PARIS... |
| RC
a écrit : |
| Je cherche
désespérément des photos des actrices
Kristina Paris, Bettina Paris, Gina Nalamlieng et Josephine
Paris. Si vous avez cela, merci de m'en envoyer... |
| |
| |
| RÉPONSE
: |
Tout de même, votre
demande m'interpellait. J'ai donc été
voir sur IMDb. Les quatre actrices qui ont recueilli
vos faveurs n'ont actuellement qu'un seul et unique
TV-film à leur actif, Helen
of Troy (John Kent Harrison, 2003), et dans
des rôles mineurs : Kristina Paris (Iphigénie),
Bettina Paris (Cassandre, jeune), Gina Nalamlieng (Athéna)
et Josephine Paris (une matrone). Mais je ne possède
aucun document photographique de ce film, seulement
le DVD (vous aurez remarqué qu'il n'y avait aucune
photo dans le dossier qui est sur mon site).
Le mieux pour vous serait de faire des captures d'écran
d'après le DVD, mais je vous avouerais que moi-même
j'ignore comment on procède. Avez vous prospecté
les sites DVD ? |
| |
| |
|
|

|
|
| |
| 17 juin 2008 |
| ANTAR
BEN SHADDAD (1963) : BEN HUR CONTRE LES PIRATES DU
DÉSERT ! |
| Farida
a écrit : |
Je
suis une grande fan du film de Antar
et Abla.
Par contre je cherche depuis
un moment le nom de la chanteuse ou la BO du film afin
de pouvoir profiter pleinement des chants.
Si tu as des infos... ça m'intéresse. |
| |
| |
| RÉPONSE
: |
Débroussaillons
la question. Vous parlez bien du film de 1963 avec Farid
Chawki, dont j'ai reproduit la jaquette de VHS sur mon
site ?
Je possède peu de documentation sur le cinéma
arabe. Dans ma vie, je n'ai eu l'occasion de voir que
deux «Antar» arabes : la VHS de 1963 et,
en salle, le film de 1973 (Antar à la conquête
du Sahara).
Je l'ai inclus dans ma filmo parce que ses aventures
font de lui un contemporain de l'Empereur byzantin Héraclius
II. En effet, je connaissais son histoire par les livres.
Mais j'aurais beaucoup voulu voir la version 1948 (Antar
et l'Empire romain) de Salah Abou Seif, réalisateur
égyptien que j'avais eu l'occasion de rencontrer
lors d'un Festival à Djerba en 1992, si j'ai
bonne mémoire.
Si vous êtes fan de la version 1963, comme je
crois comprendre, je suppose que vous possédez
déjà la VHS ou, mieux, le DVD. Nous sommes
donc à armes égales. Autant qu'il m'en
souvienne (mais je peux vérifier un de ces soirs)
le générique est en arabe, langue que
je ne lis pas. En revanche j'avais remarqué que
la BO de la VF était un pillage d'Ennio Morricone
et de Miklos Rozsa (Ben Hur). Et j'en viens à
ma question : s'agit-il une chanson en langue arabe
[là, je ne peux pas vous aider], ou de vocalises
d'une de ces solistes italiennes comme Edda Dell'Orso
qu'aimait à utiliser Ennio Morricone ?
Dans ce second cas de figure, aidez-moi à localiser
le passage sur la bande du film, et je pourrais essayer
de retrouver de quel film italien c'est tiré... |
| |
| |
| |
| FARIDA
RÉÉCRIT : |
Nous
parlons de la même chose. En pièce jointe
également un petit extrait que j'ai enregistré
sur mon portable (la qualité est vraiment médiocre)
mais j'adore et impossible de tomber sur quelqu'un qui
connaisse.
Si tu n'arrives pas à
l'écouter depuis l'ordi, tu peux te la transférer
sur un portable car c'est tout à fait lisible
depuis le portable !
|
| |
| |
| RÉPONSE
: |
Bien, nous avançons.
Mais moi, je suis «de la vieille école»,
et je n'ai pas de portable (c'est ce que nous appelons
en Belgique un «GSM», je suppose ?).
Le plus simple serait de me dire :
- S'agit-il d'une chanson en arabe ? Si oui, je suis
totalement incompétent pour vous répondre.
A part Oum Kalsoum, je ne connais rien à la
chanson arabe.
Si par contre il s'agit de vocalises morriconiennes,
là il se pourrait que je sache... J'ai autrefois
beaucoup aimé les westerns italiens et ça
pourrait être un emprunt à l'un d'eux.
- Evidemment, mon ordi refuse. Le mieux serait de
vous repasser la vidéo, de noter à combien
de minutes depuis le début intervient cette
chanson. Eventuellement, me dire à quelle scène
cela correspond. Il y a bien dix-douze ans que je
n'ai plus regardé ce film.
|
| |
| |
| |
| FARIDA
RÉPOND : |
A quelles
scènes ?
La 1ère donc c'est lorsque l'héroïne
du film décide d'aller «au lac»; et
elle et ses amies font toute une chorégraphie autour
de balançoires, puis en bordure du lac... avant
de se faire attaquer par les méchants !
La 2ème c'est lorsqu'Antar rentre de la guerre
et qu'il a défendu tout le monde... et là
l'héroïne chante avec une épée
à la main. |
| |
| |
| RÉPONSE
: |
Je viens de me passer les
18 premières minutes d'Antar Ben Shadad
en VHS. Ca commence par un dialogue du héros
avec un homme de son village - il n'y a pas de sous-titres
- sur fond du «Love theme of Ben Hur» de
Miklos Rozsa.
Ensuite les guerriers de la tribu partent pour la
guerre : de 10'20" à 11'00", en psalmodiant
un chant guerrier en arabe, qui ne doit rien au tzigane
wagnérien. Dialogues.
Puis de 11'30" à 12'00", les trompettes
de la «Parade of the charioteers» avec,
de 12'25" à 13'20", un enchaînement
rythmé par les tambours : «Roman March»
également connu, selon le pressage, sous le nom
de «Gratus' entry into Jérusalem».
A moins que le mixeur ait préféré
utiliser la combinaison trompettes/tambours déjà
existante dans l'illustration sonore du Triomphe de
Quintus Arrius à Rome (les trompettes pour le
char du proconsul romain combinées avec les tambours
ponctuant la marche de ses légionnaires à
pied : autant de thèmes qui reviennent régulièrement
à différents endroits de la B.O. de Ben
Hur) («Victory parade»).
L'ingénieur du son d'Antar Ben Shadad
utilise habilement sa table de mixage, mais les thèmes
restent parfaitement identifiables.
De 13'45" à 15'15", «The Mother's
love» - toujours de notre ami Rozsa, et toujours
emprunté à Ben Hur - accompagne
nos personnages.
De 15'34" à 18'15", les filles rassemblées
sous les palmiers, au bord du point d'eau de l'oasis,
chantent et dansent autour de la balançoire.
C'est la première scène que vous décrivez.
Elles chantent en arabe et... ici nous sortons : nous,
du domaine du cinéma américano-italien
et, moi, de ma sphère de compétence
! Ca me fait penser à de l'Oum Kalsoum, mais
qui suis-je pour être affirmatif en ce domaine
?
Désolé de ne pouvoir vous en dire plus. |
| |
| |
|
|

|
|
| |
| 30 juin 2008 |
| DU
PÉPLUM AUX JEUX VIDÉOS... |
| Julien
a écrit : |
| Je suis
étudiant en master de recherche d'histoire, mon
sujet de mémoire recoupe un peu votre site, puisque
qu'il concerne la représentation de l'Antiquité
romaine dans les jeux vidéo (mon sujet n'est pas
encore très bien établi). J'ai trouvé
votre site très intéressant et c'est ce
qui m'a poussé à vous écrire, j'aimerais
- si cela ne vous dérange pas - que vous me conseilliez
sur des lectures ou des orientations concernant mon sujet. |
| |
| |
| RÉPONSE
: |
Là nous atteignons
les limites de mon incompétence. En effet, je
ne suis pas, mais alors pas du tout «jeux»
vidéo, ni jeux tout court.
Que vous conseiller comme lectures ? Si vous êtes
déjà étudiant en Histoire, je ne
vois pas trop quoi vous conseiller dans ce domaine.
Et j'imagine que si vous avez choisi ce sujet, vous
en savez sans doute plus que moi en matière de
logiciels de jeux.
Voyez tout de même la littérature spécifiques
aux militaria, en particulier chez Errance. Poussez
la curiosité vers les associations qui font de
la reconstitution.
Question jeux, il existe également des publications
spécialisées en jeux de stratégie
comme Væ Victis. Væ Victis s'intéresse
à des batailles qui ont réellement eu
lieu. Mais les jeux vidéos ont une certaine tendance
à faire n'importe quoi, les Spartiates contre
les Toltèques ou que sais-je encore ? et les
jeux mythologiques à mélanger les cultures
(Grecs et Nordiques, p. ex.), mythes et SF. Mais c'est
vrai qu'on se croirait en plein péplum - comme
dans Le Choc des Titans, où le Kraken
scandinave intervient dans le mythe grec - ou dans une
BD de la Marvel !
Je serais bien sûr très heureux de vous
aider à fixer certaines choses... si vous avez
des questions bien précises. Mais ne m'interrogez
pas sur les mérites respectifs de tel ou tel
jeu. Je ne les connais pas |
| |
| |
|
|

|

|
|