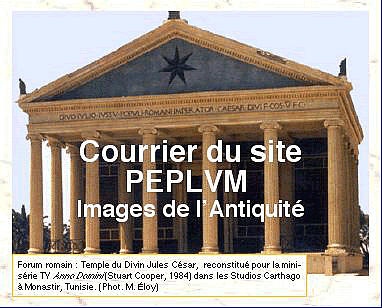|
NEWS DE JUILLET 2008 (SUITE) |
|
30 juillet 2008
ANNONCÉ : Daniel 007 Craig dans Les
mémoires d'Hadrien de John Boorman
Ca doit bien faire dix ans qu'il est en question, mais le
projet de John Boorman de porter à l'écran le
célèbre roman de Marguerite Yourcenar semble
se concrétiser. Il y a quelques mois encore, il était
question que le rôle de l'empereur romain soit endossé
par Antonio Banderas; celui-ci s'étant désisté,
c'est Daniel Craig qui l'assumera. Avec Charlie Hunnam (Queer
as Folks, Les Fils de l'homme) dans le rôle de Antinoüs,
l'amant d'Hadrien. Ca va de nouveau jaser dans les chaumières...
Le tournage devrait commencer au Maroc, en septembre 2008.
Liens Internet
|
| |
| |
|

|
|
[...]
MEMORANDUM : TIBERIUS & CAIUS SEMPRONIUS
GRACCHUS
Alexandre Dumas, déjà, avait tenté un
essai dans l'écriture tragique à sujet antique
avec Les Gracques (1827); mais dans «Comment
je devins Auteur dramatique» (1833), il avouera : «Je
lui ai rendu justice en le brûlant à peine né.»
Les films consacrés aux frères Gracques sont
suffisamment rares - nous ne voyons guère que Cajo
Gracco (Valiant Roman, or the Death of Gracchus [GB])
(Prod. Latium Film [Rome], IT - 1911) - pour que nous insérions
ici un petit mémorandum, en fait une compilation de
quelques ouvrages de références pour éclairer
le docufiction
réalisé par Christopher Spencer pour la BBC.
On a voulu voir en Tiberius et Caius Sempronius Gracchus
des socialistes avant l'heure. Le révolutionnaire Babeuf,
qui tenta de renverser le Directoire, adopta même leur
patronyme. Gracchus ! Le nom sonne bien et est connoté
de démocratie, sinon de communisme. Les vertus des
frères Gracchus sont tellement bien ancrées
dans la mémoire collective que leur mère sera
l'un des rares personnages féminins à apparaître
dans un court récit historique du journal Tintin,
«Cornélie, mère des Gracques» (Füncken),
mais c'était en 1965 il est vrai. Dans les années
'50, les femmes étaient - par contrat - proscrites
dans les illustrés catholiques pour jeunes garçons
: c'est ainsi que Cuvelier dessina une guerre de Troie sans
la Belle Hélène (1956) et les Füncken une
«Sédition Nika» sans l'impératrice
Théodora (1956).
C'est sans doute cette image d'intégrité morale
qui poussera Jacques Martin à en attribuer le nom à
son héros gaulois adopté par un patricien romain
: Alix Gracchus. Dalton Trumbo incarnera en un Gracchus
non-historique, mais canalisant les aspirations des populares,
le personnage interprété par Charles Laughton
dans Spartacus (Stanley Kubrick), l'ami de Jules César,
l'opposant à Crassus. La chose est amusante, car loin
d'être son ennemi, César, en fait, était
l'allié de Crassus - ce chevalier enrichi qui sponsorisait
sa carrière politique. Et un aïeul de Crassus,
P. Licinius Crassus avait, par ailleurs,
soutenu les Gracques dans leur «révolution»
agraire.
On pouvait être fabuleusement riche comme Crassus ou
aristocrate jusqu'au bout des ongles comme César, et
en même temps être un popularis. La politique
!... Ceci démontrant que les tenants et aboutissants
de la politique romaine échappent totalement au public
comme aux cinéastes, lesquels préfèrent
plaquer des positions d'aujourd'hui sur les figures emblématiques
de l'Histoire.
Un autre exemple ? Dans Gladiator,
le principal sénateur opposant au populisme de Commode,
le parangon des vertus républicaines à l'ancienne,
est un autre Gracchus (Derek Jacobi). Mais c'est un
peu vite oublier que l'illustre tribun de la plèbe
aurait sans doute volontiers lynché ses opposants siégeant
à la Curie, si ceux-ci n'avaient été
plus rapides que lui !
En fait, les frères Gracchus nous sont connus surtout
à travers les textes de Plutarque et d'Appien qui écrivaient
plus de trois siècles après leur mort et, sans
doute, ne comprenaient plus très bien les enjeux de
l'époque républicaine - eux qui vivaient dans
les réalités de l'Empire.
De ces réalités-là, l'historien moderne
peut néanmoins se faire une idée à travers
les allusions des contemporains des Gracques ou de la génération
qui les suivit immédiatement. Les frères Gracchus
n'étaient pas des révolutionnaires mais étaient
soucieux de faire appliquer des lois existantes, relatives
à l'ager publicus. Ils s'inquiétaient
de la chute de la natalité dans les classes des petits
propriétaires qui devaient le service militaire (à
cette époque, les légionnaires fournissaient
leur propre équipement, armes etc.). Et si ces dignes
humanistes défendirent les prolétaires qu'étaient
devenus les petits paysans romains, ce fut au détriment
des sujets de l'Empire qu'il livrèrent à la
férocité des publicains. Fermiers de l'impôt,
ces publicains étaient des chevaliers romains (equites),
une nouvelle classe à la charnière des optimates
et de la plèbe, que les Gracques contribuèrent
largement à créer : une «noblesse d'argent»,
celle des banquiers, des affairistes et des capitalistes.
Les Gracchi ne s'étaient-ils pas liés
aux philhellènes Sciponi, aristocrates qui entretenaient
des relations suivies avec les milieux d'affaires campaniens,
les marchands de Naples rivaux de ceux de Carthage ? C'est
la défense de leurs intérêts qui généra
les Guerres puniques, ce conflit impensable entre une puissance
foncière péninsulaire et un empire commercial
maritime, lesquels n'avaient aucune raison de se jalouser.
Du reste, payant de leur personne, il faut reconnaître
que les Scipion s'y investirent grandement : Scipion l'Africain
en remportant la Deuxième Guerre punique, Scipion Emilien
la Troisième, et Tiberius Gracchus en gagnant la corona
muralis sous les ordres de ce dernier.
Sources : Claude NICOLET, Les Gracques. Crise agraire
et révolution à Rome (Julliard, coll. «Archives»,
1967), nous a fourni l'essentiel (la Chronologie
et l'Appréciation). Les notices
biographiques et autres définitions sont de Jean H.
CROON (Encyclopédie de l'Antiquité classique,
Sequoia, 1960) et M.N. BOUILLET (Dictionnaire classique
de l'Antiquité sacrée et profane, Paris,
Bélin-Mandar éd., 1841).
1. Rappel préliminaire
de deux notions
A.
La classe des chevaliers (équites)
ÉQUITES, (a) - cavaliers de l'armée
romaine; à l'origine, citoyens romains jouissant de
la fortune exigée en garantie de l'entretien des chevaux
fournis par l'Etat. A la longue, Rome n'eut pourtant à
son service que des cavaliers étrangers (en particulier
Gaulois et Ibères).
(b) - l'ensemble de la cavalerie romaine qui, ne comportant
plus de fonction militaire, était soumise à
un census (norme de biens).
Depuis Caius Gracchus
(154-121 av. J.-C.), les équites formaient une classe
à part venant aussitôt après les sénateurs;
Gracchus leur donna les charges de membres du jury au tribunal
et de percepteurs d'impôts en Asie. Ils formaient une
véritable «noblesse d'argent» et gagnaient
souvent d'énormes fortunes comme banquiers, marchands
et publicains. Sylla leur supprima beaucoup de privilèges.
Sous les empereurs, les hauts fonctionnaires étaient
souvent choisis dans ce milieu. Les insignes des équites
comprenaient une tunique à étroit bord rouge
et un anneau d'or. (CROON, Dict.)
B. L'ager publicus
AGER PUBLICUS, terres annexées lors de la conquête
de l'Italie et qui faisaient partie du domaine national romain.
Elles furent, primitivement, distribuées entre les
patriciens et les plébéiens, qui n'en obtinrent
que très peu. Une partie fut affermée par les
censeurs au profit de l'État, une autre destinée
aux colonies. Malgré la loi agraire de Licinius (367
av. J.-C.), qui limitait les biens particuliers de l'Ager
Publicus, les grands domaines, ou latifundia, prirent
de plus en plus d'importance. Les Gracques (vers 130-120
av. J.-C.) voulurent remédier à cette situation,
en reconstituant les petites propriétés, mais
aucun résultat définitif ne fut atteint. La
question agraire est l'un des plus intéressants problèmes
de la dernière période de la République
romaine. Cette question changea d'aspect lorsque les guerres
civiles nécessitèrent la mobilisation de grandes
armées et la confiscation des terres cultivées
au profit des vétérans. Les terres des régions
conquises et les villes dévastées devinrent
Ager Publicus dans les provinces. (CROON,
Dict.)
2.
Biographies des Gracques
A. M.N. Bouillet (Dictionnaire
classique de l'Antiquité)
GRACQUES (Tib. et C. Sempronius), tribuns
du peuple, célèbres par leur éloquence,
leur dévouement à la cause populaire, et leur
fin malheureuse, étaient tous deux fils du consul Sempronius
et de Cornélie, sui les avait élevés
avec le plus grand soin.
Tiberius Gracchus
Tiberius, l'aîné, se fit élire tribun
l'an 153 av. J.-C. Profitant de sa grande popularité,
il voulut renouveler la loi agraire, qui avait déjà
causé des troubles à Rome. La loi fut adoptée,
et Tiberius nommé commissaire avec Appius, son beau-père,
et Caius son frère, pour présider au partage
des terres entre les citoyens. Les richesses qu'Attale avait
léguées au peuple romain furent distribuées
sans opposition. Tiberius s'applaudissait de son triomphe,
et allait être réélu tribun pour l'année
suivante, lorsqu'il fut assassiné au milieu de ses
partisans, par P. Nasica, 133 ans av. J.-C. Sa mort réprima
un instant l'ardeur des partisans de la démocratie.
Caius Gracchus
Mais dix ans après, soit par justice et par dévouement
pour le peuple alors écrasé par les grands,
soit par vengeance, son frère se fit nommer tribun
à son tour, et défendit la cause du peuple avec
encore plus d'emportement que Tiberius. Une nouvelle loi agraire
fut proposée et accueillie, d'autres dispositions non
moins fatales à la noblesse de Rome se succédaient
journellement : deux ans entiers Caius fut l'arbitre de la
république; tout annonçait la ruine totale de
l'aristocratie quand le consul Opimius, employant la force
ouverte pour prévenir cet événement,
se rendit au forum avec des hommes armés, et voulut
dissoudre l'assemblée. Un combat s'ensuivit, le peuple
fut vaincu, et Gracchus forcé de fuir dans le temple
de Diane, où ses amis l'empêchèrent de
s'ôter la vie; mais il y fut tué par l'ordre
d'Opimius, l'an 121 av. J.-C., douze ans après la fin
malheureuse de son frère Tiberius.
On a accusé Caius d'avoir trempé ses mains dans
le sang de Scipion l'Africain, qui fut trouvé mort
dans son lit.
(PLUTARQUE, Gracchus - CICÉRON, Cat.
- LUCAIN, Pharsale, VI, 796 - FLORUS, II, 17; III,
14.)
B. Jean H. Croon (Encyclopédie
de l'Antiquité classique)
GRACQUES (Les), tribuns, orateurs et réformateurs
sociaux de Rome, au cours de la seconde moitie du IIe s. av.
J.-C. Leur activité donna l'impulsion aux luttes qui
opposèrent les optimates et les populares
pendant tout le Ier s. av. J.-C.
(a) - Gracchus, Tiberius Sempronius,
fils de Cornélie, la fille de Scipion l'Africain; né
en 160 av. J.-C., élevé dans les idéaux
grecs du «cercle de Scipion» (v. Lælius),
idéaux qu'il voulut réaliser sur le plan politique.
C'est en se rendant
à Numance, où il servit sous Scipion Emilien,
qu'il aurait été indigné par l'injustice
régnant dans les latifundia; à son retour,
ému par le sort des prolétaires il se fit élire
tribun de la plèbe (133) et proposa une loi agraire.
Cette loi n'était certes pas révolutionnaire.
II voulait faire entrer en vigueur une ancienne loi préconisant
que personne ne pouvait posséder plus qu'une certaine
part de l'ager publicus; le surplus,
divisé en petites parcelles, serait distribué
aux prolétaires. Le projet devait être financé
par les capitaux d'Attale III : ce qui portait atteinte aux
droits du Sénat puisque ce dernier contrôlait
les Finances et les Relations extérieures. Les sénateurs,
grands propriétaires fonciers, possédèrent
donc une arme contre lui. Ils achetèrent un collègue
de Gracchus qui opposa son veto au projet de loi; mais Gracchus
obtint par le Peuple la démission de ce tribun (ceci
était bien révolutionnaire), et la loi fut votée
par les comices tributes. Lorsque Gracchus voulut se
faire réélire (ce qui était illégal)
une émeute éclata et il fut tué par Scipion
Nasica; 300 de ses partisans périrent. La loi resta
en vigueur.
(b) - Gracchus, Caius Sempronius,
frère du précédent, élu tribun
de la plèbe en 123, il décida de venger Tiberius
et de réaliser ses plans avec encore plus d'énergie.
Plus calculateur et plus rusé, il essaya de diminuer
la puissance du Sénat en enfonçant un coin entre
les sénateurs et les «barons de la finance»
qui allaient bientôt former la classe des equites.
II confia aux derniers la perception des impôts dans
la nouvelle province d'Asie, ainsi que la marche des tribunaux
qui jugeaient les procès pour cause d'exaction. II
se gagna les faveurs du peuple grâce à une loi
instituant la vente du blé à bas prix, et put
alors exécuter son propre programme. C'était
un projet grandiose ayant pour but la création de colonies
agricoles en Italie et surtout à l'extérieur,
sur les terres de Carthage, détruite en 146; le Sénat
parvint de nouveau à lui opposer un collègue,
Drusus, prêt à faire échouer ses plans.
Il supplanta Gracchus dont la popularité commença
de baisser pendant son 2e tribunat (entre-temps la réélection
était devenue possible). Une proposition de loi visant
à accorder aux socii le droit de cité
romain en compensation de la perte de leurs terres, fut repoussée
par le peuple imprévoyant. C'est en vain que Gracchus
essaya de se faire élire une troisième fois.
Des émeutes éclatèrent; le Sénat
employa pour la première fois, le senatus consultum
ultimum (v. caveant consules), et Gracchus se fit
tuer par un esclave après avoir pris la fuite (121).
L'activité des Gracques, celle plus
idéaliste du premier et celle à tendance plus
politique du second, eut des conséquences imprévisibles.
Les Gracques avaient compris la profondeur de la décadence
sociale à Rome et en Italie, mais le temps n'était
pas encore venu pour mener une lutte efficace, surtout contre
l'opposition égoïste des optimates. La plupart
de leurs buts furent seulement atteints sous l'Empire : Rome
dut traverser d'abord les guerres civiles que les Gracques
avaient en fait déclenchées. Mais ils avaient
prouvé que l'oligarchie des Nobiles pouvait
être secouée par une agitation politique. Il
existe néanmoins une différence importante entre
leur politique sociale et celle des empereurs ultérieurs;
ainsi Caius jeta aux loups, sans aucuns scrupule, la population
des provinces, notamment celle de l'Asie, pour aider les prolétaires.
De plus, il n'était pas question de «socialiser»
la propriété privée puisqu'il ne s'agissait
que des possessions de l'Etat. Il n'est donc pas correct de
considérer les Gracques comme les prototypes des socialistes,
ainsi qu'on le fera quelques siècles plus tard.
3. Chronologie des Gracques
Le déroulement des événements politiques
entre 155 et 121 av. J.-C.
| 155 — |
Mort de Tiberius Sempronius Gracchus,
père des Gracques. Il avait été légat
en 190, ambassadeur en 185, tribun de la plèbe
(187 ou 184 ?), triumvir pour la déduction d'une
colonie en 183, édile curule en 182, préteur
en Espagne Citérieure en 180, consul en 177, censeur
en 169, consul II en 163, proconsul en 162, encore ambassadeur
en 162-161. II était entré dans la famille
des Scipions en épousant Cornélie.
Athènes envoie à Rome une ambassade concernant
le territoire d'Oropos, composée de philosophes,
Diogène de Babylone, Carnéade, Critolaos.
Rome mène de dures guerres en Espagne. |
| 151 — |
Difficultés sociales et politiques à
Rome; les consuls L. Licinius Lucullus et A. Postumius
Albinus sont emprisonnés par les tribuns de la
plèbe, pour avoir fait une levée de troupes
pour l'Espagne trop exigeante (TITE-LIVE, Per.,
48).
Scipion Emilien sert comme tribun militaire en Espagne. |
| 150 — |
Prodromes de la Troisième Guerre punique (hostilités
entre Massinissa, roi de Numidie, et Carthage; ambassade
en Afrique de Scipion Emilien). |
| 149 — |
Troisième Guerre punique. Les deux consuls,
L. Marcius Censorius et M. Manilius, mettent le siège
devant Carthage qui résiste farouchement.
Le tribun L. Calpurnius Piso Frugi fait passer une loi
créant des «tribunaux permanents» pour
juger les crimes d'extorsion.
Scipion Emilien sert comme tribun militaire en Afrique.
Mort de Caton le Censeur. |
| 148 — |
Guerre en Grèce : avec un prétendant en
Macédoine, Andriscos, et bientôt avec La
Ligue achéenne.
Scipion, à la mort de Massinissa, règle
la succession de Numidie; retourné à Rome
pour se présenter à l'édilité,
il est élu consul, bien que n'ayant aucune des
qualifications légales, et on lui assigne, sans
tirage au sort, la province d'Afrique.
Début de la guerre avec Corinthe et la Ligue achéenne. |
| 146 — |
Scipion, proconsul, prend et détruit
Carthage, après un long siège, et en «consacre»
le territoire.
L. Mummius prend et pille Corinthe, confisque son territoire.
Le Sénat envoie en Achaïe et en Afrique des
commissions pour régler le sort de ces provinces
et décider du statut des terres nouvellement acquises
à l'ager publicus. |
| 145 — |
Le tribun de la plèbe C. Licinius Crassus présente
une loi proposant de substituer l'élection par
le peuple à la cooptation pour les collèges
de prêtres (repoussée grâce au préteur
C. Lælius, un ami des Scipions); il s'adresse directement
au peuple dans ses harangues. |
| 144 — |
Le préteur urbain Q. Marcius Rex accomplit,
sur un fond de 180 millions de sesterces, les derniers
«grands travaux édilitaires» avant
ceux de Caius Gracchus (réparation des anciens
aqueducs, construction d'un nouveau). |
| 142 — |
Censure de Scipion Emilien et de L. Mummius. Scipion
se montra particulièrement sévère
dans le contrôle du rôle des Sénateurs
et de l'ordre équestre.
Début de la guerre contre Numance en Espagne. |
| 140 — |
Consulat de C. Lælius, ami et confident de Scipion.
Il fait une proposition agraire, qu'il retire à
cause de l'opposition du Sénat (PLUTARQUE, Tib.
Gr., VIII, 3-4).
Ambassade de Scipion en Orient (Egypte, Rhodes, Pergame). |
| 139 — |
A. Gabinius, tribun de la plèbe, fait passer
la première loi prévoyant le vote secret
pour les élections.
Guerre en Espagne. |
| 138 — |
Nouveau conflit à Rome à propos de la
levée menée par les consuls P. Cornelius
Scipion Nasica et D. Junius Brutus, qui sont, eux aussi,
emprisonnés par les tribuns (TITE-LIVE, Per.,
55).
Affaire de la forêt de la Sila, qui oppose le Sénat
aux compagnies de Publicains.
Agitation autour du prix du blé (VAL. MAX., III,
3; TITE-LIVE, Per., 55). |
| 137 — |
Défaite et encerclement
du consul C. Hostilius Mancinus en Espagne devant Numance.
Son questeur, Tiberius Gracchus, s'entremet entre les
Numantins vainqueurs et Mancinus, et obtient une capitulation
honorable, suivie d'un traité. Le Sénat
refuse de ratifier le traité et ordonne de livrer
le consul aux ennemis.
Seconde «loi tabellaire», de L. Cassius Longinus,
étendant le vote secret aux comices judiciaires
(sauf pour haute trahison). |
| 136 — |
Guerre en Espagne.
Début d'une grande insurrection servile en Sicile. |
| 134 — |
Scipion Emilien élu consul pour la seconde fois,
toujours par dérogation à la loi. Il commence
le siège de Numance, après avoir restauré
la discipline militaire. C. Sempronius Gracchus, le jeune
frère de Tiberius, commence à servir comme
tribun militaire.
Tiberius est élu tribun pour 133. |
| 133 — |
Prise
de Numance par Scipion.
Mort d'Attale III, roi de Pergame, qui lègue
ses biens et son royaume aux Romains, à l'exception
des villes libres. Son bâtard Aristonicos
prend le titre de roi (Eumène III), et fait
la guerre aux Romains.
Tribunat de Tiberius Gracchus. |
- Proposition
de loi agraire, d'abord soutenue par le consul
P. Mucius Scævola, et l'ancien consul
Appius Claudius Pulcher.
- Opposition, et déposition
par Tiberius, du tribun M. Octavius.
- Election du triumvirat agraire
: Ti. Sempronius Gracchus, C. Sempronius Gracchus,
Ap. Claudius Pulcher. Tiberius, après
son assassinat, sera remplacé par P.
Licinius Crassus, beau-père de Caius.
|
| Devant
l'opposition du Sénat, Tiberius préparait
peut-être d'autres mesures concernant le recrutement
de l'armée et la judicature, et peut-être
une proposition de loi pour être autorisé
à exercer un second tribunat. Il est tué
au cours d'une émeute suscitée par
les Sénateurs, sous la conduite de Scipion
Nasica. |
|
| 132 — |
Les consuls P. Popillius Lænas et P. Rupilius
(ce dernier un client des Scipions) dirigent des poursuites
officielles contre les partisans de Tiberius, par exemple
Blossius, aidés par Lælius.
Rupilius met fin à la révolte servile en
Sicile et donne à cette province une «charte»,
inspirée en grande partie de celle de Hiéron
de Syracuse.
Triomphe de Scipion Emilien.
Scipion Nasica est envoyé en mission en Asie pour
organiser la province. |
| 131 — |
Guerre contre Aristonicos en Asie.
Les deux censeurs, Q. Cæcilius Metellus Macedonicus
et Q. Pompeius, entrent en conflit avec un tribun de la
plèbe, et cherchent à encourager la natalité. |
| 130 — |
Fin de la guerre d'Aristonicos.
Mort de P. Licinius Crassus et d'App. Claudius, remplacés
au triumvirat agraire par M. Fulvius Flaccus, et C. Papirius
Carbo, tribun de la plèbe.
Reprise des assignations ?
Scipion Emilien prend la tête d'une sorte de «parti
italien» opposé à la loi agraire.
II se heurte à Papirius Carbo, qui lui reproche
sa complicité dans le meurtre de Tiberius.
Carbo propose une loi permettant la réélection
des tribuns, et fait passer une loi tabellaire. |
| 129 — |
Scipion [Scipion Emilien (1)]
- qui pense peut-être à revêtir une
«dictature constituante» - fait enlever, par
une loi, aux triumvirs agraires leurs pouvoirs judiciaires,
et la fait transférer aux consuls qui refusent
d'en user sous prétexte de partir en campagne.
Scipion meurt brusquement, la veille des Feries Latines,
à la veille du jour où il devait proposer
l'abrogation de la loi agraire. On parle d'assassinat. |
| 126 — |
Questure de C. Gracchus en Sardaigne.
Proposition de loi de M. Iunius Pennus pour chasser de
Rome les non-citoyens, à laquelle s'oppose Caius. |
| 125 — |
Consulat de M. Fulvius Flaccus, qui propose de donner
le droit de cité aux Italiens; recevant la Gaule
comme province, il manifeste une grande activité,
trace des routes, fonde des colonies.
Révolte de la ville latine de Frégelles,
prise et détruite par le préteur L. Opimius. |
| 124 — |
Caius Gracchus, proquesteur en Sardaigne,
revient à Rome pour se présenter aux élections
tribuniciennes; il doit s'expliquer devant les censeurs.
Il est élu avec difficulté, malgré
le nombre de ses partisans venus à Rome de toute
l'Italie. |
| 123 — |
Premier tribunat de Caius Gracchus. Le problème
de la chronologie exacte de ses lois, et de leur répartition
sur les deux tribunats, est très délicat
et controversé. De même, on ne sait quand
placer exactement le tribunat de C. Rubrius, qui proposa
la loi sur la fondation de la colonie de Carthage. |
| 122 — |
Consulat de C. Fannius, élu avec l'aide de C.
Gracchus (PLUT., C. Grac., VIII, 2-3).
2e Tribunat de Caius. Datent certainement de cette année
la ou les lois proposées par lui sur l'octroi du
droit de cité aux Latins, du droit latin aux Alliés,
repoussées en partie à cause de Fannius.
En revanche, la loi judiciaire, si elle est bien celle
du texte épigraphique, doit dater de 123.
Caius passe deux mois en Afrique pour mener à bien
les opérations de cadastration de la colonie de
Carthage. A son retour à Rome, sa popularité
est battue en brèche par la politique de M. Livius
Drusus. II échoue dans sa candidature à
3e tribunat.
Tribunat de M. Livius Drusus (le père du tribun
de 91 av. J.-C.) qui inaugure une politique curieuse (mais
judicieuse) de «surenchères» démagogique
(APPIEN, B.C., I, 23; PLUT., C. Grac., IX,
2), par exemple supprimant le «vectigal» sur
les lots distribués, que Caius avait maintenu... |
| 121 — |
Caius n'est plus que triumvir agraire.
Election du consul L. Opimius, opposant convaincu de Caius,
le destructeur de Frégelles.
Le Sénat tente de faire abroger la loi Rubria,
sur la colonie de Carthage, invoquant des prétextes
religieux. Fulvius et Caius veulent résister, et
rassembler leurs partisans.
Le Sénat vote le «Senatus-Consultum ultimum»,
la loi martiale qui donne aux consuls le droit de condamner
sans appel des citoyens. Caius et Fulvius sont tués,
avec 3.000 de leurs partisans. (Claude NICOLET) |
4. Appréciation de
l'action des frères Gracchus
Certains historiens la conçoivent d'une façon
qu'on pourrait qualifier de limitative ou machiavélienne
[l'action de frères Gracchus]. Tiberius et Caius Gracchus
ne seraient que les porte-paroles d'un «parti»,
ou plus exactement d'un «clan», d'une factio,
regroupant certaines des grandes familles qui se partageaient,
non sans rivalités, l'influence, les honneurs et le
pouvoir depuis plus d'un demi-siècle (2).
Or, depuis le début du IIe s. (plus exactement depuis
164 av. J.-C.), ces factiones se trouvent gênées,
dans le jeu de leurs rivalités politiques, dans leurs
projets de guerres coloniales, par la baisse lente mais régulière
de la population civique romaine, et surtout par ses conséquences
sur le recrutement militaire. Que cette baisse ne soit que
la manifestation la plus visible d'une vaste crise agraire,
elle-même d'origine économique et sociale, ces
historiens ne le nient pas. Mais, d'après eux, les
préoccupations essentielles des Gracques et de leurs
amis ne dépassaient pas l'aspect purement civique et
politique de cette crise; et les remèdes qu'ils s'efforcèrent
d'y apporter - essentiellement la loi agraire - étaient
spécifiquement limités à ce niveau le
plus superficiel du problème. Ils auraient ressenti
d'abord la diminution de plus en plus contraignante des classes
censitaires de moyens propriétaires, parmi lesquelles
seules pouvaient se recruter les armées citoyennes,
l'étiolement des clientèles rurales sur lesquelles
étaient assises leur influence électorale et
la prospérité de leurs maisons. Ils n'auraient
pas discerné les profonds mouvements économiques
qui avaient occasionné cette disparition, ni ses conséquences
sociales; enfin, leurs réformes, loin de chercher à
porter un remède à un malaise d'origine sociale,
n'auraient eu pour but que de résoudre, au profit d'une
faction, la crise des clientèles militaires et civiles.
Tiberius Gracchus et ses successeurs n'auraient eu aucune
idée de réformes sociales et économiques
profondes : ils chercheraient empiriquement une réponse
à un défi politique; seules leurs méthodes,
s'écartant délibérément des prudentes
traditions de l'oligarchie romaine, ne répugnant ni
à la démagogie, ni à l'emploi de la violence,
trancheraient, par leur brutalité, sur celles de leurs
pairs. Au profit de leur factio, ils introduisaient
à Rome les mœurs politiques des tyrans hellénistiques
et, en tâchant de favoriser des clientèles, ne
chercheraient à assurer que leur pouvoir personnel.
En bonne méthode, pour apprécier
justement la portée des mesures proposées par
Tiberius, comme les intentions réelles qui l'animaient,
il faut d'abord essayer de voir comment les contemporains
ressentaient la crise qu'elles se proposaient de combattre.
Il faut voir aussi si les arguments moralisants que nous transmettent
les sources postérieures sont à leur place,
ou non, dans le contexte idéologique du IIe s. avant
J.-C. C'est sur ces deux points seulement - parmi d'autres
-, que voudraient insister les chapitres suivants. Notre propos
n'est pas de donner sur les Gracques un livre complet, qui
réclamerait d'autres recherches, mais d'explorer seulement
deux aspects privilégiés de leur histoire. (Claude
NICOLET)
NOTES :
(1)
Le destructeur de Carthage, en 146, également surnommé
«Le Second Africain». Il s'agit de P.
Cornelius Scipio Æmilianus Africanus Numantinus,
fils de Paul Emile - consul en 182 et 168, le vainqueur
de Pydna -, adopté par le second fils de Scipion
l'Africain, P. Cornelius Scipio Africanus. - Retour
texte
(2)
D.C. EARL, Tiberius Gracchus, an essay in politics,
coll. Latomus, Bruxelles, 1963. - Retour
texte
|
| |
| |
|

|
|
| |
| [23 mars 2008] |
| LE
SUPPLICE DE SAINTE BLANDINE ET L'«EVANGILE SELON
JUDAS» |
| Margaux
a écrit : |
Récemment
(au début de cette année), j'ai vu à
la télévision un docufiction où
l'on voyait reconstitué le supplice de sainte
Blandine, contrainte à s'asseoir sur une chaise
de fer chauffée à blanc. Le connaissez-vous
?
|

En 177, sous Marc
Aurèle, à Lugdunum (Lyon) dans l'Amphithéâtre
des Trois Gaules, Sainte Blandine fut battue,
assise sur une chaise rougie au feu, livrée
aux lions - qui n'avaient pas faim, le rôti
étant trop cuit ! -, puis enfermée
dans un filet et livrée aux cornes d'un
taureau. Comme après tout cela, elle vivait
encore, elle fut finalement égorgée
(EUSÈBE DE CÉSARÉE, Hist.
ecclésiastique). SMistes qui nous lisez,
la bave au coin de la lippe, c'est sainte Blandine
que vous devez révérer : seule sa
haute bienveillance vous permettra de supporter
les plus atroces, quoique délicieux, tourments...
- encore que personnellement, nous réservions
nos suffrages à sainte Agathe de Catane
et à ses deux «gâteaux
des Vierges» apportés sur un
plateau d'argent, dont parle Tomasi di Lampedusa
à la fin du Guépard et que
Francisco de Zurbarán a fixés pour
l'éternité (dessin de Pierre Castex
pour L'Histoire de France en bandes dessinées,
Larousse, 1976) |
|
| |
| |
| RÉPONSE
: |
Il doit s'agir de L'évangile
selon Judas (2005), passé effectivement sur
RTL-TVI dimanche 23 mars 2008, puis sur TV-NET dimanche
29 juin 2008. Précédemment, on avait déjà
pu le voir sur FR5 dimanche 16 avril 2006.
Vers 180 de n.E. un des Pères de l'Eglise,
saint Irénée (130-202) évêque
de Lyon, soucieux de mettre un peu d'ordre dans les
outils de la foi chrétienne - une centaine de
ses coreligionnaires venaient d'être suppliciés
dans la capitale de la Gaule, dont Blandine assise sur
une chaise de fer rougie au feu - avait sélectionné
les quatre évangiles (Marc, Matthieu, Jean et
Luc) qui lui semblaient les plus probants, pour en rejeter
plus d'une trentaine d'autres qu'il décréta
être hérétiques tels les évangiles
de Marie-Madeleine, Philippe, Thomas ou Judas etc. Ce
dernier texte était gnostique, c'est-à-dire
émanant d'une secte chrétienne très
influencée par le paganisme. Car Judas, considéré
comme le traître absolu - 18 passages dans les
Evangiles fondent sa mauvaise réputation - y
était présenté comme le disciple
favori du Christ, à la demande duquel il l'aurait
livré aux Romains afin d'accomplir son destin
de martyr. Cette réhabilitation n'était
pas du goût d'Irénée. Etait-elle
si étonnante, cependant ? En fait les Evangiles
n'ont vraisemblablement pas été écrits
par les disciples du Christ dont on leur a attribué
le nom, mais beaucoup plus tard. Le plus ancien, celui
dit «de Marc», daterait de 60-65 et... ne
confère pas à Judas ce rôle de méchant
qui lui sera attribué plus tard. Marc parle seulement
de celui qui «plongea sa main dans le plat»
en même temps que Jésus (1).
Matthieu, le premier, désignera nommément
Judas. C'est Jean qui formulera les accusation les plus
nettes : «celui à qui je donnerai la
bouchée que je vais tremper.» Gardien
de la bourse commune des disciples, il est présenté
comme malhonnête et cupide, foncièrement
mauvais. A noter également que dans les Actes,
Judas ne se pend pas, mais ayant fait une chute il se
rompt par le milieu du corps. Selon l'Evangile de
Judas, c'est le Christ lui-même qui demande
à Judas de le trahir, afin qu'il puisse accomplir
son destin : «Tu les surpasseras tous [les
autres disciples]. Car tu sacrifieras l'homme qui
me revêt.» Et de promettre encore :
«Tu seras maudit.» En fait, il ne
faut pas attendre de l'Evangile de Judas des
indications historiques sur la Passion de Jésus,
mais plutôt des éclaircissements sur la
secte gnostique qui l'a composée, une secte marginalisée
par rapport au bouillonnement des tendances contradictoires
d'un christianisme non encore abouti : le Christ est-il
divin ou humain, doit-il se conforter au judaïsme
ou s'en démarquer, doit-il perpétuer l'espèce
?
L'évangile de Judas fut découvert en
1978 par un berger sur un site copte du IIIe-Xe s. de
n.E., comme l'attestent des tessons de poterie, non
loin de Nag Hammadi (célèbre pour sa bibliothèque
paléochrétienne riche de 52 manuscrits,
découverte en 1945). L'antiquaire égyptien
Hanna qui en fit l'acquisition se fit cambrioler, mais
finit par récupérer son bien. Après
une infructueuse tentative de le vendre à trois
chercheurs américains - Stephan Emmel et deux
collègues -, à Genève en mai 1983,
le document de 13 feuillets écrits recto-verso
atterrit dans un coffre de la Citibank à Hicksville
(Long Island) où on l'oublia. Jusqu'à
ce qu'en avril 2000, une antiquaire helvétique
d'origine gréco-égyptienne, Frieda Nussberger-Tchacos
en fasse l'acquisition pour environ 300.000 dollars.
Ce sont des chercheurs de l'Université de Yale
qui identifieront le codex, maintenant en très
mauvais état du fait de ses tribulations, comme
étant ce fameux textes auquel saint Irénée
fait allusion dans son Contre les hérésies.
Nussberger-Tchacos remettra le manuscrit à la
Fondation Mæcenas pour l'art ancien, de Bâle,
laquelle en confiera la restauration à Rodolphe
Kasser assisté de Florence Darbre. Ceux-ci mettront
cinq ans pour le reconstituer à 80 pour cent.
C'est la National Geographic Society qui en cofinança
la restauration avec la Wait Institute for Historical
Discovery, en échange de l'exclusivité
de la couverture médiatique.
L'Evangile selon Judas
[tv] [docufiction]
The Gospel of Judas - The Lost Version of Christ's
Betrayal
Prod. : National Geographic Society (USA) / Coul. /
87'
Réal. & prod. : James BARRAT;
Scén. : John BREDAR, James BARRAT;
Prod. exéc. : John BREDAR;
Narration VO : Peter COYOTE.
Intervenants : Frieda NUSSBERGER-TCHACOS, antiquaire
zürichoise - Florence DARBRE, restauratrice de
papyrus - Rodolphe KASSER, spécialiste du copte,
traducteur du papyrus (Université de Genève)
- Bart EHRMAN, Univ. de Caroline du Nord - William KLASSEN,
Univ. de Waterloo (Canada) - Marvin MEYER, spécialiste
du copte, Univ. de Chapman (Californie) - Craig EVANS,
Acadia Divinity College (Canada) - Stephen EMMEL, Univ.
Münster (Allemagne) - Timothy JULL, spécialiste
datation au carbone 14, Univ. d'Arizona - Elaine PAGELS,
professeur de religion, Univ. de Princeton - Robert
H. SCHOLLER, fondateur et pasteur de la Crystal Cathedral.
| EU/ |
TV : National Geographic
Channel 9 avril 2006 (première diffusion)
|
Notes
Tournage en Egypte (documentaire) et en Tunisie (scènes
de fiction).
Scénario
Voici les résumés publiés sur la
Toile.
 RTL-TVI
(dimanche 23 mars 2008 - Les grands documents de
Grand Angle) : Le personnage de Judas semble l'archétype
du traître. Est-il vraiment celui qui a livré
le Christ aux Romains ? D'aucuns le considèrent
comme le seul apôtre à l'avoir compris.
En effet, un ancien manuscrit a été récemment
traduit. Découvert en Egypte dans les années
'70, ce document pourrait apporter un nouvel éclairage
sur la relation singulière qu'entretenaient Jésus
et Judas. Contrairement aux quatre évangiles
reconnus par l'Eglise catholique, ce texte affirme que
Judas a dénoncé le Christ à sa
demande. Et il apparaît que ce manuscrit avait
été évoqué par l'évêque
de Lyon, en 180. Or, ces quelques lignes avaient été
immédiatement qualifiées d'hérétiques
par l'Eglise.
RTL-TVI
(dimanche 23 mars 2008 - Les grands documents de
Grand Angle) : Le personnage de Judas semble l'archétype
du traître. Est-il vraiment celui qui a livré
le Christ aux Romains ? D'aucuns le considèrent
comme le seul apôtre à l'avoir compris.
En effet, un ancien manuscrit a été récemment
traduit. Découvert en Egypte dans les années
'70, ce document pourrait apporter un nouvel éclairage
sur la relation singulière qu'entretenaient Jésus
et Judas. Contrairement aux quatre évangiles
reconnus par l'Eglise catholique, ce texte affirme que
Judas a dénoncé le Christ à sa
demande. Et il apparaît que ce manuscrit avait
été évoqué par l'évêque
de Lyon, en 180. Or, ces quelques lignes avaient été
immédiatement qualifiées d'hérétiques
par l'Eglise.
(Présenté par David Oxley [2].)
Idem
: Judas est-il celui qui a trahi le Christ ? D'aucuns
le considèrent comme le seul à avoir compris
ce que voulait Jésus. En effet, un manuscrit
a été découvert en Egypte dans
les années 70. Ce document apporte un nouvel
éclairage sur la relation qu'entretenaient Jésus
et Judas. Contrairement aux Evangiles reconnus par l'Eglise,
ce texte affirme que Judas a dénoncé le
Christ à sa demande.
Le personnage de Judas semble l'archétype du
traître. Est-il vraiment celui qui a livré
le Christ aux Romains ? D'aucuns le considèrent
comme le seul apôtre à l'avoir compris.
En effet, un ancien manuscrit a été récemment
traduit. Découvert en Egypte dans les années
'70, ce document pourrait apporter un nouvel éclairage
sur la relation singulière qu'entretenaient Jésus
et Judas. Contrairement aux quatre évangiles
reconnus par l'Eglise catholique, ce texte affirme que
Judas a dénoncé le Christ à sa
demande. Et il apparaît que ce manuscrit avait
été évoqué par l'évêque
de Lyon, en 180. Or, ces quelques lignes avaient été
immédiatement qualifiées d'hérétiques
par l'Eglise.
|
L'évangile de Judas : fragment
du papyrus en couverture du National Geographic,
mai 2006
et le baiser de Judas à Jésus en
vitrail, en couverture de Religions & Histoire,
nÁ 11, novembre-décembre 2006 |
 FRANCE
5 (dimanche 16 avril 2006) : Le documentaire
sur L'évangile selon Judas, qui raconte
l'histoire de ce manuscrit de sa découverte à
son authentification, sera diffusé en France
par la chaîne par câble et satellite National
Geographic, puis par France 5, a-t-on appris auprès
des chaînes. Le National Geographic avait annoncé
l'authentification de ce manuscrit en papyrus datant
du IIIe ou IVe s. et contenant la seule copie connue
de l'Evangile selon Judas, du nom de l'apôtre
qui a trahi Jésus. Le documentaire, produit par
National Geographic Television et préacheté
par France 5, sera diffusé dimanche 9 avril à
20h45 en première mondiale sur la chaîne
par câble et satellite, National Geographic Channel.
Il sera ensuite rediffusé samedi 15 et jeudi
27 avril à 20h45. France 5 sera la première
chaîne hertzienne à diffuser ce document
exceptionnel dimanche 16 avril à 15h30 et samedi
6 mai à 23h00. Selon le professeur Rudolf Kasser,
à qui a été confié le travail
de restauration, d'analyse et de traduction du document,
le film reconstitue «le puzzle le plus complexe
jamais créé par l'histoire»,
a précisé France 5. Il retrace la découverte,
la restauration et la traduction de ce manuscrit de
25 pages en papyrus, écrit en copte dialectal
et datant du IIIe ou IVe s., jusqu'à son authentification.
FRANCE
5 (dimanche 16 avril 2006) : Le documentaire
sur L'évangile selon Judas, qui raconte
l'histoire de ce manuscrit de sa découverte à
son authentification, sera diffusé en France
par la chaîne par câble et satellite National
Geographic, puis par France 5, a-t-on appris auprès
des chaînes. Le National Geographic avait annoncé
l'authentification de ce manuscrit en papyrus datant
du IIIe ou IVe s. et contenant la seule copie connue
de l'Evangile selon Judas, du nom de l'apôtre
qui a trahi Jésus. Le documentaire, produit par
National Geographic Television et préacheté
par France 5, sera diffusé dimanche 9 avril à
20h45 en première mondiale sur la chaîne
par câble et satellite, National Geographic Channel.
Il sera ensuite rediffusé samedi 15 et jeudi
27 avril à 20h45. France 5 sera la première
chaîne hertzienne à diffuser ce document
exceptionnel dimanche 16 avril à 15h30 et samedi
6 mai à 23h00. Selon le professeur Rudolf Kasser,
à qui a été confié le travail
de restauration, d'analyse et de traduction du document,
le film reconstitue «le puzzle le plus complexe
jamais créé par l'histoire»,
a précisé France 5. Il retrace la découverte,
la restauration et la traduction de ce manuscrit de
25 pages en papyrus, écrit en copte dialectal
et datant du IIIe ou IVe s., jusqu'à son authentification.
 TV-NET
(dimanche 29 juin 2008) : Un manuscrit en papyrus
de 25 pages a été découvert, par
hasard, dans une grotte, en Egypte, à la fin
des années '70. Enfoui dans les sables depuis
plus de 1.700 ans, le parchemin, écrit en copte
dialectal, la langue des chrétiens d'Egypte,
a été authentifié comme datant
du IIIe ou IVe siècle. Le document met aujourd'hui
toute la communauté chrétienne en émoi.
En effet, il pourrait s'agir d'un évangile attribué
à Judas, l'apôtre qui a livré Jésus
aux Romains. Depuis le Concile de Nicée, qui
s'est déroulé en 325, l'Eglise reconnaît
quatre Evangiles, attribués à Jean, Luc,
Matthieu et Marc. Il existe cependant une trentaine
d'autres textes, dit apocryphes, tel que l'évangile
de Marie-Madeleine, de Bartholomée ou encore
de Nicodème. Ils auraient été écartés
pour répondre aux besoins politiques de l'empereur
romain Constantin, le premier empereur chrétien.
TV-NET
(dimanche 29 juin 2008) : Un manuscrit en papyrus
de 25 pages a été découvert, par
hasard, dans une grotte, en Egypte, à la fin
des années '70. Enfoui dans les sables depuis
plus de 1.700 ans, le parchemin, écrit en copte
dialectal, la langue des chrétiens d'Egypte,
a été authentifié comme datant
du IIIe ou IVe siècle. Le document met aujourd'hui
toute la communauté chrétienne en émoi.
En effet, il pourrait s'agir d'un évangile attribué
à Judas, l'apôtre qui a livré Jésus
aux Romains. Depuis le Concile de Nicée, qui
s'est déroulé en 325, l'Eglise reconnaît
quatre Evangiles, attribués à Jean, Luc,
Matthieu et Marc. Il existe cependant une trentaine
d'autres textes, dit apocryphes, tel que l'évangile
de Marie-Madeleine, de Bartholomée ou encore
de Nicodème. Ils auraient été écartés
pour répondre aux besoins politiques de l'empereur
romain Constantin, le premier empereur chrétien.
-oOo-
Le mystère entourant le personnage
de Judas a encore de beaux jours devant lui. Dans un
thriller religieux écrit dans le sillage de l'annonce
de la découverte du fameux évangile gnostique,
Le testament de Judas (1994), Daniel Easterman
imagine la découverte d'un manuscrit de la main
authentique de Jésus, qui s'y révèle
avoir été un hassidéen nationaliste
juif fanatique. Cassant l'image que s'en était
formé le christianisme, sa publication causerait
un grave préjudice au Vatican. Services secrets
britanniques, soviétiques et... du Vatican vont
se livrer à d'étranges tractations pour
contrer une organisation ultra-catholique croate, Lux
Orientalis, liée aux néo-nazis...
Dans le registre cinématographique,
le personnage oscille entre le Judas de Cecil B. DeMille
(Le Roi des Rois, 1927), joué par Joseph
Schildkraut, qui apparaît comme un jeune publicain
athlétique, habillé à la grecque
et amant de la courtisane Marie de Magdala, et son exact
opposé du téléfilm de Charles Robert
Carner, Judas (EU, 2001), avec Johnathon Schaech
(Judas Iscariote) et Jonathan Scarfe (Jésus).
Dans ce second film, Judas est un nationaliste zélote,
pieux et intransigeant, qui un temps suit Jésus
avec qui il a de nombreux points communs, mais finalement
- déçu par son pacifisme - le trahit,
non pour s'enrichir, mais pour payer les funérailles
de sa mère ! (DVD Judas, Paramount Home
Entertainment, réf. 55762, VOSTNL.) A noter que
dans le Ponce Pilate italien de 1961, rapprochement
intéressant, Judas et Jésus étaient
interprétés par le même acteur :
John Drew Barrymore.
NOTES :
(1)
Chez Marc, le nom de Judas n'apparaît pas lors
de la Cène où Jésus désigne
celui qui le livrera. Pourtant Marc n'ignore pas le
rôle de Judas (Marc, 3 : 19; 14 : 10-11
et 43). Mais Matthieu est plus direct : «Le
Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit
de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils
de l'homme est livré ! Mieux vaudrait pour
cet homme qu'il ne fût pas né. Judas,
qui le livrait, prit la parole et dit : Est-ce
moi, Rabbi ? Jésus lui répondit :
Tu l'as dit» (Matthieu, 26 : 24-25;
cf. Jean, 13.2, 26-32).
Judas est désigné comme «traître»
(Luc, 6 : 16), «possédé
par Satan» (Luc, 22 : 3; Jean,
6 : 70-71 et 13 : 27), mais le baiser de Judas est
seulement dans Luc (Luc, 22 : 47-48). Selon
Jean, Judas, qui tenait les cordons de la bourse commune,
était un voleur (Jean, 12 : 4-6; 13
: 29). Mais Matthieu et Luc vont plus loin : cet homme
vénal livra Jésus «pour de l'argent»
(Luc, 22 : 4-5), «pour trente pièces»
précise le seul Matthieu (Matthieu,
27 : 3-6) (N.d.M.E.). - Retour
texte
(2)
Producteur exécutif chez RTL-TVI, si nous en
croyons IMDb. - Retour texte
|
| |
| |
|
|

|

|
|