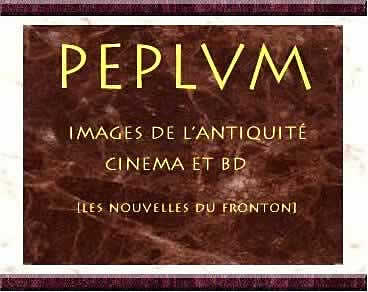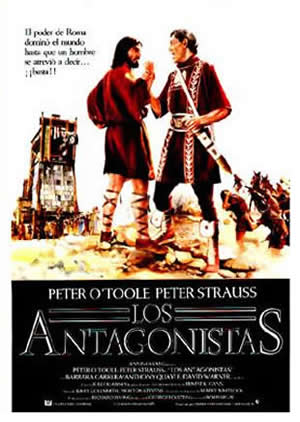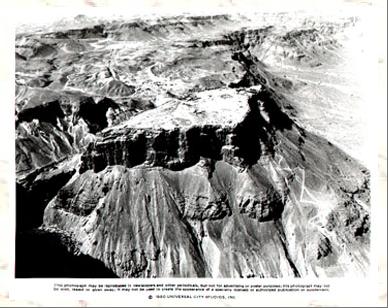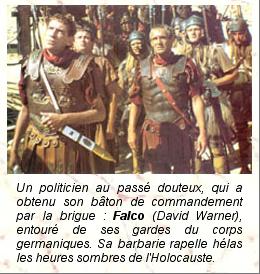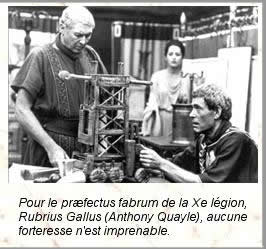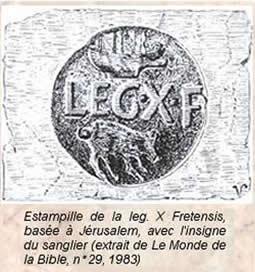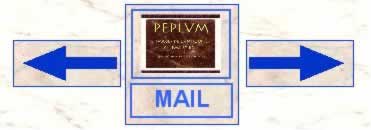| 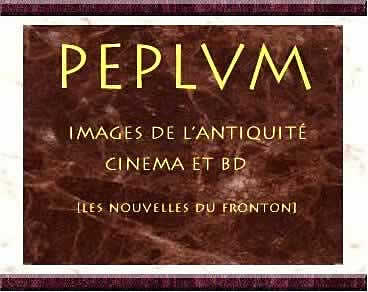
| |
Masada
(Les Antagonistes, Boris
Sagal, 1980) |
Peut-être parce que à l'origine
tourné pour la télévision, Masada (sur
le grand écran : Les Antagonistes) reste un péplum
fort injustement oublié des cinéphiles. A l'aube des
Eighties - et alors que le sulfureux Caligula
de Tinto Brass et Bob Guccione générait une prolifique
série de péplums érotiques graveleux - Masada
fut pourtant le film qui laissa présager un retour du péplum
(il allait être suivi d'Anno Domini (Stuart Cooper,
1984-1985), Les Derniers Jours de Pompéi (Peter Hunt,
1984) et Quo Vadis (Franco Rossi, 1984)).
Saluons l'extraordinaire performance d'acteur de Peter O'Toole dans
le rôle de Flavius Silva, le général dégoûté
par la guerre (1),
et aussi de ces merveilleuses "gueules britanniques" : Anthony Quayle,
Jack Watson... rien de changé sous le soleil, dans le cinéma
américain ce seront toujours les roatsbeefs qui tiendront
les rôles de Romains !
Américain ou non, tout péplum qui se respecte se doit
d'avoir au moins un clou, une scène spectaculaire. Au cours
du siège de Masada (ou Massada), les Romains réalisèrent
en plein désert des travaux de siège spectaculaires,
construisant une rampe d'assaut que le visiteur peut encore voir
aujourd'hui, sur laquelle ils firent avancer une tour roulante.
Le péplum poliorcétique (art des travaux de siège)
était né !
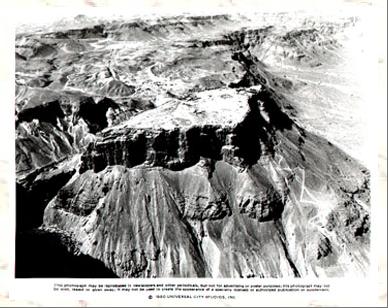
|
Vue aérienne du plateau de Masada.
Vers le coin inférieur droit, la mer Morte (pas
sur la photo), que la forteresse domine de ses quelque
400 m. Dans le coin supérieur gauche, le plateau
du désert de Judée, derrière lequel
se couche le soleil. Un ravin profond de 80 m sépare
la forteresse hérodienne du principal des huit
camps établis par la Xe Légion. C'est
là que Silva construira sa rampe d'assaut, toujours
visible de nos jours. |
|
Lutter contre
toutes les oppressions
Haut lieu du patriotisme israélien depuis la fin
des années '50 (fouilles de Y. Yadin en 1958), c'est à
Masada que, chaque année, la nouvelle promotion d'officiers de
chars vient prêter le serment qu'"il n'y aura jamais plus de
Masada" pour Israël (2).
Peter O'Toole déclarera qu'il avait accepté le rôle
de Flavius Silva, commandant de la Xe Légion, "parce que cette
histoire reste actuelle : une armée dégoûtée,
qui se demande ce qu'elle fait là, à massacrer des malheureux,
un peu comme les Américains dans le bourbier du Viêt-nam".
Pour certains, ce film, en 1981,
inverserait l'histoire : Les Antagonistes seraient Israël
et sa puissance redoutable broyant aujourd'hui les résistants
palestiniens, comme il y a deux mille ans Rome l'avait fait des
Zélotes qui osaient lui tenir tête. Il y a entre
Silva et les allégations de Peter O'Toole sur les Américains
lassés par le bourbier vietnamien, une marge. Et ses considérations
ne sont valables que pour le personnage de Silva, qu'il incarne,
même si au début les mutins de la Xe Légion
désirent avant tout rentrer chez eux, en Italie. Qu'on
n'y prenne garde : Flavius Silva, l'agresseur romain, pourrait
tout aussi bien incarner le monde arabe, avec ses pétrodollars
et sa multitude démographique, prêt à fondre
sur Ezret-Israël qu'il entoure de toutes parts comme jadis
l'Empire romain.
Vraiment, dans le film, l'oppresseur romain peut être qui
l'on veut, en fonction de nos antipathies personnelles. Ainsi
il y a dans d'antagonisme opposant Silva à son collègue
Falco, le fanatique entouré de ses gardes du corps germaniques,
un petit relent de ces relations opposant les officiers de la
Wehrmacht et ceux des Waffen-SS dans les films de guerre américains
- en particulier lorsque Falco exécute ses otages juifs
en les utilisant comme projectiles de catapulte, scène
particulièrement odieuse qui révolte les légionnaires
eux-mêmes. (3)
Devant eux, les nouveaux Eléazar (athée dans le
film... c'est un comble pour un Zélote de 73 de n.E.(4),
que le scénario semble confondre avec les "Sicaires" [5])
n'ont d'autre choix que de combattre... ou de se condamner au
suicide. Avouons notre scepticisme lorsque Peter O'Toole/Flavius
Silva, à la fin du film, affirme devant les corps de ses
ennemis, que s'ils avaient consentis à se rendre et à
négocier, ils n'auraient pas été suppliciés
ou massacrés. Combien des 600.000 Juifs de Jérusalem,
trois ans auparavant, survécurent au siège du, pourtant,
"bienveillant" Titus - celui qu'on surnommera "Les délices
du genre humain" ? |
|
Mais le cinéma est avant tout un spectacle. Et
le clou de ce spectacle, c'est l'attaque de la tour roulante. C'est
peut-être bien elle, d'ailleurs, la véritable héroïne
de ce film qui reste à ce jour le seul à avoir montré
la poliorcétique romaine en action...
Avec des lacunes toutefois, comme celle qui consiste à éluder
le fait que les Romains avaient bâti cinq camps autour de la forteresse,
et des ouvrages de circonvallation. Tout comme est éludé
le fait qu'il y eut cinq survivants juifs à Masada (deux femmes
et trois enfants) et deux ou trois petits détails techniques
: pourquoi l'aigle légionnaire précède-t-il un
convoi d'esclaves ?... Les Romains démontaient leurs catapultes
pour les transporter, au contraire de ce qu'on voit dans le film, etc.

|
Pour
rester bien droite en terrain plat comme sur une surface
déclive, la tour roulante imaginée par Rubrius
Gallus est montée sur une crémallière
(les deux cylindres dentés, à l'arrière)
qui permet d'en corriger l'inclinaison. Hypothèse
intéressante. |
|
A. Le roman d'E.K. Gann
1. "Silva contemplait la rampe
et parvenait à peine à se convaincre qu'il était
responsable de sa construction. Débarrassée des ouvriers,
des machines, des animaux, des outils qui l'avaient encombrée,
elle paraissait plus gigantesque et elle produisait un stupéfiant
effet : on eut dit non une création humaine mais une capricieuse
excroissance terrestre. Elle s'élevait, telle une énorme
épaule qui eût soutenu le rocher de Massada, tel un blanc
monument aveuglant sous le soleil, et Silva sentit la nécessité
d'exprimer son admiration : « Notre ami [Rubrius] Gallus,
dit-il à son état-major, a eu l'audace d'attacher
son nez sur le visage de la terre. »"
[Description de l'arrivée des contingents envoyés
des différents camps autour de Masada. Les légionnaires
des 3e et 5e cohortes sont affectés à aider les pionniers,
comme simples manœuvres.]
2. (...) "La tour d'assaut avait
été amenée au pied de la rampe avant même
l'achèvement des travaux. A présent, sous l'œil vigilant
de Rubrius Gallus, les soldats inspectaient une dernière fois
les treuils, les cordes, les palans. La rampe était très
raide et la tour extrêmement pesante. Il fallait qu'elle arrive
à destination, intacte et en temps voulu."
3. "Le bélier reposait
sur un véhicule à part, qui serait hissé sur la
rampe après la tour. C'était l'engin le plus long et le
plus lourd que les légionnaires aient jamais vu dans la guerre,
mais à l'extrémité du pilon manquait la tête
de bélier traditionnelle. Aucun forgeron de Palestine n'aurait
été capable d'exécuter un tel travail et les soldats
avaient protégé le bois par une calotte de fer. Silva
s'émerveillait en secret de la confiance que montrait Gallus.
Le tribun avait en effet proclamé que le madrier glisserait sans
aucune difficulté. « Une fois que nous aurons déterminé
le centre des oscillations, nous ajusterons les frondes en conséquence,
Seigneur. Après, même un petit enfant pourra le faire balancer
en lui imprimant une poussée régulière. (...)
»"
4. (...) "Cinquante archers arabes
avaient été choisis parmi les plus experts pour occuper
le sommet de la tour que recouvraient des plaques de fer. Si les calculs
de Gallus étaient corrects - et Silva n'avait jamais vu Gallus
se tromper - deux heures après s'être mise en route, la
tour serait parvenue à la moitié de la rampe. Les archers
seraient alors à distance convenable des remparts et auraient
le soleil dans le dos. Puis, à mesure que la tour monterait,
le soleil déclinerait. Ainsi, si tout se passait comme prévu,
les Juifs seraient éblouis durant la deuxième phase de
l'ascension de l'engin, c'est-à-dire durant la phase où
ils auraient pu se défendre sérieusement."
5. (...) "En avril, le jour durait
treize heures et demie et la nuit dix et demie. L'attaque devant partir
de l'ouest, pourquoi [avait suggéré Silva]
ne pas incliner la rampe de manière à profiter des
avantages offerts par le couchant ? L'air malheureux, Gallus avait calculé
qu'il y aurait des complications, mais il avait calculé les azimuts
et les altitudes du soleil à l'époque où, selon
ses dires, l'ouvrage serait terminé et il avait conclu qu'en
faisant obliquer légèrement la rampe vers le nord, le
soleil frapperait droit en son centre. De ce fait, avant même
la fin des travaux, les deux hommes connaissaient approximativement
la date et l'heure de l'attaque. (...) Au pied de la rampe, derrière
la tour, étaient rangées deux tortues de siège.
Chaque carapace cachait une catapulte manœuvrée par les
légionnaires de la cinquième cohorte. Leurs munitions
avaient déjà été entreposées sur
deux plates-formes aménagées de chaque côté
de la rampe à une certaine distance, soigneusement calculée,
de la tour. Ces deux plates-formes, pensait-on, étaient suffisamment
éloignées de la rampe pour échapper aux tirs directs
venus de Massada et suffisamment proches pour protéger les flancs
de la précieuse tour. Les tortues étaient défendues
par des frondeurs des Baléares qui devraient combattre à
découvert. Silva n'espérait pas en revoir beaucoup en
vie.
Soudain, il s'étonna qu'un simple ordre de sa part ait rassemblé
une telle multitude (15.000 esclaves juifs et 5.000 soldats)."
[Suit la description de l'assaut : faute de place sur la rampe,
une grande partie de l'armée romaine ne pourra y participer.
"Deux cohortes de la IIe et de la IVe (6)"
conduiront l'assaut. Disciplinées, elles se sont longuement entraînées,
sur un simulacre de tour, à franchir en armes la brèche
ouverte par le bélier. Les hommes avancent en quinconce, à
trois pieds l'un de l'autre, pour ne pas offrir une cible trop compacte
à la défense ennemie. Deux mille esclaves halent la tour,
cent le bélier et autant chacune des deux catapultes, bientôt
rejointes par 50 hommes de renfort. Mais le vent du sud se lève
et noie dans des tourbillons de poussière les hommes sur la rampe,
ce qui les gêne considérablement - mais aussi rend difficile
la riposte des Zélotes, l'écran de poussière les
empêchant de localiser les tireurs ennemis...]
6.
(...) "Le tribun Gallus connaissait les limites de l'endurance
humaine; il avait recommandé que, quatre fois par heure,
les cordes soient arrimées et que soit accordé un
repos aux Juifs. Alors tous se lamentaient et quelques-uns sanglotaient
avec désespoir. Et puis venait le moment où les
soldats inspectaient les rangs des manœuvres et emportaient
ceux que l'épuisement avait terrassés ou qui étaient
à l'agonie. Ils jetaient les cadavres de part et d'autre
de la rampe et les regardaient bondir et rebondir sur les rochers
avant de s'écraser, désarticulés, dans le
wadi."
7. (...) "Le tribun Rubrius
Gallus n'avait jamais connu une telle satisfaction. Tous ses doutes
secrets s'évanouissaient les uns après les autres.
Non seulement la rampe avait été terminée
en temps voulu mais elle avait l'exacte inclinaison qu'il avait
calculée six mois auparavant. Il savait depuis toujours
qu'une erreur de deux degrés dans son élévation
aurait soulevé un nombre infini de problèmes, dont
certains insolubles. Avec une élévation trop raide,
le poids apparent de la tour aurait été porté
à la puissance deux ou à la puissance trois. Une
surface trop molle aurait eu le même effet. Dans les deux
cas, il aurait fallu augmenter le contingent de Juifs attelés
aux cordes et il était évident que la rampe n'aurait
pu contenir autant de monde. De même, il aurait fallu changer
le diamètre des cordes et des poulies destinées
à guider et à multiplier la force des Juifs. Mais
où diable trouver de plus grosses cordes et de plus fortes
poulies ?"
[Rubrius Gallus s'active, suit la tour en mouvement,
vérifie chaque cordage, le graissage de chaque poulie,
supervise les manœuvres, garde l'œil sur la position
du soleil... et - une saute de vent dispersant soudain l'écran
de poussière - prend une flèche juive dans la nuque
! La tour arrivée en haut de la rampe, le bélier
enfonce le mur de pierre, mais les Zélotes ont procédé
à une contre-mesure, un mur de bois qui absorbe les coups
de boutoirs, sans céder.]
Ernest K. GANN, Duel à Massada (7)
|
|
B. Le film de Boris Sagal
La rampe
Le "morceau de bravoure" du film comme de la série TV est,
assurément, la construction de la rampe d'assaut et de la tour
roulante par les Romains. Alternant les images de travaux avec les monologues
de Rubrius Gallus, la guerre poliorcétique en est un ressort
au même titre que les relations conflictuelles Silva-Eléazar
ou Silva-Sheeva. C'est elle qui, du reste, imprime son rythme au film,
véritable métronome mesurant le temps imparti à
Silva pour remplir la mission que Vespasien lui a confiée, cependant
qu'un chevalier minable, ancien prêteur sur gages devenu général
d'opérette à la cruauté sans borne, l'intrigant
courtisan Pomponius Falco, attend son heure tout en chronométrant
l'avancée des travaux obsidionaux...
En -52 à Avaricum (Bourges), comme en +70 à
Jérusalem, les Romains ont montré leur compétence
dans l'art des sièges. Il ne fallut que 25 jours aux légionnaires
de César pour construire un agger, une terrasse de vingt-quatre
mètres de haut, longue de 75 m et large de... 100 m, sur lequel
circulaient deux tours roulantes et quantité de catapultes en
tous genres. Il était fait de poutres entrecroisées que,
du reste, les sapeurs gaulois tenteront d'incendier. De grandes quantités
de bois étaient bien entendu nécessaires pour ce genre
de travaux et Flavius Josèphe, retraçant les opérations
qui furent menées devant Jérusalem, rapporte qu'il ne
resta bientôt plus un seul arbre debout dans un rayon de 25 km
autour de la ville. Le même Josèphe, notre unique source
relativement au siège de Masada, décrit la rampe d'assaut
construite par les Romains en +73, encore visible de nos jours, plutôt
que la tour elle-même dont il précise cependant la hauteur
: 30 m. Ygaël Yadin nous confirme les dimensions de cette rampe
construite à l'ouest de la forteresse, adossée aux contreforts
du plateau du désert de Judée où les murs de Masada
n'étaient qu'à 80 m de hauteur (contre 400 m à
l'est, du côté de la route qui longe la mer Morte). Cette
rampe mesurait (et mesure encore [8])
210 m de long et monte à une hauteur de 60 m. Les vingt derniers
mètres étant obtenus par la hauteur de la tour, qui donc
devait surplomber les défenses ennemies de 5 à 10 m -
le bélier se positionnant aux 2/3 de sa hauteur.
La plupart des schémas d'ouvrages poliorcétiques
que l'on peut voir dans les ouvrages d'histoire militaire, nous révèlent
des rampes d'assaut relativement raides mais sur lesquelles ne montent
que des béliers sous leur tortue de protection (p. ex. à
Platées, en 429-427 av. n.E.) ou relativement horizontales (Avaricum),
dans lequel cas on peut constater la présence de tours roulantes.
Voulant illustrer la sauvagerie et la brutalité des "Hommes du
Nord", R. Fleischer, dans Les Vikings, recourt à une mise
en scène sans temps mort, servie par un montage serré,
dynamique. A peine les Vikings ont-ils débarqué de leurs
drakkars que les voici halant à toute allure leur bélier,
un énorme tronc d'arbre monté sur roues. D'un seul mouvement,
il percute la porte du fort anglais, qui vole en éclats, cependant
que déjà les attaquants courent dessus - l'utilisant comme
pont jeté sur l'abîme d'un insondable fossé. Mais
le visiteur de Fort-La-Latte - où le film fut tourné -
s'aperçoit vite de l'impossibilité de cette scène
: l'accès à la porte du château se fait par un petit
sentier tortueux où il ne saurait être question de faire
dévaler à toute allure un tronc de plus de dix mètres
de long. Les planches pédagogiques ont coutume de nous montrer
antiques hélépoles ou beffrois médiévaux
évoluant sur des terrains planes - ainsi les dessins de Viollet-le-Duc
illustrant le siège de la Roche-Pont - alors que l'intérêt
même des occupants du château était de laisser et
même de renforcer les accidents de terrain.
Laborieux et méthodiques, les Romains sont le contraire
des barbares vikings. Les Antagonistes (le film) exploite ces
connotations : par leur industrie, les légionnaires viendront
à bout de toutes les difficultés. Pourtant l'épisode
historique de Masada est loin d'être le chef d'œuvre absolu
de la poliorcétique antique. Les tours d'assaut de Marcellus
(9) venant battre les
murs de l'Akradinè montées sur des sambuques (c'est-à-dire
deux galères accolées), c'était déjà
un bel exploit, mais un exploit sanctionné par l'échec
des Romains (siège de Syracuse, en -212). Autrement plus fort
fut Alexandre le Grand qui, assiégeant Tyr (10),
fit construire sa rampe d'assaut non pas dans le désert comme
Silva, mais dans la mer. La digue d'Alexandre consistait en une chaussée
mesurant 740 m de long sur 60 m de large et avait été
construite en eaux peu profondes avec des matériaux arrachés
au "Vieux Tyr", sous les contre-attaques permanentes des défenseurs
(DIODORE, XVII, 40); aux abords de l'objectif, c'est-à-dire à
l'endroit le plus profond, la profondeur atteignait 10 m (ARRIEN, II,
18). Quant aux proportions de la tour, celle de Masada était
tout ce qu'il y a de "bas de gamme" au regard des recommandations de
Diadès, cité par Vitruve, selon qui une tour doit mesurer
au moins trente mètres; avec ses ±43 m, celle de Démétrios
le Poliorcète, était sensiblement plus impressionnante
(11) ! (Siège
de Rhodes, en 305-304 - nous y reviendrons.)
Le cas de Masada ne devait pas présenter de difficultés
insurmontables, si ce n'est l'éloignement de toutes sources d'approvisionnement
(bois, blindages de fer), en plein désert. Si l'on considère
la rampe comme un triangle rectangle de 210 m d'hypoténuse sur
60 m de petit côté on obtient un angle de 16°, pratiquement
insurmontable. Mais l'angle de la rampe, qui par illusion d'optique
paraît plus raide encore sur les photos comme dans le film, était
en réalité beaucoup moins incliné car, descendant
en pente vers le piton, le terrain permettait donc aux Romains de partir
d'un peu plus haut. Si l'on en croit Rubrius Gallus (personnage fictif
du film), dans le troisième épisode, la rampe faisait
10° - et l'ingénieur militaire d'insister : une erreur de
seulement deux degrés supplémentaires augmenterait encore
le poids de la tour à un point tel que "les cordes dont nous
disposons" (12)
seraient insuffisantes pour la hisser jusqu'en haut. (Ces précisions
étant extrapolées du roman d'E.K. Gann - voir Le Roman
d'E.K. Gann, 7. ci-dessus).
Vitruve (13),
nous a laissé une description sommaire des tours roulantes de
son temps (X, 13) - hauteur minimum : 30 mètres, largeur : 8,5
mètres -, elles vont en se rétrécissant (la largeur
en haut doit faire 1/5 de moins qu'à la base). Une tour de 40
m de haut et 11,75 m de large aura dix étages (chaque étage
mesurant de 3 à 4 m de haut), mais on peut aller jusqu'à
vingt étages. Plus loin (X, 16), Vitruve nous décrit le
géant absolu des "preneuses de ville" (hélépole),
déjà évoquée ci-dessus, que construisit
l'Athénien Epimaque pour Démétrius le Poliorcète
lors du siège de Rhodes (14)
: haute d'une quarantaine de mètres sur vingt de long, elle pesait
163.080 kg et son blindage de cuirs fraîchement écorchés
était à l'épreuve des pierres de balistes de 150
kg. Plusieurs auteurs (Diodore, Plutarque et Athénée)
ont également parlé de cette fameuse tour qui n'était
pas un engin d'assaut à passerelle volante et/ou bélier,
mais plutôt une casemate ambulante garnie de toute une batterie
de catapultes. John Warry (15)
en propose une reconstitution basée notamment sur la description
de Diodore : elle peut se mouvoir en tous sens et est propulsée
par 200 hommes qui, à l'étage inférieur, actionnent
de l'intérieur un cabestan qui met en mouvement ses quatre paires
de roues de 4,6 m de diamètre chacune; mais elle recevait également
le concours de 3.200 pousseurs extérieurs.
Pour la petite histoire, signalons que l'ingénieur Diognète,
qui assurait la défense de la ville, exécuta la contre-mesure
suivante : détournant des canalisations d'eau, il inonda la plaine
où l'hélépole s'embourba. Démétrius
rembarqua, abandonnant son matériel de siège dont le produit
de la vente rapporta trois cents talents de fer et cinq cents talents
de bronze qui servirent à la construction du fameux Colosse -
une des Sept Merveilles du Monde -, œuvre du sculpteur Charès
de Lindos commémorant la victoire des Rhodiens. L'hélépole
aurait servi d'échafaudage pour la construction de cette effigie
du dieu soleil, haute de 30 m.
Avec ses trente mètres de haut, la tour utilisée
à Masada était d'un modèle plus petit : une vingtaine
de mètres lui suffisait pour arriver au niveau des murs, les
dix mètres supplémentaires devant dominer le plateau fortifié,
y compris le mur défensif, pour permettre aux archers mercenaires
de tenir l'ennemi en respect. Une première particularité
peut être déduite de la configuration du terrain : le bélier,
au lieu de se trouver au rez-de-chaussée ou au premier étage
comme ce devait être le cas le plus souvent, devait avoir été
placé aux 2/3. Le film place le bélier tout en haut de
la tour, à l'avant dernier étage, ce qui fait préciser
par Rubrius Gallus que si le bélier, d'abord positionné
à 19 pieds (16)
(5,70 m), est relevé de 8 pieds encore (2,40 m) - et, sur le
modèle réduit, on le voit rapprocher la poutre ferrée
du sommet de la potence où elle se balance - on diminuera d'autant
la hauteur de la rampe qui reste à élever et, ainsi, économiser
8 jours de travail. Dans la logique du film, l'argument est imparable,
puisque le scénario implique que Flavius Silva, devant sous le
délai d'un mois ramener ses troupes à Césarée
en vue d'aller combattre sur le Danube où l'empereur Vespasien
souhaitait les engager, est pressé par le temps. Au juste, on
ne sait trop quelle valeur accorder aux détails techniques que
révèle fort parcimonieusement le dialogue - presque tous
sont inspirés (mais inspirés seulement) - par le
roman d'E.K. Gann. Le spectateur est seulement prié de comprendre
que l'ingénieur romain se livre à des calculs fort
précis pour obtenir un maximum de résultats en économisant
ses moyens. Point, à la ligne.
Ainsi, ce Romain avisé a même calculé
que l'attaque devra être déclenchée le douzième
jour du mois prochain, six heures après l'aurore, car à
ce moment précis et pendant deux heures (voir Le Roman d'E.K.
Gann, 5. [et 4.]
ci-dessus - mais ces précisions ne sont pas dans le téléfilm),
les Zélotes auront le soleil dans les yeux (selon Josèphe,
Masada tomba pendant le printemps 73, le 15e jour du mois de nissan
(avril)). Le Romain médite donc - toujours selon l'exposé
du film - son attaque contre l'escarpement ouest au début de
l'après-midi, lorsque amorçant sa courbe descendante,
le soleil a dépassé la verticale des Zélotes dans
le dos desquels il s'était d'abord élevé, pour
passer derrière la tête des Romains qui leur font
face et, en deux heures, glisser derrière les crêtes bornant
à l'occident le désert de Judée dont le plateau
domine la dépression de la mer Morte...
La tour roulante du film
Ygaël Yadin décrit en deux pages la rampe édifiée
par les Romains, mais ne consacre pas la moindre ligne à la tour
roulante qui l'escalada (17).
Aucun article consulté par nous ne lui prête intérêt
et même le roman d'Ernest K. Gann, dont le scénario du
film est tiré, ne la décrit pas de manière précise,
se bornant à nous laisser voir la rampe d'assaut et le personnel
qui la servit. Quant au roman que consacrera à Masada l'archéologue
Guy Rachet, il s'y intéressera moins encore. Gageons que cette
problématique de la tour roulante ne s'est incorporée
à l'intrigue des Antagonistes que parce que les cinéastes
se trouvèrent dans l'obligation de la reconstituer matériellement,
de lui donner corps. Et de trouver des solutions.
Dans le film, la tour de Rubrius Gallus n'a pas la mobilité
de celle de Démétrius le Poliorcète, qui peut bifurquer
à sa guise : conçue pour grimper la pente, elle ne peut
même pas reculer... Le problème de l'inclinaison de la
rampe à 10° a suggéré au cinéaste une
solution originale, dont nous n'avons d'exemple nulle part ailleurs
: la tour est montée sur crémaillère. Seul
le train des roues épouse l'inclinaison de la rampe - mais la
tour elle-même demeure bien verticale, son assiette étant
compensée d'autant à l'arrière. En cela, vraiment,
le film de Boris Sagal procède de l'archéologie expérimentale...
Appendice : La Xe Légion
Au Ier s. de n.E., deux légions bien distinctes
portèrent le numéro dix : la X Fretensis (celle
dont il est question dans Masada/Les Antagonistes) et la X
Gemina, héritières probablement de cette Xe légion
de Jules César (SUÉT., Cæs., 70), la toute
première engagée dans la conquête de la Gaule, pour
refouler les Helvètes, dont il fera sa "cohorte prétorienne".
C'est l'aquilifère (porteur de l'aigle) de la Xe légion
qui, en Grande-Bretagne, montrant l'exemple à ses camarades hésitants,
débarqua le premier au risque de voir l'aigle tomber entre les
mains des Bretons (B.G., IV, 25). Elle est également connue
pour son rôle dans la
mutinerie de 47, contre Jules César, épisode qui a
sans doute inspiré celle du film, mais dont Flavius Josèphe
n'a jamais parlé !
Le grand épigraphiste R. Cagnat (18)
en a esquissé les "biographies" :
-
Legio X Fretensis. Insigne : Taureau,
sanglier (galère). - Aurait combattu, d'après
M. Mommsen, dans la guerre de Sicile contre Sextus Pompée
et aurait tiré son nom de Fretensis du fait
qu'elle aurait eu son camp pendant plusieurs années
sur le rivage du Fretum Siculum ( 19)
: c'est pour cela que certains monuments figurés relatifs
à cette légion portent l'image d'un Neptune,
ou d'une galère. Elle fut envoyée par Auguste
en Syrie. Sous Tibère, en 18, son camp était
à Cyrrhus ( 20).
Son histoire jusqu'en 59 se confond avec celle de la VI
Ferrata. A cette date, Corbulon l'emmena contre les Parthes
et les Arméniens, d'où elle revint à
Cyrrhus. Après avoir calmé la révolte
des Juifs d'Alexandrie, unie à la légion V
Macedonica, elle allait avoir à se mesurer de nouveau
avec eux, dans leur pays même, en Judée. Titus
l'amena, en effet, en 67 à son père Vespasien;
le légat de la légion était alors Trajan,
le [père du] futur empereur. Elle prit part à
la plupart des opérations qui marquèrent la
guerre (prise de Japhta, de Tibériade, de Taricheæ,
de Gamala), jusqu'au jour où Titus l'emmena faire de
siège de Jérusalem; elle établit son
camp sur la montagne des Oliviers. Elle commença par
plier par deux fois devant l'attaque des Juifs; mais elle
se ressaisit bientôt et déploya une grande valeur
dans l'attaque même de la place. Quelques-uns de ses
officiers, et en particulier son légat Larcius Lepidus,
reçurent à l'occasion de cette guerre des décorations
militaires. Le siège terminé, elle demeura campée
aux portes de Jérusalem. De là elle fit encore
quelques opérations, sous Lucilius Bassus, contre la
ville de Machærus, sous Flavius Silva, contre Masada.
Mais son siège était toujours Jérusalem,
comme le prouvent les briques estampillées que l'on
a découvertes autour de cette ville, et des inscriptions
du IIe et du IIIe siècle, de même provenance.
C'est de Judée que partit le détachement qu'elle
envoya, sous le règne de Trajan, contre les Parthes.
Elle prit naturellement une grande part à la guerre
de l'empereur Hadrien contre les Juifs; nous avons, sur une
inscription, le nom d'un de ses centurions qui reçut,
à la suite de la victoire, des récompenses honorifiques.
Dion Cassius lui donne pour province la Palestine. Elle y
séjournait encore au temps de la Notice; son camp était
à Aila (Elath, sur la mer Rouge).
Son nom figure sur les monnaies de Victorin.
-
Legio X Gemina. Insigne : Taureau.
- Légion qui est peut-être la même de la
Xe légion de César, mais qui en tout cas, a
appartenu à l'armée de Lépide ou d'Antoine,
sans qu'il soit possible de décider sous lequel des
deux elle servait. Son surnom fait supposer qu'elle fut formée
par la fusion de deux légions en une.
Lors de sa réorganisation par Auguste, elle fut établie
en Espagne où elle demeura pendant une centaine d'années.
En 69, au dire de Tacite, elle fut sur le point de passer
en Maurétanie pour combattre la révolte du procurateur
Lucceius Albinus; mais la mort de ce gouverneur rendit son
intervention inutile. Après Crémone, de même
que les autres légions d'Espagne, elle reconnut sans
retard Vespasien. On ne sait pas au juste où elle était
fixée pendant cette période; peut-être
partageait-elle le camp de la légion VI Victrix.
En 70, elle fut appelée en Germanie Inférieure.
Elle y figure sur des inscriptions qui datent de la fin du
Ier siècle ou du commencement du IIe. Il semble qu'elle
ait campé d'abord à Arenacum ( 21);
mais bientôt elle se transporta à Noviomagum
( 22), où
elle remplaça la IIe légion. On y a trouvé
le nombreux témoins de son séjour, inscriptions
ou briques estampillées. Sauf la part qu'elle prit
aux combats livrés par Cerialis, on ne peut pas affirmer
qu'elle ait, pendant son séjour en Germanie, fait quelque
expédition sur les confins du Rhin ou ailleurs. Au
moment des guerres Daciques de Trajan, elle était encore
dans la province. Elle passa de là en Pannonie, sous
Trajan, et se fixa dans le camp de Vindobona ( 23),
abandonné par la légion XIII Gemina.
Elle y resta jusqu'à la fin de l'Empire. C'est de là
qu'elle envoya des détachements pour la guerre Parthique
de L. Verus en Asie et pour celle des Marcomans. Plus tard
elle défendit la cause de Gallien. On sait également
qu'elle se conduisit valeureusement pendant la guerre Gothique
de l'empereur Claude II.
La Notice des Dignités nous montre la légion
X Gemina divisée en trois parties : le dépôt
à Vindobona, des liburnarii à Arradona,
et un détachement devenu legio comitatensis
en Orient.
Cette légion reçut les surnoms de Pia Fidelis,
en récompense de la fidélité dont elle
fit preuve lors de la révolte d'Antonius Saturninus
en 89.
On n'a point rencontré son nom sur les monnaies de
Septime Sévère; M. Ritterling admet, cependant,
qu'elle fut des premières à saluer le nouvel
empereur et à combattre pour lui : il n'y aurait, dans
cette absence de documents, qu'un effet du hasard.
|
La réforme des légions sous le Principat
C'est Auguste qui réforma l'armée romaine qu'il constitua
en 25 légions (soit 150.000 hommes et à-peu-près
autant de troupes auxiliaires), en fait 28 avec les XVII, XVIII et XIX,
massacrées par Arminius en +9 et qui ne furent jamais reconstituées.
Elles étaient numérotées de I à
XXII, et non jusqu'à XXV ou XXVIII, car plusieurs se partageaient
le même numéro : il y avait trois III (Augusta, Cyrenaica
et Gallica), deux IIII (Macedonica et Scythica),
deux V (Alaudæ et Macedonica), deux VI (Ferrata
et Victrix) et deux X (Fretensis et Gemina).
J'ignore la raison de ces dédoublements, mais si
je puis me permettre une hypothèse personnelle : j'attribuerais
ces doublets au fait que les triumvirs Octave, Antoine et Lépide
prenant possession des légions de l'armée de Jules César,
qui à la fin de la guerre civile étaient bien plus que
dix, se seraient partagé des contingents de certaines d'entre
elles, qui servirent de noyau à de nouvelles légions envoyées
en Orient ou demeurant en Occident. Chaque légion ayant un génie
propre incarné par l'aigle légionnaire, l'ancienne numérotation
fut conservée telle quelle, peut-être par respect religieux
ou superstitieux (ce qui n'avait pas empêché César
de reconstituer la XIV exterminée à l'Atuatuca, en 54
- toutefois ceci n'exclut pas cela, il se peut qu'ayant préservé
l'essentiel de la XIV, son aigle par exemple, le grand Jules pouvait
se permettre cette résurrection).
Après Dioclétien, on verra du reste ces numérotations
se démultiplier à nouveau, chaque ancienne légion
en générant plusieurs nouvelles (R. Cagnat dénombre
alors dix-huit légions I, onze II, six III etc.).
Suite...
NOTES :
(1) Flavius Josèphe,
notre unique source sur le siège de Massada est muet
quant aux éventuels états d'âme de Silva.
Du reste, la mutinerie de la Xe Légion - qui en réalité
eut lieu 117 ans plus tôt, contre Jules César (en
47) - portait sur des questions de solde et d'inactivité.
Pour les en punir, justement, César fit mine de vouloir
licencier
la Xe et de renvoyer les légionnaires "dans leurs foyers".
La solde et le butin, c'est le gagne-pain, la raison d'être
du soldat professionnel.
Exactement le contraire de ce que raconte le film en montrant
la troupe, lasse de faire la guerre, désireuse d'être
rapatriée en Italie ! L'allusion au mal-être des
GI's engagés au Viêt-nam est évidente, mais
sa transposition dans l'Antiquité abusive ! - Retour
texte
(2) On voit cette cérémonie
contemporaine rajoutée à la version diffusée
sur FR3 en 1997; ces plans faisaient défaut dans celle
exploitée par A2 en 1983. - Retour
texte
(3) Ces légionnaires
qui, quelques semaines plus tôt encore, crucifiaient allégrement
zélotes ou sicaires par centaines. Mais c'était
hors le champ de la caméra ! - Retour
texte
(4) Eléazar n'a
perdu la foi que du fait qu'il a vu le Temple brûler,
chose impensable, inouïe ! - Retour
texte
(5) Les "Zélotes"
(les zélés, les pieux) sont des
intégristes religieux. Les Sicaires, pour leur part,
sont des résistants armés... et parfois des bandits
de grand chemin sans foi ni loi (de sica, "couteau").
- Retour texte
(6) Faut-il conjecturer,
ici "légion" ("cohortes de la IIe et de la IVe légion"),
puisque le texte français indique bien "cohortes"...
? En fait, E.K. Gann insiste bien, un peu plus loin, sur le
fait que c'est la Xe légion qui attaque sur la rampe.
Deux cohortes, soit 1.000/1.200 hommes, c'est beaucoup trop
de monde... Il conviendrait sans doute mieux de lire "deux manipules
de la IIe et de la IVe cohorte" ! - Retour
texte
(7) Ernest K. GANN, Duel
à Massada (The Antagonists, 1970), Stock, 1971 -
rééd. Massada, J'ai lu, n° 1303, 1982,
pp. 291-315. - Retour texte
(8) Yigaël YADIN,
Masada - La dernière citadelle d'Israël (1966),
Jérusalem, Steimatzky's Agency Ltd, 1973, p. 226. - Retour
texte
(9) POLYBE, VIII, 3-7;
TITE-LIVE, XXIV, 33-35; XXV, 23-27; PLUTARQUE, Vie de Marcellus,
13-19. - Retour texte
(10) DIODORE DE SICILE,
XVII, 40-46; ARRIEN, II, 18-24; QUINTE-CURCE, IV, 2-4. - Retour
texte
(11) Pierre DUCREY,
Guerre et guerriers dans la Grèce antique, Fribourg,
Office du Livre, 1985, p. 175. - Retour
texte
(12) Un peu avant cette
déclaration, dans le même épisode VF, Rubrius
Gallus parle de deux cordes de 1.700 pieds (561 m) chacune"nécessaires
pour actionner le bélier" - en fait, pour
haler la tour porteuse du bélier !
A l'abri de mantelets, deux poulies placées en haut de
l'ouvrage permettent aux esclaves de hisser la tour tout en
restant en retrait derrière elle. Ces haleurs peuvent
éventuellement s'abriter derrière les boucliers
des troupes d'assaut qui, elles aussi, suivent à pied
le "blindé" - lequel ne contient, à l'étage
supérieur, qu'une poignée d'archers syriens chargés
d'en assurer la protection rapprochée, conjointement
au tir des catapultes dont la mission est de tenir en respect
les assiégés qui voudraient riposter. - Retour
texte
(13) VITRUVE, Les
dix livres d'architecture (trad. Claude PERRAULT, 1673 -
revue et corrigée sur les textes latins et présentée
par André DALMAS), Balland, 1979. - Retour
texte
(14) DIODORE, XX, 82-88;
91-100; PLUTARQUE, Vie de Démétrios, 21-22;
VITRUVE, X, 16. - Retour texte
(15) John WARRY, Histoire
des guerres de l'Antiquité, Elsevier-Bordas, 1981,
p. 90. - Retour texte
(16) Par rapport à
quoi ? - Retour texte
(17) Yigaël YADIN,
Masada - La dernière citadelle d'Israël (1966),
Jérusalem, Steimatzky's Agency Ltd, 1973, p. 226. - Retour
texte
(18) R. CAGNAT, s.v.
"legio", in DAREMBERG et SAGLIO, Dictionnaire des antiquités
grecques & romaines, Hachette, 10 vols, 1877-1903, pp.
1084 et 1085. - Retour texte
(19) Fretum Siculum
: le détroit de Messine. - Retour
texte
(20) Cyrrhus : Nabi
Hun, à 76 km au nord d'Alep, en Syrie. - Retour
texte
(21) Arenacum : Arnhem,
aux Pays-Bas. - Retour texte
(22) Noviomagum : Nimègue,
aux Pays-Bas. - Retour texte
(23) Vindobona : Vienne,
capitale de l'Autriche. - Retour texte
|
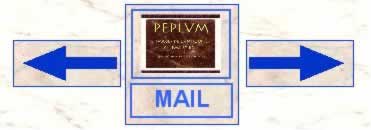
|