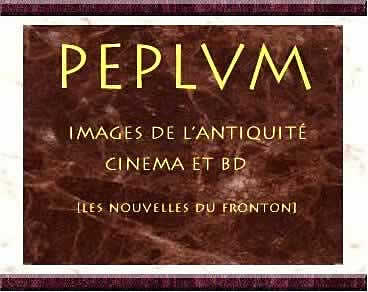 |
| |
| |
Le Signe de la Croix
(Cecil B. DeMille - EU, 1932)
|
|
| |
En 1895, Henryk Sienkiewicz
céda à l'acteur et dramaturge britannique
Wilson Barret le droit d'exclusivité mondiale
(sauf l'Italie) pour l'adaptation théâtrale
de son roman Quo Vadis ? : ce fut Le Signe
de la Croix (1).
L'intrigue du roman fut simplifiée et les noms
de certains personnages changés; ainsi Lygia
devint Mercia, Marcus Vinicius Marcus Superbus, tandis
qu'Ursus passait
- semble-t-il (2)
- aux oubliettes (paradoxalement, ce dernier allait
sous les traits de Bruto Castellani conquérir
la gloire dans les versions cinématographiques
de Quo Vadis ? 1912 et 1924, avant de devenir
un personnage indépendant dans les années
1960). Le Signe de la Croix fut trois fois
porté à l'écran. La première
fois en 1904, dans une production familliale anglaise
de Haggar & Sons, réalisée par William
Haggar, avec Will Haggar jr (Marcus Superbus), Jenny
Linden (Mercia) et James Haggar (Néron). Dix
ans plus tard, peut-être en réplique
au succès du Quo Vadis ? de Guazzoni,
le producteur américain Famous Players, dont
le nom fut si souvent associé à celui
de Cecil B. DeMille, confiera à Frederick Thomson
la réalisation d'un remake, Sign of the
Cross (1914), avec William Farnum (Marcus Superbus),
Madge Evans (Mercia), Sheridan Block (Néron)
et Lila Barclay (Poppée). Avec l'avènement
du parlant, Cecil B. DeMille produit et réalise
pour Paramount une troisième version en 1932
(voir ci-après).
Un quatrième film, l'italo-espagnol Sous
le signe de la Croix, tourné en 1956, n'a
par contre rien à voir avec l'histoire qui
nous intéresse ici. L'action se passe à
Tarse de Cilicie, en 120, sous le règne d'Hadrien,
et met en scène deux jeunes esclaves carthaginoises,
comme le rappelle le titre alternatif Les esclaves
de Carthage (Le schiave di Carthagine,
Guido Brignone - avec Gianna Maria Canale). |
|
|
|
|
|
|
Le Signe de la Croix
Signe de la Croix (Le) [FR]
Signe de la Croix (Le) [BE] / Teken des Kruises (Het) [VL]
Etats-Unis, 1932
Sign of the Cross (The) («the screen's greatest drama
of heroic faith and inspiring spectacle»)
Sign of the Cross (The) [EU]
Im Zeichen des Kreuzes [AL]
Prod. : Paramount (Cecil B. DeMille) / N&B / 14 bobines /
140'
Fiche technique
Réal. : Cecil B. DEMILLE; Scén. : Waldemar YOUNG
& Sidney BUCHMAN (d'après le drame de Wilson BARRETT,
1895); Images : Karl STRUSS; Mont. : Anne BAUCHENS; Dir. art.
& Cost. : Mitchell LEISEN; Musique : Rudolph KOPP.
Fiche artistique
Charles LAUGHTON (Néron) - Claudette COLBERT (Poppée)
- Fredric MARCH (Marcus Superbus) - Elissa LANDI (Mercia) - Ian
KEITH (Tigellin) - Vivian TOBIN (Dacia) - Joyzelle JOYNER (Ancaria)
- Harry BERESFORD (Favius) - Arthur HOHL (Titus) - Ferdinand GOTTSCHALK
(Glabrio) - Tommy [Thomy] CONLON (Etienne) - Nat PENDLETON (Strabo)
- William V. MONG (Licinius) - Harold HEALY (Tyros) - Clarence
BURTON (Servilius) - Robert ALEXANDER (Viturius) - Robert MANNING
(Philodème) - Joe BONOMO (géant) - Lillian LEIGHTON
- Otto LEDERER - Lane CHANDLER - Wilfred LUCAS - Jerome STORM
- Florence TURNER - Gertrude NORMAN - Horace B. CARPENTER - Carol
HOLLOWAY - Ynez SEABURY.
DISTRIBUTION
EU/Paramount Publix Corp. (sortie, 3 décembre 1932)
BE/Paramount
Copies disponibles :
-George Eastman House Motion Picture Department (Rochester)
BIBLIOGRAPHIE
RINGGOLD, Gene & DeWITT BODEEN, The Films of Cecil B. DeMille,
New York, The Citadel Press, 1969, pp. 278-283.
SCÉNARIO
Depuis trois jours, Rome est en feu. Tandis que les flammes s'élèvent
des différents points de la ville et jettent vers le ciel
d'immenses lueurs rougeoyantes, du haut du palais impérial,
face à l'immense brasier qui constitue la cité,
Néron, tout à l'ivresse du spectacle, compose un
poème. Cependant, aux cris d'horreur qui se font entendre
à travers les rues, des cris de révolte et de haine
se mêlent. Une rumeur indignée s'échappe de
la foule : l'incendie a été allumé par des
mains criminelles. Il faut que le ou les coupables soient châtiés.
Le capitaine des gardes Tigellinus se fait auprès de l'empereur
l'écho de ces bruits menaçants et convainc son maître
d'attribuer aux chrétiens la responsabilité du forfait.
Aussitôt, le peuple de Rome crie vengeance et commence à
pourchasser impitoyablement tous les adeptes du christianisme,
s'attachant à leurs pas, les dépistant d'après
les signes de croix qu'ils tracent à terre, multipliant
les exécutions, lapidant les suspects ou les livrant à
la police.
C'est ainsi que deux philosophes, Favius, qui habite Rome, et
Titus, qui vient de Jérusalem où il a été
chargé par l'apôtre Paul de répandre en Espagne
et en Afrique la sainte parole, sont assaillis un jour par la
multitude. Leur sort serait gravement menacé, ainsi que
celui de la jeune et belle chrétienne Marcia, qui intervient
pour les protéger, si ne surgissait sur la place, escorté
de sa garde équestre, le jeune préfet de Rome, Marcus
Superbus, qui a tôt fait de disperser la foule et de protéger
le départ des deux vieillards et de la jeune fille, non
sans s'être inquiété de l'endroit où
il pourra retrouver cette dernière. Effectivement, quelques
heures plus tard, sans apparat, il la rejoint à la fontaine
où elle va puiser de l'eau et échange avec elle
quelques paroles simples et tendres.
Cependant, deux personnes ont déjà été
informées de l'attitude étrange du préfet.
L'impératrice Poppée, qui s'est éprise du
jeune seigneur, l'a appris de sa suivante Dacia. Quant à
Néron, il a été alerté par Tigellinus
qui, jaloux de Marcus et désireux de le supplanter dans
la faveur de l'empereur, déploie son zèle dans la
destruction des chrétiens et vient d'obtenir, de la main
même de César, un ordre général d'extermination
qu'il apporte en personne, au préfet, alors que celui-ci
aide à la fontaine la jeune chrétienne.
Tigellinus, désireux de connaître le lieu où
les chrétiens se réunissent en secret, se saisit
d'Etienne, un jeune garçon d'une quinzaine d'années
- dont les parents, comme ceux de Marcia avec laquelle il vit
auprès du philosophe Favius, furent tués autrefois.
En le soumettant à d'effroyables tortures, le capitaine
obtient de l'enfant le renseignement tant convoité. Marcus,
qui s'est rendu chez Favius pour y emmener Marcia qu'il veut soustraire
aux dangers dont sont menacés les chrétiens, apprend
la nouvelle et se précipite vers le Pont de Cestie, où
Tigellinus s'est rendu avec ses hommes pour tuer les fidèles.
Mais, en cours de route, le préfet est retardé par
Poppée dont il a malencontreusement bousculé la
litière; elle insiste pour qu'il lui rende visite. Impatient,
celui-ci s'esquive et arrive au lieu de la réunion, alors
que la moitié des chrétiens a déjà
été massacrée par les soldats de Tigellinus.
Marcia, capturée avec ses coreligionnaires, est menée
en prison pour être livrée aux fauves. Mais, par
les soins de Marcus, elle est enlevée et conduite au palais
du préfet, où celui-ci a réuni ses amis pour
une fête somptueuse qui dégénère bientôt
en orgie. Marcia, introduite auprès des convives, oppose
aux façons débauchées des assistants l'impassibilité
de sa vertu. Une courtisane, Ancaria, exécute en vain auprès
d'elle des danses d'une étrange lascivité. Elle
reste immobile comme une statue de marbre. Lorsque Marcus, ému
de son indifférence, l'exhorte à abandonner sa foi
pour échapper à un massacre qui menace les chrétiens,
elle persiste à réclamer son retour parmi ces derniers.
C'est alors qu'apparaît Tigellinus qui, sur un ordre de
l'empereur, vient arrêter pour la seconde fois la jeune
fille.
Marcus, dont le sentiment pour Marcia s'est développé
avec une extraordinaire intensité, se rend chez Poppée
pour lui demander d'intervenir, mais elle se rit de lui et de
l'amour qu'il porte à la jeune chrétienne. Dépitée
du dédain qu'il lui a témoigné, elle persuade
ensuite l'empereur de ne pas accorder à Marcus une grâce
que, sans doute, celui-ci ne va pas manquer de venir lui demander
personnellement. En effet, Marcus sollicite une audience de Néron
qui le reçoit dans la salle du trône, et, inspiré
par l'impératrice, refuse obstinément au préfet
de lui accorder la vie de la captive.
Dès lors, les destins n'ont plus qu'à s'accomplir.
Rome tout entière s'est portée aux arènes.
Dans l'immense enceinte du Circus Maximus, un peuple ardent et
exalté fait retentir l'air de ses clameurs. Des hérauts
annoncent l'arrivée de César dans la loge impériale.
Néron s'installe, ayant a ses côtés L'impératrice.
L'édifice bruit comme une cuve ardente. Sous l'éclat
du soleil, les têtes s'échauffent. Le spectacle annoncé
doit être aussi magnifique que sanguinaire. Chacun en attend
avec impatience le début. Et, dans l'ardente symphonie
des cris d'enthousiasme et d'horreur, les jeux commencent...
Ce sont tour à tour les sanglants combats des gladiateurs,
des rétiaires contre les mirmillons, l'apparition des éléphants
qui écrasent sous leurs pattes monumentales les victimes
expiatoires, puis les tigres, les taureaux, les ours, les gorilles,
les crocodiles qui s'approchent des jeunes chrétiennes
crucifiées nues sur les calvaires. L'horreur touche à
son comble lorsque s'opposent dans des duels mortels vingt amazones
géantes et vingt pygmées monstrueux. Enfin, les
chrétiens sont livrés aux tigres et aux lions.
Dans les caveaux se déroulent des scènes déchirantes.
Un grand-père voile les yeux de l'enfant qu'il porte dans
ses bras pour lui épargner la vue de leur supplice. Marcia,
qui va monter dans l'arène avec ses compagnons, est retenue
à la porte par un garde : Néron, voulant rendre
hommage à sa grande beauté, a décidé
qu'elle serait livrée la dernière, et seule, aux
fauves.
C'est alors qu'éperdu de douleur, Marcus la rejoint dans
le caveau. Il faut qu'elle abjure sa foi : elle aura la vie sauve.
Marcia, dont la pensée du sacrifice illumine le visage,
oppose à cette crise de désespoir des paroles de
confiance. Elle l'assure de sa certitude d'une autre vie, dans
laquelle ils seront réunis. Elle lui dit la grandeur de
son Dieu. La calme dignité de la jeune fille, sa majesté,
son courage déchirent soudain le voile qui était
tendu devant l'esprit de Marcus. Frappé par la grâce,
il se rallie à sa foi et décide de monter avec elle
au supplice. Lentement, ils gravissent les degrés qui mènent
à l'arène...
La lourde porte du cirque se referme derrière eux, sur
les vantaux de laquelle apparaît, radieux et immatériel,
le signe immense de la Croix. |
|
CRITIQUES
Le premier film parlant à grand spectacle (press-book)
«En accordant une importance considérable
au texte des films, l'avènement du son à l'écran
eut pour première conséquence la diminution des
œuvres essentiellement «spectaculaires».
Dès que la pellicule sut parler, on négligea les
éléments qui avaient fait la fortune du cinéma
muet - dynamisme de l'action, abondance des extérieurs,
somptuosité de la mise en scène - pour lui conférer
tous les attributs du théâtre; c'est alors que les
films furent, comme on disait, «cent pour cent parlants».
La technique se réduisit à réunir dans quelques
décors d'intérieurs des personnages qui échangeaient
sans arrêt un dialogue purement scénique. On ne savait
pas si le microphone s'accommoderait des mille bruits de la rue
ou de la nature et, par mesure de précaution, on tournait
dans des studios hermétiquement clos.
Mais, par la suite, la formule se dégagea d'une gangue
que lui imposaient sa jeunesse, l'inexpérience des cinéastes,
leur appréhension des procédés nouveaux,
et le cinéma, un moment confiné sur les planches
du théâtre, retrouva sa loi naturelle, ses libertés
et ses droits. Comme le feuillage trop copieux d'une plante très
riche, le dialogue fut coupé, rogné, émondé.
On fit sortir, le micro dans la rue, on l'emmena à la campagne.
Les films refirent une cure d'air et tout rentra dans l'ordre
normal : le cinéma était redevenu l'art du mouvement.
On voulait revoir les foules immenses, les décors gigantesques,
les déploiements de costumes qui avaient fait le succès
d'inoubliables œuvres telles que Les Dix Commandements
ou Ben Hur.
La foule garde toujours au cœur le goût du grandiose,
du formidable, elle aime le superlatif, elle adore le sublime.
Et ses écrivains les plus chers ont toujours été
les poètes épiques.
C'est pour répondre à ce besoin si légitime
qu'une grande firme américaine, la Paramount, mettant sur
pied une entreprise gigantesque, risquant des sommes considérables,
multipliant ses collaborateurs, donnant du travail à des
milliers de personnes - ouvriers et figurants - a réalisé
Le signe de la Croix.»
«Le signe de la Croix», Mon Ciné,
HS, avril 1933
La majeure partie des studios Paramount d'Hollywood
- bâtiments et dépendances - fut maquillée,
camouflée et transformée de façon à
représenter un quartier entier de l'ancienne Rome. Des
villas, des palais, des rues furent édifiée de toutes
pièces. Lorsqu'il fallut les détruire, on mit le
feu à l'ensemble, et c'est alors que furent tournées
les scènes du début du film où Néron,
du haut de son palais, assiste à l'incendie de Rome et
alimente du spectacle des flammes son inspiration poétique.
Tout fut réalisé sur une échelle gigantesque.
Des installations spéciales furent aménagées,
des ateliers de bijouterie, de fonderie, de moulage. Il fallait
fabriquer en grande série des objets et des ornements qu'on
ne pouvait songer trouver dans le commerce. C'est ainsi que furent
réalisés 600 pièces de joaillerie précieuse,
1.400 ornements de métal, comprenant différents
modèles de bagues, colliers, bracelets, tiares, anneaux,
broches, amulettes, pendants d'oreilles, boucles, etc. On fabriqua
également 1.500 objets entièrement métalliques,
parmi lesquels des boucliers de gladiateurs, des épées,
des tridents, des poignards, des casques, des cottes de mailles,
des chaînes, des armures, des cuirasses, des ardillons pour
chaussures.
En ce qui concerne les vêtements, le travail des dessinateurs,
des tailleurs et des couturiers dura plusieurs mois. Le nombre
des costumes nécessaires était en effet de près
de 10.000, et certains d'entre eux, réservés aux
interprètes principaux, exigeaient les soins les plus attentifs.
Celui que porte Claudette Colbert, dans le rôle de l'impératrice
Poppée, lorsqu'elle paraît devant Néron, entièrement
tissé de fil de métal, ne pèse pas moins
de trente-cinq livres.
Certains décors furent construits à
l'aide de matières précieuses, telle la salle principale
du Palais d'Or de Néron, telle l'immense piscine de Poppée,
toute de marbre et de porphyre, où nous voyons l'impératrice
prendre un bain de lait, approvisionné par une cuve extérieure
d'une capacité de dix mètres cubes. Pour représenter
le grand cirque de Rome qui, en réalité, comprenait
150.000 [250.000, N.d.l.A.] places, Cecil B. DeMille fit édifier
des constructions qui atteignirent 40 m de hauteur et sur lesquelles
une figuration innombrable s'installa. Le réalisateur,
procédant en effet par coupures, raccorda entre elles des
scènes occupées par des milliers de figurants et
dont la succession sur l'écran produit une impression de
foule absolument incroyable.
Pour recruter les figurantes qui devaient représenter les
Amazones dans le combat monstrueux qui oppose celles-ci aux gnomes
armés de javelots et de torches et qu'elles embrochent
avec leur glaive, on fit passer une annonce dans la presse, ainsi
rédigée : «On demande vingt femmes très
musclées, mesurant au minimum 1,80 m et pesant au minimum
135 livres.» Soixante-quinze candidates se présentèrent,
répondant à ces conditions, parmi lesquelles on
choisit les vingt plus grandes et plus vigoureuses.
Avec la collaboration des plus grands cirques des
Etats-Unis, 30 lions furent mis en présence. Les scènes
tournées parmi ces lions le furent à l'aide de huit
appareils enregistreurs, postés en différents points
du décor. L'un des appareils avait été abandonné
au milieu des fauves sans opérateur et fonctionnait électriquement;
il a photographié des premiers plans de lions d'une netteté
telle qu'on n'en vit jamais de semblables dans aucun film précédent.
Les ménageries installées dans les studios comprenaient
également 40 éléphants, des tigres, des ours,
des taureaux, des léopards et des crocodiles qui paraissent
et se déplacent librement dans le cirque. Pour éviter
tout accident, on fit construire, reliant les cages aux plateaux
de prises de vues, 60 m de couloirs métalliques, blindés
et cadenassés, entre lesquels circulaient les animaux,
et les scènes ne furent tournées que sous la précaution
constante des fusils et des revolvers dont on se fût servi
à la première menace.
La réalisation du Signe de la Croix
a duré deux mois et demi. Elle a fourni pendant ce laps
de temps un travail régulier à 7.500 figurants.
On impressionna le chiffre fantastique de 225.000 m de pellicule.
Quant au prix de revient général, il atteignit le
total inouï de 800.000 dollars, soit environ 20 millions
de francs français (1932).
«Mis à la disposition de n'importe
quel metteur en scène, ces instruments inappréciables,
ces accessoires, ces décors, ces foules, ces animaux eussent
constitué un spectacle à la Barnum, somptueusement
médiocre. Entre les mains d'un Cecil B. DeMille, ils reflètent
dans leurs moindres détails le rayonnement de l'intelligence
qui présida à leur conjugaison. Ils deviennent des
éléments d'art et de pensée. Ils échappent
au domaine de la parade foraine pour appartenir à celui
de l'Epopée.»
«Le signe de la Croix», Mon Ciné,
HS, avril 1933
«En 1932, l'inépuisable Cecil B.
DeMille nous donne un exemple parfait du genre avec Le signe
de la Croix (The sign of the Cross) de fameuse mémoire
! Le film est interprété par une pléiade
de stars : Elissa Landi joue le rôle de Marcia («la
pure jeune fille dont l'amour et la foi vont conduire Marc à
embrasser la religion chrétienne et à mourir martyrisé);
Claudette Colbert est Poppée, la femme de Néron,
diabolique et lascive; Fredrich March tient le rôle de Marc
(«un fonctionnaire romain chargé d'exterminer les
chrétiens»); et enfin Charles Laughton est l'empereur
Néron. L'esprit faussement candide du célèbre
cinéaste apparaît tout entier dans ce récit
qu'il fait du tournage du film : «Il y eut une scène
qui suscita grand nombre de commentaires publics et privés;
elle met en relief le problème de la censure. Afin de convaincre
Marcia de répudier sa foi chrétienne et d'oublier
ses principes moraux, Marc l'emmène chez lui et la fait
assister a une orgie caractéristique de la Rome païenne
de cette époque. Marcia se montre indifférente à
toutes les sensations. En dernier recours, l'une des invitées
de Marc exécute une danse devant la jeune fille. Cette
danse est extrêmement voluptueuse. Il fallait qu'elle le
soit pour mettre en valeur la force de la foi de Marcia. On la
jugea trop osée... Elle resta cependant dans le film. Mais
elle fut très sévèrement critiquée...».»
Alpha, réf. ???? |
|
ANALYSE
Le fascisme et le nazisme - En Italie, sous le fascisme
(1922-1944), le seul film où Néron est représenté
s'intitule Néron (IT, 1930) d'Alessandro Blasetti.
«Le célèbre comique Ettore Petrolini propose
de l'empereur une vision loufoque et iconoclaste (3).
Cette représentation est donc en rupture avec l'image traditionnelle
de Néron au cinéma. Pour expliquer cela, il nous
faut savoir que le dernier film italien à aborder le sujet
de l'Antiquité romaine, avant Scipion l'Africain
(IT, 1937) ayant pour finalité la propagande fasciste,
est Les derniers jours de Pompéi réalisé
en 1926. Il y a à partir de ce moment un durcissement de
la censure car les films des années vingt sur l'Antiquité
ne conviennent guère au nouveau pouvoir par leur aspect
violent, voire sadique et sensuel. Mais c'est surtout l'image
d'une Rome impériale où les détenteurs du
pouvoir sont des personnages corrompus dont on s'applique à
souligner les bassesses, comme c'est le cas pour Néron,
qui est gênante dans la mesure où le fascisme cherche
à s'inscrire dans la continuité des grandeurs passées
de Rome (4).
Ainsi, Alessandro Blasetti dut se contenter de mettre bout à
bout des sketches avec références à l'antique
du comique Petrolini pour obtenir une comédie moderne cultivant
l'anachronisme (téléphones, gros godillots...).
Contournant ainsi la censure, il tournait en dérision un
Néron bouffon, empereur quelque peu marginal en lequel
le régime ne risquait pas de chercher à s'identifier.
Par contre, utilisée dans un but de propagande antinazie,
l'image de Néron, au lieu d'être censurée,
peut servir à établir une comparaison avec un autre
tyran. Ainsi, dans la version du Signe de la Croix (EU
- 1932) destinée aux troupes alliées durant la Seconde
guerre mondiale, une séquence préliminaire, rajoutée
par Cecil B. DeMille en 1941, établit un rapprochement
explicite entre Néron et Hitler. Dans un avion américain
dont la mission est de lancer sur Rome des tracts anti-allemands,
un aumônier prononce le texte suivant : «Néron
se croyait le maître du monde et ne se souciait pas la vie
d'autrui plus que ne le fait Hitler. Pour satisfaire un cruel
caprice personnel il a incendié cette même ville
- Rome, sa capitale - et il l'a fait sans la moindre pensée
pour les souffrances humaines qui en résulteraient. Des
dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie pour ce caprice
insensé. Alors apparut un Signe de la Croix que nul ne
réussit à détruire. Et en assistant à
cette horrible danse de la mort, il y avait un individu qui riait
(5).»
Le visage de Néron apparaît alors au milieu des flammes
(6).
Ce monologue est aussi porteur d'un message d'espoir pour l'Amérique
chrétienne et ses troupes.
Toutefois, lorsqu'il n'est pas question de propagande, un film
reste le reflet de son époque même quand l'action
est située dans le passé. Nous allons parler de
la place qu'occupe le contexte dans lequel un film est réalisé
en prenant comme exemple Quo Vadis ? (EU, 1951).
Sandrine
GOUAZÉ (7) |
NOTES :
(1) Malgorzata HENDRYKOWSKA, «Le
premier spectacle grand public - Quo Vadis ? d'Enrico
Guazzoni sur le territoire polonais (1913-1914)», dans
Immagine - Note di Storia del Cinema, Rome, Associazione
Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema, NS n° 32, automne
1995, pp. 9-12 (citant : EMTA, 1900, n° 896). - Retour
texte
(2) Dans les versions cinématographiques.-
Retour texte
(3) J.A. GILLI, «Naissance,
développement et déclin du péplum italien»,
Catalogue de l'exposition Péplum, l'Antiquité
au cinéma, organisé par le C.A.V.M.(Cinéma
et Audiovisuel en Val-de-Marne) du 15 octobre au 30 novembre
1983, p. 92. - Retour texte
(4) N. SIARRI, L'Antiquité
latine au cinéma. Histoire et histoires dans le péplum
romain, thèse de doctorat Aix-Marseille I, 1987,
p. 66. - Retour texte
(5) J. CARY, Kolossal ! Il film
epico e la sua storia, Fratelli Fabbri Editori Milano, 1975,
Chapitre «Quo Vadis, Epicus ?», p. 93. Cité
par N. SIARRI, op. cit., p. 87. - Retour
texte
(6) N. SIARRI, op. cit., p.
87. - Retour texte
(7) Sandrine GOUAZÉ, L'image
de Scipion l'Africain, César, Caligula et Néron
au cinéma, Mémoire de
maîtrise d'histoire (Jean-Marie Pailler, directeur de
recherche), Université de Toulouse-Le Mirail, octobre
1995, pp. 204-205. - Retour texte
|
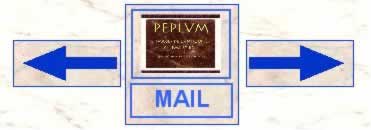
|