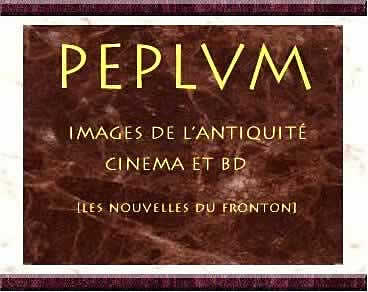 |
| |
| |
Hannibal, l'ennemi de Rome
(Richard Bedser, 2005)
Hannibal, le cauchemar
de Rome
(Edward Bazalgette, 2005)
(Page 1/3)
|
|
| |
|
|
|

Tamer Hassan incarne le fils d'Hamilcar
Barca
dans le docu-fiction Hannibal, l'ennemi de Rome
(Richard Bedser, 2005) |
|
Hannibal,
le Cannibale des Légions
Le «Cannibale des Légions»... petit clin d'œil
à Hannibal Lecter, le serial-killer du film de Ridley
Scott, lequel après le tournage de Gladiator nous
avait donné de faux espoirs de retrouver, sous sa houlette,
le grand capitaine de la Deuxième Guerre punique. Celui
que G.P. Baker (1)
surnommait le «Magicien», le stratège invincible
en rase campagne, quoique peut-être moins brillant dans
la guerre de siège (Sagonte, Rome [2]),
qui expédia ad patres près de la moitié
des fils de Rome aptes à combattre, saignée démographique
sans précédent. Cet Hannibal
qu'interprétèrent à l'écran l'ineffable
Victor Mature (Hannibal, C.L. Bragaglia - 1959) et Howard
Keel qui poussait la chansonnette aux côtés de la
naïade Esther Williams (La chérie de Jupiter,
George Sidney - 1954); et avant eux, Emilio Vardannes (Cabiria,
1913) et Camillo Pilotto (Scipion l'Africain, 1937)...
|
| |
|
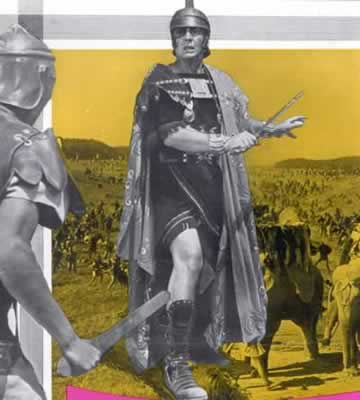
Victor Mature dans le rôle du général
borgne
(Hannibal, C.L. Bragaglia, 1959)
|
|
| |
Ces dix dernières années
ont vu fleurir quantité de projets relatifs à Hannibal
: fictions, docu-fictions et documentaires confondus. En 1996 déjà,
le syrio-américain Mustapha Akkad (Le
Message) avait envisagé le tournage d'une superprode
épique, Hannibal; plus récemment, Alberto Negrin
(Le Secret du Sahara) annonça un projet de téléfilm
(2001) tandis que la 20th Century-Fox offrit le rôle du conquérant
carthaginois à l'acteur noir-américain Denzel Washington
(CLICK COURRIER
et CLICK)(Glory)
(sic), projet heureusement demeuré sans suite (2001).
Depuis lors, il est question d'un autre «epic» avec
Vin Diesel dans le rôle-titre et produit par One Race Prods
(Vin Diesel et George Zakk) pour Revolution Studios, filiale du
groupe Sony. Sony a, en effet, acquis les droits sur le controversé
roman de l'écrivain écossais Ross
Leckie (que l'on voit intervenir comme «historien»
dans le docu-fiction Hannibal,
l'ennemi de Rome). Dès juillet 2002, Ridley Scott
en fut pressenti comme réalisateur; le scénario devant
être confié à David Franzoni (Gladiator),
d'après le roman de Leckie donc. A en croire IMDb, ce film
serait toujours en pré-production. Croisons les doigts ! |
| |
|
Deux romans de Ross Leckie, consacrés
aux généraux antagonistes : Hannibal et Scipion |
|
| |
| Deux films à l'ordre du jour,
présentement : Hannibal,
l'ennemi de Rome, de Richard Bedser (2005) à la TV,
et Hannibal, le cauchemar
de Rome, d'Edward Bazalgette (2005) en DVD. Bedser a tourné
son film dans les décors romains des studios Sindbad Productions
de Tunis, la même année que - sinon parallèlement
avec - la version de Bazalgette, l'un et l'autre pour différents
départements de la BBC (National Geographic Channel &
Discovery Channel). Rappelons que les studios Sindbad
Productions ont, ces dernières années, accueilli
le tournage de nombreux docu-fictions pour la TV comme The Pleasure
of Ancient Rome (Peter Swain, prod. Principal TV - 2005), Pompei
(prod. BBC Interactive Films - 2003), Last
Days of Pompeii (Le dernier jour de Pompéi) (Peter
Nicholson, prod. Ailsa Orr et BBC - 2003), Colosseum (prod.
BBC Interactive Films - 2003), Colosseum
: Arena of Death (Les gladiateurs) (Tilman Remme, prod.
BBC - 2003), et Carthage (Janne Read, prod. RDF / Channel
4 - 2003) (3). |
|
1. Hannibal, l'ennemi de Rome
La particularité du film de Richard Bedser est que, si
ses techniciens sont majoritairement européens, tous ses
interprètes sont arabes, même pour les rôles
de Romains - Meurtre à
Rome, autre récent docu-fiction tourné au
Maroc, proposait des comédiens anglo-saxons pour les principaux
rôles romains, entourés de figurants maghrébins
: dichotomie gênante. Hannibal est interprété
par le comédien tunisien Tamer
Hassan. Seuls les décors romains et la bataille de
Zama ont été tournés en Tunisie, les paysages
italiens étant filmés en Slovénie et le passage
des Alpes... dans les Alpes suisses. La production National Geographic
Channel (BBC) ne disposait que de trois éléphants
femelles, plus dociles; l'infographie les démultiplia jusqu'à
neuf ou douze dans la même image, reprise en deux ou trois
plans.
|
| |
|

Pour son docu-fiction, R. Bedser a filmé
des éléphantes dans les Alpes suisses
|
|
| |
Plusieurs personnalités universitaires
viennent parler d'Hannibal : le Prof. Barry Strauss de l'Université
de Cornell; le Dr. Adrian Goldsworthy, historien; le déjà
cité Ross
Leckie, «historien»; Gregory Daly de l'Université
de Manchester, qui juge surfaite l'importance militaire accordée
aux éléphants d'Hannibal, lesquels pour la plupart
périrent en route et donc ne servirent à rien; enfin,
Philip Matyszak de l'Université de Cambridge. Bien sûr,
on s'émerveillera toujours de l'assurance de spécialistes
qui peuvent affirmer : «Hannibal était obsédé
par telle idée; Scipion par telle autre.» Qui
peut dire à quoi songeait exactement Hannibal, lorsqu'après
Cannes il renonça à marcher sur Rome ? Chacun a
bien sûr sa petite hypothèse : Hannibal ne voulait
pas détruire Rome, seulement la neutraliser géopolitiquement;
Hannibal, quoique stratège habile, n'avait ni la compétence
ni les moyens matériels d'assiéger Rome (les deux
ensemble, ou seulement un des deux); Hannibal était amoureux
d'une belle Romaine et ne voulait pas passer à ses yeux
pour un barbare sanguinaire («hypothèse» qui
n'a jamais connu que la faveur des cinéastes, évoquée
comme telle, non sans humour, dans le documentaire
Time-Life de 1994). Néanmoins, le docu-fiction de Richard
Bedser propose une assez bonne vulgarisation, qui s'attarde peut-être
un peu trop sur la traversée des Alpes, mais qui se livre
à une très intéressante analyse stratégique
de la bataille de Cannes, ce classique de la manœuvre d'encerclement
étudiée depuis par tous les stratèges. Un
siècle auparavant, Alexandre le Grand avait traversé
l'Hindou-kouch - autre chose que le col du Grand Saint-Bernard
! -, sans éléphants il est vrai, mais avec une armée
bien plus conséquente, sans compter tous les accompagnateurs
civils : marchands, prostituées...). Selon les historiens
romains, Hannibal s'allégea au maximum, n'acceptant aucune
femme dans les fourgons de son armée, pas même la
sienne. A en croire les historiens romains, Hannibal essuya des
pertes effroyables
tant dans les Pyrénées que dans les Alpes - prenons
les chiffres avec prudence. Parti d'Espagne, Hannibal mit cinq
mois pour arriver en Italie, dont quinze jours pour traverser
les Alpes. Il déboula dans la plaine du Pô «vers
l'époque où les Pléiades se couchent»,
dit Polybe (POL., III, 2. 54), c'est-à-dire fin septembre
ou début octobre. On ne sait pas par où exactement
passa Hannibal : il y a un demi-siècle, un historien recensait
350 publications sur cette question. Six cols ont été
proposés : le Mont-Cenis, le Petit-Saint-Bernard, le Grand-Saint-Bernard,
et, plus plausibles : le Mont-Genèvre, le col d'Argentière
ou le col de la Traversette. Les images de neige et de tempête,
les histoires d'engelures et de morts de froid dont font état
le docu de Bedser ne seraient elles pas quelque peu exagérées
? En cette saison encore ensoleillée de l'année,
il y a, selon les cols, de la neige, et surtout des restes de
neige... Le docu de Bedser, qui - lui - situe la traversée
des Alpes fin octobre, lorgne vers la version Bragaglia
(1959) laquelle traitait le passage des Alpes de manière
fort elliptique ce qui n'empêchait pas que ses bourrasques
de neige dans l'été finissant étaient carrément
comique pour qui connaît le terrain. Un facteur de pertes
humaines est l'hostilité naturelle et une très sérieuse
méconnaissance du terrain. Napoléon, lui, avait
au moins des chemins à disposition, utilisés régulièrement
par les moines du Saint-Bernard, les villageois etc. Toutefois
Polybe insiste sur le fait qu'Hannibal s'était préalablement
très bien renseigné sur les difficultés des
Alpes, aussi s'était-il entouré de guides locaux,
et fait oberver qu'avant lui, plusieurs armées gauloises
avaient traversé ces mêmes montagnes pour envahir
l'Italie. G.P. Baker (4)
évoque surtout les démêlés de
l'armée punique avec les Allobroges, et signale un passage
enneigé. Tandis que Gilbert Charles-Picard (5)
se borne à mentionner la traversée des montagnes,
sans ajouter le moindre commentaire. Le blanc manteau hivernal
est un effet dramatique qui renvoie à la mémoire
collective - la Grande Armée, puis la Wehrmacht décimées
par le Général Hiver (6).
|
| |
|

Scipion erre sur le champ de bataille de
Cannes :
la pire défaite qu'aient eu à subir les aigles
de Rome
|
|
|
1.1. Les légionnaires
romains
Pierre d'achoppement de tous les films historiques : les costumes.
Nous ne nous arrêterons pas aux Carthaginois, qui adoptent
un profil bas : engoncés dans des manteaux aux couleurs
terreuses, les reflets métalliques de leur casques nous
les désignent de toute façon comme étant
des soldats. Les panoplies militaires romaines méritent
quelques commentaires. Les casques de type «impérial
gaulois» et les boucliers rectangulaires et bombés
(scuti) sont du Haut-Empire (Ier s. de n.E.). Des casques
du type Montefortino, des modèles étrusco-corinthiens
ou attiques eussent évidemment été préférables,
de même, pour les boucliers, le clipeus ovale et
plat. Les cuirasses romaines, des cottes de mailles, sont relativement
bien observées même si, en fait, il leur manque les
protèges-épaules qui viennent par dessus... Le film
ne tient pas non plus compte du fait que les légionnaires
ne sont pas tous armés de la même façon :
les deux premières vagues sont celles des hastati
et des principes, chacun armé de deux pila,
et la troisième, en réserve, est celle des triarii
armés de la lance (hasta). Au IIIe s., les légionnaires
ne possédaient pas tous une cotte de maille, beaucoup se
contentaient d'une plaque de poitrine, de forme carrée.
Empruntées à leurs ennemi Celtes (7)
établis en Cisalpine depuis le IVe s., les chemises
de mailles sont en train de se répandre dans l'armée
romaine, mais valent des fortunes. Le docu-fiction est d'ailleurs
assez discret à propos du ralliement à Hannibal
de certaines tribus gauloises comme les Boïens et les Insubres.
Turin, la capitale des Insubres, n'était «Romaine»
que depuis six ans environ lorsque le conquérant carthaginois
y fit sa première étape.
|
| |
|
A gauche, Hannibal vu par Richard Belser.
A droite, sur son éléphant, vu par Edward
Bazalgette |
|
|
2. Hannibal,
le cauchemar de Rome
Parallèlement au précédent, les Studios
Sindbad ont accueillis une autre production BBC (Discovery
Channel), dirigée par Edward
Bazalgette et Alisa Orr, mais disposant de davantage
de moyens, et - partant - d'un casting plus étoffé.
Des acteurs européens dans les rôles romains,
notamment Ben Cross - déjà vu dans le rôle
de Titus Glabrus (Spartacus, TV, 2004) et du félon
Prince Malagant (First Knight, 1995) -, qui incarne
ici le dictateur Fabius Maximus «le Temporisateur»
(Cunctator); mais aussi de nombreux comédiens
bulgares dans les seconds rôles, tandis que l'acteur
anglo-soudanais Alexander Siddig (CLICK,
CLICK
et CLICK)
prête ses traits à Hannibal. Alexander Siddig,
alias Siddig El Fadil ou Sid El Fadil, est né au
Soudan un 21 novembre 1965, d'un père soudanais,
mais sa mère, qui est anglaise, n'est autre que la
sœur de... Malcolm McDowell. On l'a vu dans Star
Trek : Deep Space Nine, Reign of Fire, Kingdom of Heaven,
Syriana - et on le retrouvera bientôt sous les
traits de Theodorus Andronikos dans The Enchanted Sword
/ The Last Legion (Doug Lefler, 2007), d'après
le roman de Valerio Manfredi, La
dernière légion, actuellement en postproduction.
Rien à redire du contenu, sauf peut-être le
regret que Bazalgette se soit contenté d'évoquer
le franchissement du Rhône, mais sans le montrer,
et qu'il n'ait pas suffisamment insisté sur la brillante
stratégie d'encerclement à Cannes (il y reviendra
en détail dans le Making Of). En revanche
on voit aussi le passage des Pyrénées, les
embuscades des montagnards; le docu-fiction met en valeur
les frères d'Hannibal (Hasdrubal et Magon) ainsi
que le chef de sa cavalerie Maharbal. Et le fait que Scipion
l'Africain n'a vaincu Hannibal qu'en copiant sa stratégie
: «Les Romains sont tellement prévisibles.»
Il m'a semblé que Zama était un peu bâclé,
et le film n'a guère évoqué la loyauté
des Italiques vis-à-vis de Rome, alors que les Grecs
au Sud finirent par passer dans le camp carthaginois (quid
du siège de Syracuse ?). Au Nord en revanche, après
un moment d'hésitation, les Boïens et les autres
Celtes, après le Tessin, passent avec enthousiasme
dans le camp punique.
|
|
| Nous le savons tous, il est impossible
de tout mettre, et a fortiori de tout dire dans un
film. C'est donc le choix de ce qui a été retenu
qu'il est intéressant d'inventorier. |
2.1.Mercenaires de Carthage et légionnaires romains
Quand aux costumes, ils sont aussi beaux que dans les planches
de Peter Connolly ou d'Angus McBride. Fatigués, usés,
patinés. Sauf les mercenaires espagnols, aux cuirasses
d'écailles et casque caractéristiques, les panoplies
des «Carthaginois» ne sont pas vraiment terribles,
et l'espèce de tablier d'Hannibal nous a un peu cueilli
à froid, de même que les pantalons bouffants, qui
connotent le Maghreb de même que les croissants de lune
sur les enseignes (davantage le croissant de l'Islam que celui
de Tanit [il manque la silhouette stylisée de la déesse
orante], pérennité des civilisations sémites
femelles ?).
On appréciera en revanche, chez les précités
Espagnols, l'interprétation de ce casque bizarre - dont
on n'a retrouvé aucun exemplaire mais qui est connu par
ses représentations figurées -, avec un couvre-nuque
qui semble pendre souplement, un peu comme la «casquette
Bigeard» des paras français (8).
Il y a aussi le chef Celtibère et son casque conique piqué
de quelques plumes blanches (La Tène, fin Ve s. av. n.E.
(9), et le chef Boïen
avec un aigle de bronze en guise de cimier, d'après un
exemplaire connu (La Tène, IIIe-IIe s. av. n.E. (10).
Les Romains en revanche sont un pur bonheur : certes leurs officiers
restent très «romains» stéréotypes
avec leurs cuirasses musclées en laiton, mais rien de vraiment
choquant. Aucune objection. La troupe légionnaire, en revanche,
se partage en porteurs de cotte de maille (malheureusement, il
s'agit de ficelle tricotée, teinte en noir et frottée
d'argent, et ça se voit) et en porteurs de plaque de poitrine.
Hélas ce n'est pas la plaque carrée des Romains,
mais les trois disques typiques des Samnites. Mais comme dans
ce conflit les Samnites sont demeurés fidèles à
Rome, ça ne gène pas outre mesure. Les casques sont
parfois attiques, mais surtout celtiques (Montefortino et Coolus
avec adjonction de paragnathides) : de simples pots, sans visière,
avec un couvre-nuque très court, et un tuyau en apex dans
lequel sont fichées deux plumes noires et une rouge (11).
On a envie de parler de «l'effet Oliver Stone», dont
les costumiers s'étaient enfin donné la peine de
créer les casques thraco-phrygiens et des linothorax pour
les Macédoniens.
On voit aussi les vélites romains coiffés de sortes
de torchons censés être des peaux de loup ou de renard.
Pas trop mal, pour des figurants d'arrière plan !
2.2. Les éléphants
Edward Bazalgette,
qui a précédemment réalisé un autre
docu-fiction BBC, Gengis Khan (DVD sorti en France le 7
septembre 2005) a planté ses caméras dans un petit
village nommé Platschow, près de Sofia, où
avec 400 figurants il a reconstitué la traversée
des Alpes par les pachydermes d'Hannibal, avec le concours des
éléphants (CLICK
et CLICK)
Timba, Mala et Kenia du Cirque Frankello - Sonni et Nadja Frankello
servant de cornacs.
S'agissait-il des trois mêmes pachydermes que ceux de
L'ennemi de Rome ? Nous n'en savons rien, mais après
tout cela n'aurait rien d'étonnant, question de synergie
(12)...
Hannibal, le cauchemar de Rome est sorti en DVD, en France,
le 26 avril 2006.
|
| |
|
Un tournage épique (Edward Bazalgette,
Hannibal, le cauchemar de Rome, 2005) |
|
|
II.
Encyclopédie
De tous leurs ennemis, Hannibal fut sans doute celui qui frappa
le plus l'imagination des Romains. «Fils du suffète
Hamilcar Barca, Hannibal naquit en 247 avant n.E. Son père
lui avait fait dès l'âge le plus tendre jurer sur
les autels une haine implacable aux Romains. Ayant obtenu la permission
d'aller rejoindre son oncle, qui commandait en Espagne les armées
carthaginoises après la mort d'Hamilcar, il servit trois
ans sous ses ordres, et se fit admirer par toutes les qualités
qui forment un bon soldat et un grand général.
A la mort d'Hasdrubal il fut proclamé unanimement général
en chef de l'armée carthaginoise en Espagne, quoiqu'à
peine âgé de 25 ans, et étendit dans ce pays
la domination de Carthage. Il prit et détruisit Sagonte,
ville alliée des Romains, avec lesquels Carthage était
alors en paix, et par cette infraction volontaire aux traités
ralluma la guerre entre les deux républiques rivales.
Annibal, persuadé que les Romains ne pouvaient être
vaincus que dans Rome même, résolut de faire de l'Italie
le théâtre de la guerre. Il leva trois armées
puissantes, en fit passer une en Afrique, laissa l'autre en Espagne,
et lui-même prit avec la troisième le chemin de l'Italie.
Après avoir combattu et soumis sur sa route tous les peuples
de l'Espagne et des Gaules, qui s'opposaient à sa marche,
et en avoir fait entrer un grand nombre dans son parti, il arriva
au pied des Alpes, et se disposa à les franchir, malgré
les difficultés qui semblaient insurmontables.
Après neuf jours de marche à travers des précipices
et des rochers, où il eut à souffrir des éléments
et des hommes tout ce qui pouvait décourager un autre que
lui, il parvint au sommet des Alpes. Cinq autres jours lui suffirent
pour descendre le revers des montagnes et malgré les pertes
considérables qu'avait éprouvées son armée,
il s'empara presque aussitôt de Turin (Taurasia).
C. Scipion et Sempronius l'attendaient au débouché
des montagnes. Il les défit l'un sur le Tesin (Ticinus),
et l'autre sur la Trébie (Trebia), franchit les
Apennins et envahit l'Etrurie. L'année suivante il battit
Flaminius sur les bords du lac Trasimène.
Tout pliait devant lui lorsque la sage lenteur de Fabius Maximus
vint arrêter quelque temps ses progrès. L'imprudence
de Tér. Varron et de son collègue Paul Emile lui
rendit la victoire, et l'an 216 av. J.-C. il gagne près
de Cannes (CLICK
et CLICK)
cette bataille fameuse qui mit Rome à deux doigts de sa
perte. Quarante mille Romains restèrent sur le champ de
bataille; le consul Paul Emile fut du nombre des morts. Annibal
fit chercher son corps après le combat, et lui rendit le
honneur de la sépulture.
S'il avait marché droit à Rome après cette
victoire, peut-être s'en fût-il rendu maître
à la faveur de la consternation qui y régnait; mais
ses délais laissèrent à la république
le temps de revenir de sa terreur, et de se préparer à
une nouvelle résistance.
Il alla passer l'hiver à Capoue, où ses troupes
s'amollirent dans les délices et dans le repos. Quand il
se présenta aux portes de Rome il inspira si peu de frayeur
qu'on vendit la terre même sur laquelle il était
campé.
Cependant Annibal se maintint encore plusieurs années
en Italie; il remporta des victoires, prit des villes, et s'il
ne put achever sa conquête, c'est que Rome fit des efforts
incroyables; c'est qu'elle leva dans une seule année jusqu'à
dix-huit légions, et qu'Annibal, calomnié dans sa
patrie par une faction ennemie que son absence rendait puissante,
ne reçut presque aucun secours de Carthage, et fut toujours
obligé de se soutenir par lui-même en Italie.
Marcellus, sans remporter aucun avantage décisif, lui livra
plusieurs combats qui l'affaiblirent. Enfin, le théâtre
de la guerre ayant été transporté d'Italie
en Afrique, Carthage fut obligée de rappeler Annibal, sa
dernière espérance.
Ce grand homme ne put, sans verser des pleurs, s'arracher de cette
Italie, que depuis seize ans il regardait comme sa conquête.
Arrivé en Afrique, il eut avec Scipion une entrevue où
il tenta vainement de retarder la ruine de sa patrie. Ses propositions
ayant été rejetées, il livra bataille près
de Zama 202 ans av. J.-C., et fut vaincu, quoique de l'aveu de
Scipion même, il ne se fut jamais montré plus grand
capitaine (LIV., 30, 35). Annibal s'échappa à la
faveur du tumulte, et se réfugia à Adrumète.
Mais bientôt, inquiété par les Romains, il
quitta l'Afrique, et se réfugia d'abord chez Antiochus,
roi de Syrie, et ensuite chez Prusias, roi de Bithynie.
Fidèle à la haine qu'il avait vouée au
nom romain, il arma ces deux princes contre la république;
et si Antiochus eût voulu suivre ses conseils, peut-être
Rome l'eût-elle vu de nouveau sous ses murs avec des forces
plus redoutables, et animé par la vengeance et par la honte
de sa défaite. Annibal, ne se croyant plus en sûreté
à la cour de Prusias, où un consul, député
par le sénat romain, était venu demander sa mort,
avala un poison s'il portait toujours dans le chaton de sa bague,
et délivra Rome d'un ennemi dont le nom seul lui inspirait
une terreur, qui se perpétua d'âge en âge,
plusieurs siècles après lui. Annibal mourut à
Libyssa en Bithynie, âgé de 64 ans, 183 ans av. J.-C.
Quoique Annibal ne fut pas totalement exempt des vices qu'on
reprochait à sa nation, cependant on ne peut pas se dissimuler
que Tite-Live, dans le portait qu'il a tracé de ce général,
ne se soit laissé dominer par la haine héréditaire
que lui portaient les Romains. Un courage et une fermenté
au-dessus des plus grands dangers, l'art difficile de maintenir
la subordination dans une armée composée de vingt
peuples divers, et de la faire subsister dans un pays ennemi;
une activité sans égale; enfin la hardiesse même
d'une entreprise dont les chances de succès ne pouvaient
être conçues que par un homme de génie, et
qui est resté vingt siècles sans imitateurs, tout
a placé Annibal au premier rang parmi les plus grands généraux
de l'univers» (N. Bouillet [13]).
|
| |
|
Deux portraits supposés d'Hannibal.
Celui de droite, le plus connu, est des plus hypothétiques… |
|
| |
Après avoir énuméré
ses qualités de chef, son énergie, sa tempérance,
sa rusticité de soldat et sa bravoure au combat, Tite-Live
ne manqua pas en effet de dénoncer les défauts du
capitaine ennemi : «De grands vices égalaient
de si brillantes vertus : une cruauté excessive, une perfidie
plus que punique, rien de vrai, rien de sacré pour lui,
nulle crainte des dieux, nul respect des serments, nulle religion»
(LIV., XXI, 4).
Si l'on s'en tient aux chiffres des recensements, près
de la moitié des citoyens romains mobilisables périrent
au cours des quinze années pendant lesquelles il ravagea
l'Italie. Aussi Hannibal ne risquait pas de se voir brosser un
portrait élogieux de la part d'ennemis qu'il fit tant souffrir.
D'ennemis qui écrivent l'Histoire. On peut toutefois nuancer.
Sandrine Crouset rappelle que le fils d'Hamilcar, éduqué
par deux précepteurs grecs, était pétri d'hellénisme.
Dès 215, les Romains ayant compris à quel point
la politique du général carthaginois était
dangereuse, «Fabius
Pictor, sénateur versé dans les lettres grecques,
(prit) la contre-offensive sur le terrain culturel, en écrivant
une histoire de Rome délibérément antipunique.
Hannibal prétend fonder ses alliances sur la confiance
? Mais les Puniques sont depuis longtemps réputés
pour leur mauvaise foi : quelle confiance alors lui accorder,
même dans le domaine politique ? Hannibal est aussi décrit
comme un être impie et cruel» (14). |
| Suite… |
NOTES :
(1) G.P. BAKER, Annibal (247-183
av. J.-C.), Payot, coll. «Bibliothèque Historique»,
1952. - Retour texte
(2) Ce n'était certainement
pas parce qu'une jolie romaine lui avait conté fleurette
- comme l'exposent les films de 1954 et 1960 - mais parce qu'ayant
«ramé» devant Sagonte qu'il mit huit mois
à prendre, Hannibal pourtant vainqueur à Cannes
n'osa pas s'en prendre directement à Rome et à
ses solides murailles, préférant s'en remettre
aux «délices de Capoue». «Tu sais
vaincre Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de ta victoire.»
Simple arithmétique : au milieu de ses alliés
de l'Italie centrale qui lui restèrent loyaux, Rome était
une place puissamment fortifiée, qui renfermait 270.000
citoyens mobilisables au recensement de 225 (mais guère
plus de 140.000 à celui de 209 (!)), sans compter les
esclaves, affranchis, étrangers, etc. qui pouvaient être
enrôlés, ce dont les Romains ne se privèrent
pas (ainsi, deux légions d'esclaves furent constituées).
Le Cannibale savait mesurer ses limites ! Il est vrai qu'avec
seulement 26.000 hommes...
Jules César - le «pro» de la poliorcétique
- en aura plus du double pour réduire Alésia !-
Retour texte
(3) En revanche Brûlez
Rome ! fut tourné en Tunisie, aux Studios Carthago,
et Meurtre à Rome
au Maroc (Dune Film). - Retour texte
(4) G.P. BAKER, Annibal, op. cit.
- Retour texte
(5) G. CHARLES-PICARD, Hannibal,
Hachette, 1967. - Retour texte
(6) Sans doute ce qui a amené
Jacques Martin à dessiner la reddition de Vercingétorix
sous la neige (Alix - Le Sphinx d'Or). Or Alésia
tomba au début de l'automne et aucun des peintres pompiers
qui en avaient fait le sujet de leurs toiles et dont Martin
s'inspirait visiblement, mieux documentés, n'a montré
le camp de César enneigé ! - Retour
texte
(7) Si la cotte de maille équipa
les Celtes et les Romains, ainsi que les Orientaux, jamais elle
n'eut de succès en Grèce. - Retour
texte
(8) Cf. les planches d'Angus
McBride, Spanish Armies 218BC-19BC, chez Osprey. - Retour
texte
(9) Angus McBRIDE (ill.) & Peter
WILCOX, Rome's Ennemies (2) : Gallic and British Celts,
Osprey, planche A1. - Retour texte
(10) Angus McBRIDE (ill.) & Peter
WILCOX, Rome's Ennemies (2) : Gallic and British Celts,
Osprey, planche B3. - Retour texte
(11) En fait, ce détail est
emprunté à Polybe, qui indique que les légionaires
de son époque décoraient leurs casques de plumes
noires ou pourpres. - Retour texte
(12) Encore que... l'un
tourna ses extérieurs dans les Alpes suisses, l'autre
en Bulgarie. - Retour texte
(13) N. BOUILLET, Dict.
class. de l'Antiquité sacrée et profane, 1841,
s.v. - Retour texte
(14) Sandrine CROUZET,
«Hannibal : l'homme qui a fait trembler Rome», in
L'Histoire, n 308, avril 2006. - Retour
texte
|
| |
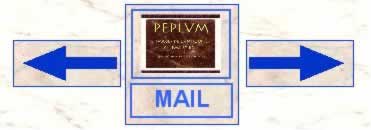 |
|