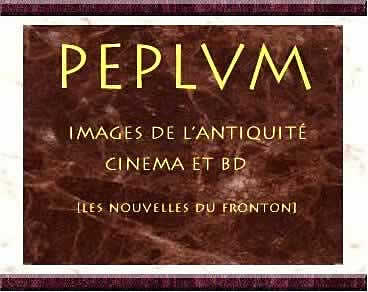 |
| |
| |
I Claudius
Moi, Claude, empereur
(Herbert Wise, TV BBC 1976)
(Page 1/3)
|
|
| |
|
|
|
| |
Les Grandes Familles...
MÉMOIRE DES JULIO-CLAUDIENS
Depuis longtemps, elle était attendue des afficionados
! La série-culte de la BBC tirée du célèbre
roman de Robert Graves (1934) et mise en scène par Herbert
Wise, Moi, Claude, empereur vient de sortir en VO + VF
chez Antartic Vidéo, dans un superbe coffret en bois, un
collector qui, sur vos rayons, prendra place avec honneur à
côté de Rome
(HBO).
Roman historique modèle du genre (il est de vingt ans antérieur
aux Mémoires d'Hadrien de Marguerite Yourcenar),
dès 1937 Josef
von Sternberg avait voulu porter à l'écran.
Moi, Claude est une saga qui, de la mort
de Marcellus en 23 av. n.E. à l'avènement de Néron
en 54 de n.E., couvre soixante-dix-sept années d'histoire
romaine, soit la naissance de l'Empire - et non sa décadence
comme on peut le lire trop souvent, hélas !, dans les magazines.
La mini-série démarre, donc, sept ans après
la victoire d'Octave-Auguste à Actium. Six ans après
que celui-ci ait, à Rome, célébré
son triomphe sur l'Egypte de Cléopâtre (et de Marc
Antoine), dont les images clôturaient la Seconde Saison
de la superbe série HBO. Nous restons donc en pays de connaissances,
retrouvant certains personnages historiques comme Octavien - désormais
Auguste - qui a pris de la bouteille, sa sœur Octavia, son
épouse Livia (bien sûr) et son fidèle Marcus
Agrippa avec lesquels nous allons refaire un bout de conduite
dans le lent cheminement de leur vie domestique, les affres de
leurs concupiscences et de leurs jalousies - de leurs amours et
de leurs haines. |
| |
|
| |
En somme, Moi,
Claude... est la continuation de Rome (HBO). Gardons-nous
cependant d'espérer y retrouver une continuité de
ton. Rome (HBO) se voulait provocatrice et réaliste
jusque dans les détails les plus sordides de la cruauté
ou de la sexualité. Rien de tout cela dans Moi, Claude...
qui est plutôt un sitcom entièrement tourné
en studio - superbes reconstitutions des intérieurs romains,
soit dit en passant - et qui a même réussi à
sucrer les rares scènes de combats de gladiateurs, que
l'on ne perçoit qu'en son off, la caméra
se contentant de filmer la loge impériale et ceux qui s'y
trouvent (ép. 1, 4 et 10). Les rares scènes dénudées
restent sages : nudité intégrale, mais filmée
de dos, de Drusilla suppliciée par son frère, ou
de Messaline et son amant Mnester. Agrippina, les vêtements
lacérés, battue à coups de cep de vigne de
la main même de Tibère. Le «viol» de
Livilla par Postumus nous laisse entrevoir un sein charmant...
Savourons quand même la joute oratoire qui oppose la prostituée
Scylla à Messaline dans un concours d'abattage. Scylla
exige d'être payée pour ses prestations. «Ce
qui est pour toi un passe-temps est, pour moi, un métier.
Moi, mon passe-temps, c'est le jardinage !» La vénale
Scylla perdra le concours - ah ! ces amateurs ! tous des gâches-métier
- mais gagnera des sesterces. Quant à la bénévole
Messaline, triomphante mais toujours insatisfaite, elle s'en retournera
dans son cubiculum, le «con encore roide» comme
disait Alfred Jarry, attentif lecteur de Juvénal.
Notons que la minisérie, point bégueule, montre
- en 1976, tout de même - desembrassements de mâles
homosexuels dans la scène du palais de Caligula transformé
en lupanar. D'aucun brave téléspectateur de la BBC
nationale a dû bondir de son rocking chair en s'exclamant :
«Good Lord ! Shocking !». L'évocation
des sortilèges entourant l'empoisonnement de Germanicus,
images à l'appui, est anthologique et directement tirée
du roman : chiens noirs sacrifiés à Hécate,
bébé nu et putréfié le front orné
de cornes, cadavres de chat, etc. (ép. 6) (cf.
R. Graves, Moi, Claude, NRF, 1964, pp. 187-188).
Le seul détail un peu trivial consiste, dans les premières
images du sixième épisode, qui découvrent
Claude vidant son pot de chambre puis se troussant sur les latrines,
où on va le retrouve juste avant le générique
de fin. «Même Tintin fait caca !», rappelait
Tibet (1).
La caméra de Rome (HBO) aimait à s'attarder
dans les quartiers interlopes de la Subure, à suivre le
parcours des gens du peuple parallèlement à celui
des protagonistes historiques. Au contraire, celle de Moi,
Claude... ne décrochera guère du Palatin (2),
ne fréquentant que du beau linge, les aristocrates des
versions latines dûment catalogués dans les fichiers
du boulevard Raspail - au Gotha des Belles-Lettres. C'est que
trente années de télévision, l'immensité
de l'Atlantique et quelques millions de dollars de budget séparent
la série britannique de 1976 de l'américaine de
2005, déterminant des choix. Déception, alors ?
Oncque nenni ! Certainement pas ! Dans Moi, Claude... les
événements dramatiques s'enchaînent et s'enchevêtrent
avec la même ponctualité que dans Rome (HBO).
Passé un générique musical insolitement dominé
par une trompette très jazzy, on conspire, on se cocufie,
on se trahit, on manipule surtout. Bref : on s'empoisonne la vie
et de douleur on se tord les bras. Les suicides par le glaive
ou le poignard, les exécutions sommaires au fond d'un cachot
y sont pléthore - au point de faire rougir de honte l'empoisonneuse
Livia, qui pourtant ne ménage pas sa peine.
Le ressort de cette saga, en somme, c'est le drame de l'Empereur
Auguste qui n'a pas d'héritier mâle pour continuer
son œuvre. Qui lui succédera à la tête
de l'Empire romain ? Son gendre, le jeune Marcellus
? Il meurt en -23. Drusus
(I), son fils adoptif, ou peut-être naturel ? Il est victime
d'un «accident» en Germanie en -9. Les fils de sa
fille Julia, Gaius et
Lucius, les «Princes de la Jeunesse» ? Lucius
décède en +2, Gaius en +4. Considéré
comme malade mental, leur frère Postumus
est écarté, exilé, et finalement exécuté
(+14). Tous meurent, les uns après les autres. Seul subsiste
Tibère, le fils de Livia...
|
| |
| 
M. Claudius Marcellus (Christopher
Guard). Au sixième livre de l'Enéide,
Enée descendu aux Enfers rencontre les âmes
des héros à venir. «Toi, tu seras
Marcellus.» Mais le Destin opposera un cruel démenti
à la prophétie que le Poète de Mantoue
avait cru courtisan de faire. Marcellus mourra à
19 ans sans avoir eu l'occasion de tenir les promesses auquel
un brillant avenir le destinait. Moi, Claude... en
fait un jeune homme fort arrogant. Ah ! bouillante jeunesse...
|
|
| |
La succession d'Auguste
(† +14)
Dans cette famille échangiste que fut celle des Julio-Claudiens,
l'on s'adopte, se divorce et se remarie entre soi. Auguste cherche
à léguer son empire à quelqu'un qui lui serait
le plus proche possible par le sang.
Née d'un premier mariage avec Scribonia, sa fille Julie
(-39 à +14) fut l'instrument de cette politique et mariée
trois fois : en -25 avec Marcellus, en -21 avec Agrippa, en -11
avec Tibère. Un petit rappel : |
| 1) |
Le premier héritier potentiel d'Auguste fut son neveu
Marcellus (-43 à -23), le fils de sa sœur
Octavie. Agé de 18 ans, il épousa Julie en -25,
mais mourut deux ans après. C'est de lui que Virgile
vante les promesses qui ne demandaient qu'à s'épanouir,
promesses hélas fauchées à la fleur de
l'âge (VIRG., En., VI, 883).
(La minisérie
en fait un jeune loup, un être fat qui se moque bien
de l'expérience acquise par ses aînés.
Pour l'avoir étudiée dans les livres, il connaît
la bataille d'Actium mieux que Marcus Agrippa qui l'a remportée
! Conflit des générations. Clin d'œil aux
téléspectateurs, surtout.) |
| 2) |
Au début de l'an -23 - donc, du vivant de Marcellus,
qui ne décédera que fin de la même année
-, Auguste gravement malade a confié son sceau personnel
à son ami et collaborateur Agrippa, qui ne tardera
pas à épouser Julie, fraîchement veuve
de Marcellus, ce qui fera de lui le second personnage de l'Empire.
Agrippa s'éteindra en -12, soit vingt-six ans avant
Auguste. Indubitablement, il n'aurait pas été
le successeur rêvé !
|
|
| |
| 
Gaius (Earl Rhodes) et Lucius Cæsar
(Russel Lewis), les «Princes de la Jeunesse».
A eux aussi, l'avenir souriait... |
|
| |
| 3) |
Les deux petit-fils d'Auguste : Gaius César
(-20 à +4) et Lucius César (-17 à
+2), qui sont les fils d'Agrippa et de Julie - laquelle donna
encore à Agrippa deux filles, Julia Minor [Julilla,
dans le roman] et Agrippina Major (Agrippine l'Aînée,
la grand-mère de Néron) et un troisième
fils né après le décès de son
père, Agrippa Postumus. Mais Gaius (3)
et Lucius César, les «Princes de la Jeunesse»,
mourront très jeunes, respectivement à 24 et
19 ans. |
| 4) |
Son beau-fils Drusus (I) (-38 à -9), fils
de Livie et frère cadet de Tibère, tous deux
nés d'un premier lit de leur mère.
Livie était enceinte de lui de six mois lorsque Octave-Auguste
la suborna.
Toutefois, Drusus - qui n'arrivait qu'en seconde ligne après
Gaius et Lucius César - mourra avant eux. |
| 5) |
Son fils adoptif Agrippa Postumus. Fils de Marcus
Agrippa et de Julie, Agrippa Post(h)umus naquit en -12, après
le décès de son père comme le rappelle
son surnom. Il sera adopté par le Prince en +4, en
même temps que Tibère. Considéré
comme arriéré mental, Postumus est bientôt
écarté des affaires de l'Etat, exilé
dans l'île de Planasie en +7, et à la mort d'Auguste
assassiné (en +14). |
| 6) |
Son beau-fils et fils adoptif Tibère, issu
d'un premier lit de Livie (-57 à +29).
Etant apparu qu'Agrippa Postumus n'aurait probablement aucune
des compétences intellectuelles requises pour devenir
«Prince» à la place du Prince, Auguste
rappela Tibère aux affaires et, «dans l'intérêt
de l'Etat», l'adopta en même temps que Postumus,
le contraignant en outre à adopter son neveu Germanicus
(4)
qui devient donc, lui-aussi, successible à la chaise
curule du «Premier des Sénateurs».
Epoux de Julie en -11, Tibère était censé
n'être qu'un «empereur de remplacement»
en cas de défaillance d'Agrippa Postumus. Ce qui arriva. |
|
| |
Dans cette conjoncture,
Livia «roulait» pour son fils Tibère, qu'elle
poussait vers le «trône impérial»; mais
Auguste n'aimait pas Tibère, qu'il trouvait renfermé
et sournois.
Il faut se rappeler que
Livia avait d'abord été la femme d'un ancien partisan
de Pompée, puis d'Antoine repenti, Tiberius Claudius Nero.
S'étant épris d'elle, Auguste l'enleva à
son époux en échange de son amnistie. A ce moment
là, Livia avait déjà un fils nommé,
comme son père, Tiberius Claudius Nero (notre Tibère)
et en attendait un second, Decimus Claudius Nero Drusus. Auguste
privilégiera toujours Drusus,
né trois jours avant leur mariage et qui était peut-être
de lui (5).
Alors que Livia préférait son fils aîné.
Les deux frères
s'aimaient, et étaient d'excellents généraux
qui soumirent l'un, Drusus, la Germanie, l'autre, Tibère,
la Pannonie et l'Illyrie. Et Drusus aura pour fils un autre excellent
général, Germanicus,
dont son oncle Tibère, à en croire Tacite, semble
avoir jalousé les prouesses militaires.
|
| |
| 
Auguste (Brian Blessed)
est maintenant le maître de Rome. Il a réuni
entre ses mains tous les pouvoirs qui font de lui un empereur
(au sens moderne du terme) sans en avoir le titre, dirigeant
une république qui n'en a plus que le nom. Une tranche
de sa vie rarement traitée à l'écran... |
|
| |
|
Le
second ressort de la série BBC consiste dans le double
mécanisme des mères-ambitieuses-à-la-place-de-leur-lourdaud-de-fils
: Livia pour Tibère, dans la première partie; Agrippin(ill)a
pour Néron, dans la seconde. Les empereurs Auguste,
puis Claude en mourront.
Au long des sept premiers épisodes, l'Impératrice
Livia apparaît
comme une sorte d'égérie du mal, l'instigatrice
de tous les malheurs familiaux qui déciment l'entourage
d'Auguste. C'est elle qui a empoisonné Marcellus en feignant
de le soigner; suscité la disgrâce de Julia envoyée
en exil; délégué son «médecin»
Musa à Drusus, qui ne se remettra jamais d'une malheureuse
chute de cheval (6);
commandité les assassinats de Gaius, Lucius, puis Germanicus;
favorisé l'adultère de Livilla avec Postumus afin
de le faire envoyer en exil dans une île déserte,
où il mourra... après avoir répandu du poison
sur les figues d'Auguste. Quelque part, Moi, Claude...
n'est pas sans faire songer - tant par la modestie de ses moyens
que par la qualité de sa mise en scène - à
la magnifique saga télévisuelle française
de Claude Barma, Les Rois Maudits, d'après le roman
de Maurice Druon. Telle la mygale, elle a patiemment tissé
la toile où se sont englués tous ceux qui faisaient
de l'ombre à son fils chéri Tibère, à
travers qui elle aurait espéré régner mieux
qu'avec son empereur de mari. Livia est vraiment la figure centrale
de la saga, son pôle négatif, une hyperactive en
tout point opposée au contemplatif narrateur Claude, son
bouffon. A côté d'elle, faisant presque figure de
has been, un Auguste
qui a pris de la bouteille et qui, se souvenant de ses frasques
de jeunesse, n'en est pas moins obsédé par l'idée
de la nécessité d'un redressement moral du monde
romain décimé et corrompu par plus d'un demi-siècle
de guerre civile. Moralité et natalité sont ses
deux obsessions. Brian Blessed campe à l'écran une
tranche de vie d'un personnage qui était plus familier
des spectateurs en tant qu'Octavien, l'éternel Père-Fouettard,
tristounet persécuteur des illicites amours d'Antoine et
Cléopâtre, tant de fois portées à l'écran.
Quelque part, sans doute, Auguste doit entretenir la nostalgie
des Romains de l'ancienne république, et de leurs vertus.
Mais celle-ci s'est elle-même sabordée au cours de
trois guerres civiles. Aussi Auguste entend-il la réformer
et - tout en gardant certaines apparences républicaines
- installer un pouvoir fort, le Principat, et asseoir sa dynastie.
C'est une des bizarreries du roman de Robert Graves que d'avoir
voulu faire de Claude un potentiel restaurateur de la république,
lui qui gouverna à travers ses affranchis !
|
| |
| 
Drusus
(Ian Ogilvy, qui prit la succession de Roger Moore dans
le rôle de Simon Templar, «Le Saint»),
le fils cadet de Livia, le conquérant de la Magna
Germania, repoussa vers l'Elbe la frontière
de l'Empire. Selon Robert Graves, il aurait toutefois eu
le tort de croire en la restauration de la république... |
|
| |
Brillant général
romain, le fils cadet de Livia, Drusus
est un idéaliste qui croit à l'inéluctable
rétablissement de la République - conviction qu'il
semble avoir transmise à son idiot de rejeton, Claude,
ainsi quà Germanicus. Aussi son ambitieuse de mère
a-t-elle reporté son affection sur son aîné
Tibère,
plus soumis et conformiste, qu'elle mène par le bout du
nez - le genre de dadais que toute mère, semble-t-il, aimerait
avoir pour progéniture ? Elle l'a contraint à divorcer
de la femme qu'il aime, la maigre Vipsania dont les formes doivent
lui rappeler celles d'un garçon («car Tibère
a des goûts spéciaux», révèle
sa seconde épouse), pour épouser cette «grosse
vache» de Julia, la fille d'Auguste, et ainsi se rapprocher
du pouvoir.
Peut-on imaginer plus
grand contraste que l'abîme séparant l'amorale et
«généreuse» Julia
et son amie et - à présent - belle-sœur, Antonia
la Jeune ? A défaut d'un improbable métro romain,
voici 2.000 ans, on peut dire que seul le char de Ben Hur ne lui
avait pas encore passé dessus : les Ælius Sextus
Balbus, les Marcus Volusius Satyricus, les Publius Norbanus Flaccus,
et même des esclaves africains tel Gershom - sans compter
les petits ambitieux sans fortune comme ce Plautius que Livia
saura retourner contre sa belle-fille. A sa décharge, reconnaissons
que son père, l'empereur, faute d'avoir un héritier
mâle de son sang, l'avait sans scrupule utilisée
pour avoir un gendre politiquement capable, et des petits-fils.
La couche de Julia était donc un lieu stratégique
pour les ambitieux, la forteresse-clef de l'Empire romain, pour
qui arriverait à l'occuper.
Nièce d'Auguste, Antonia
la Jeune était d'une toute autre trempe. La fille
d'Octavie et de Marc Antoine, était si sérieuse
et pondérée qu'en sa présence, aux thermes,
Julia elle-même reconnaissait n'oser se mettre nue comme
elle en avait pourtant l'habitude [ép. 3].
Si elle eut la joie d'être la mère d'un brillant
général, Germanicus, Antonia connut aussi l'affliction
d'avoir mis au monde cette sotte de Livilla
et cet imbécile de Clo-Clo-Claude... Livilla trompera son
époux Castor
avec Postumus d'abord, avec l'infâme Séjan
ensuite. Manipulée par Livia, elle trahira son amant Postumus
en l'accusant de l'avoir violée et le fera exiler, puis
- son oncle et beau-père Tibère empereur - elle
empoisonnera son mari, afin de favoriser les ambitions de Séjan.
En digne romaine, Antonia cloîtrera dans sa chambre sa fille
et l'y laissera mourir de faim. Puis elle dénoncera à
son beau-frère le véritable assassin de son fils
unique, et, pour le préfet du prétoire, l'homme
le plus puissant de l'Empire après l'empereur, ce sera
la chute. Alors Antonia - vengée, mais lasse - pourra se
donner la mort. En paix.
|
| |
| 
Dragon des vertus romaines,
Antonia la Jeune (Margaret Tyzack) est la maman de «Clo-Clo».
Aux thermes,
elle ne se départit jamais de sa serviette, même
lorsqu'elle s'abandonne aux paumes expertes de la masseuse.
La guillerette Julia en est très impressionnée... |
|
| |
Nous
reviendrons sur le personnage historique de Claude,
mais touchons encore deux mots à propos du personnage romanesque-filmique.
Claude est la honte de la famille; Livia, guère charitable,
dira : «Ce garçon aurait dû être abandonné
dès sa naissance.» «Ces barbaries n'ont plus
cours de nos jours», lui rétorquera Auguste qui
a finit par prendre en sympathie le jeune maladroit.
Les jeunes gens de l'impériale famille
sont élevés ensemble. Il y a les enfants de Drusus
et d'Antonia - Germanicus, Livilla et Claude
-, ceux de Julia et de feu Marcus Agrippa - Agrippina Major
et Agrippa Postumus (7)
- et, enfin, «Castor», issu du premier lit
de Tibère avec Vipsania. Germanicus taquine Agrippina en
lui jetant du sable : ils finiront par se marier. Livilla s'entend
très bien avec Castor, mais est harcelée par les
gamineries de Postumus : elle épousera Castor et aura Postumus
pour amant, mais les trahira l'un et l'autre. Tragique destinée
que celle des Julio-Claudiens dont le scénariste reconstitue
la trame par petites touches subtiles - c'est au cours de la même
séquence qu'un aigle (8)
abandonnera sa proie sur les genoux de Claude l'idiot : un petit
loup, tout ensanglanté et apeuré. Le symbole de
Rome exténuée par la «folie» des «monstres
sanguinaires» qui vont la diriger de +14 à +41.
|
|
|
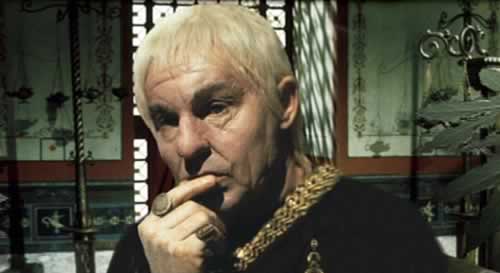
Claude, l'empereur malgré
lui, est interprété par Derek Jacobi, qui
vingt-cinq ans plus tard réendossera la toge pour
incarner le sénateur Gracchus, chef de l'opposition,
dans Gladiator de Ridley Scott
|
|
| |
«Clo-Clo-Clo-Claude...»
Le fil conducteur de la série est le regard innocent du
plus contemplatif des membres de la famille julio-claudienne :
le jeune Claude (10 av. n.E.-54 de n.E.), maintenant âgé.
Claude, qui de sa propre famille - en l'occurrence, son épouse
Agrippin(ill)a - sent venir la mort, est l'auteur de ces «mémoires».
Toute sa vie, il s'est fait passer pour idiot et insignifiant,
afin d'échapper à cette sorte de mortelle malédiction
qui semble peser sur les Julio-Claudiens. D'abord spontanément;
ensuite avec application ainsi que l'historien C. Asinius Pollion,
puis son cousin Postumus le lui ont vivement conseillé
(ép. 4). Ahuri. Maladroit. Gaffeur. Bafouilleur. Alcoolique.
Du moins, jusqu'à ce que faute de protagonistes encore
vivants, il soit à son tour choisi pour le périlleux
exercice du pouvoir.
Claude était le troisième enfant
de Drusus (I) et
d'Antonia la Jeune.
Son frère aîné était le grand Germanicus
- l'archétype du parfait général romain,
brillant et charmeur. Venait ensuite une sœur, Livilla.
Claude était la troisième roue du char. Une erreur
de la nature, qui aura pour neveu et nièce Caligula,
l'empereur dément, et Agrippin(ill)a,
la mère de l'Empereur Néron.
Fils du frère de Tibère,
le pauvre Tiberius Claudius Nero Cæsar Germanicus etc. fut
proclamé empereur à la mort de son neveu Caligula,
lequel par jeu l'avait associé à son règne
comme co-consul.
Quel danger pouvait bien représenter cet handicapé
insignifiant ? Boiteux, bègue et épileptique, mais
érudit et grand expert en civilisation étrusque,
Claude le «rat de bibliothèque» était
d'un caractère faible et irresponsable. Il se laissa gouverner
par sa femme Messaline et - surtout - par ses affranchis Pallas
et Narcisse. Mais aussi, il rétablit les finances publiques,
agrandit le port d'Ostie, consolida les frontières de l'Empire,
réduisit la Thrace en province romaine et conquit la Bretagne
méridionale (ce que César ni Caligula n'avaient
réussi).
Excédé par les débauches de son épouse
Messaline, il la fit mettre à mort et épousa Agrippine
la Jeune (Agrippinilla, dans le roman). Habile, celle-ci lui fit
adopter pour héritier son fils Néron, né
d'un premier lit. Ainsi déposséda-t-il indirectement
son propre fils Britannicus,
issu de son union avec Messaline.
|
|
| 
Livia en son boudoir. Des intérieurs
romains particulièrement soignés |
|
| |
La reconstitution BBC
Même si focalisée sur des querelles dynastico-ménagères,
la minisérie offre un tableau assez pertinent des premières
années de l'empire romain. Sans viser au monumental, les
décors des intérieurs patriciens sont superbement
restitués, et les personnages féminins très
éloignés de l'effronterie hollywoodo-cinecittienne
habituelle. Sauf quelques glamoureuses écervelées
comme Messaline, matrones et jeunes filles portent sagement la
tunica jusqu'au cou, puis par-dessus - plus échancrée
- la stola et, à la ville, la palla. Moi, Claude,
empereur, c'est quelque part les toiles d'Alma-Tadema qui
reprennent vie.
Bien sûr, nous sommes à la télévision,
et les contraintes budgétaires sont manifestes. Comme au
théâtre, ce sont des messagers qui viennent raconter
les scènes spectaculaires too much expensive que
la production n'avait pas les moyens de se permettre (le naufrage
de Lucius, le désastre de Varus pourtant rapporté
avec beaucoup de détails,
la conquête de la Bretagne par Claude, etc.).
Certaines notations sont cependant savoureuses,
ainsi lorsque Livia vient haranguer les gladiateurs qui vont se
produire à l'occasion des jeux funèbres de Drusus,
elle se comporte en cliente exigeante, qui en veut pour son argent
: pas de chiqué, pas d'embrassades «féroces»
comme cela se produit depuis quelques temps, pas de sang caché
dans des vessies de porc... «Vous n'êtes que des
bons à rien (...). Je promets aux survivants de substantielles
rémunérations, et des funérailles correctes
pour les morts.»
Il fallait s'y attendre : une pareille
reconstitution exigeait - d'abord du romancier (R. Graves), puis
du scénariste (J. Pulman) - de prendre avec l'Histoire
quelques libertés narratives. Ainsi de Gaius et Lucius
ce fut Lucius qui le premier décéda (+2), puis Gaius
(+4) - le contraire dans la mini-série (ép. 4).
De même, si les relations entre Caligula et sa sœur
préférée Drusilla
étaient peut-être troubles, celui-ci - autant qu'on
sache - ne l'assassina point, moins encore au cours du rituel
sado-masochiste auquel nous donne à assister le neuvième
épisode (cf. critiques).
Rien ne démontre non plus que Claude aspira jamais à
rétablir la république, lui qui s'en remettait à
des affranchis pour la gestion des affaires de l'Etat ! Mais la
plus grande liberté, à proprement parler, réside
sans doute dans la thèse de Robert Graves, à savoir
que ce serait l'impératrice Livia
elle-même, qui manigança la mort de tous les potentiels
prétendants à la succession d'Auguste. C'est là,
historiquement, le principal reproche que l'on puisse adresser
à Robert Graves. Bien sûr, scénaristiquement
c'était - au contraire - très fort ! Et il faut
complimenter Jack Pulman d'avoir su si bien synthétiser
le roman original, ces «mémoires de Claude»
qui étaient tout sauf linéaires.
|
| |
|

Livia (Siân Phillips), l'archi-méchante,
va jouer à la roulette-russe avec tout le casting
de la mini-série
|
|
|
BIBLIOGRAPHIE
Le romancier : Robert Graves (1895-1985)
Poète et romancier britannique d'origine française,
Robert Ranke Graves est né le 24 juillet 1895 à
Wimbledon (Angleterre) et décédé le 6 décembre
1985 à Deia (île de Majorque, Espagne), où
il s'était retiré.
Il a servi pendant la guerre de 1914 comme capitaine d'infanterie.
Marié deux fois et père de sept enfants, il a occupé
pendant de nombreuses années une chaire de poésie
à l'Université d'Oxford.
Il est surtout connu pour sa biographie historique
Moi, Claude... Mais il a aussi publié en 1929 ses
souvenirs de la Première Guerre mondiale, Goodbye to
All That.
Poète et essayiste, disciple de J.G. Frazer, Graves a renouvelé
l'étude et la connaissance des mythes. Sa profonde connaissance
des mythologies européennes lui a permis de rédiger
de nombreux ouvrages, dont deux en particulier font figure de
références dans leurs domaines respectifs: La
Déesse Blanche (aujourd'hui rééditée
sous le titre Les mythes celtes), et Les mythes grecs.
Il a également écrit de nombreux romans historiques,
La Toison d'or, notamment, ainsi qu'une biographie du colonel
T.E. Lawrence, Lawrence et les Arabes. Le culte d'une Grande
Déesse Mère et d'un passé matriarcal obsède
son œuvre. Aussi est-il parfois cité comme coscénariste
des Amazones de Terence Young (1973), comédie malicieuse
et parfois coquine sur la guerre des sexes et le matriarcat dans
la mythologie grecque.
Bibliographie française succincte
(Par ordre chronologique de l'édition anglaise.) |
| — |
Lawrence et les Arabes (Lawrence and the Arabs.
London: Jonathan Cape, 1927; as Lawrence and the Arabian
Adventure. New York: Doubleday, 1928), Gallimard-N.R.F.,
1933, 1948; (préface et chronologie Roger Stéphane
- suivi d'une sélection de lettres de T.E. Lawrence),
Payot, coll. «Voyageurs Payot», 1990, 319 p. (trad.
Jeanne Roussel) [biographie]; |
| — |
-Moi, Claude, empereur (I, Claudius : from the
autobiography of Tiberius Claudius emperor of the Romans.
London: Arthur Barker, 1934; New York: Smith & Haas, 1934
- Claudius the God and his Wife Messalina. London:
Arthur Barker, 1934; New York: Smith & Haas, 1935), Plon,
1939; rééd. Gallimard-NRF, 1964, 1 vol. (9),
357 p.; [à l'occasion de la sortie de la série-TV
:] rééd. Gallimard-NRF en trois volumes : I.
Moi, Claude, 1978, 343 p. (trad. angl. Mme Rémond-Pairault);
II. Claude, empereur malgré lui, 1978, 255 p.
(trad. Paule Guivarch, Janine Hérisson & Marie-Lise
Marlière); III. Le divin Claude et sa femme Messaline,
1978, 290 p. (trad. Paule Guivarch, Janine Hérisson
& Marie-Lise Marlière) [roman]; |
| — |
Le comte Bélisaire (Count Belisarius.
London: Cassell, 1938: Random House, New York, 1938), 1ère
éd. française [?], 1966; rééd.
Flammarion, 1987, 413 p. (trad. angl. Michel Courtois-Fourcy)
[roman];
|
| — |
L'épouse de Monsieur Milton (The Story
of Marie Powell: Wife to Mr. Milton. London: Cassell,
1943; as Wife to Mr Milton: The Story of Marie Powell.
New York: Creative Age Press, 1944), L'Age d'Homme [roman]; |
| — |
La Toison d'or (The Golden Fleece. London:
Cassell, 1944; as Hercules, My Shipmate. New York:
Creative Age Press, 1945), Gallimard, coll. «L'histoire
fabuleuse», 1964, 546 p. (trad. angl. A. Der Nersessian)
[roman]; |
| — |
King Jesus (King Jesus. New York: Creative
Age Press, 1946; London: Cassell, 1946), Stock, coll. «Nouveau
Cabinet Cosmopolite», 1993, 572 p. (trad. angl. Claude
Seban) [roman]; |
|
| |
| 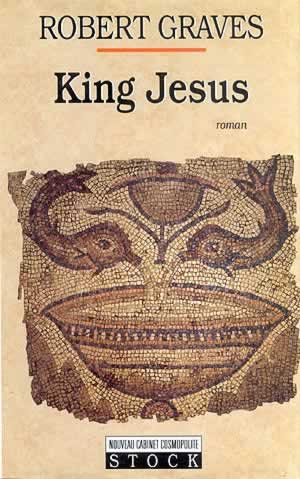
La traduction française
de cette vie de Jésus revisitée à la
lueur du substrat matriarcal des religions sémitiques,
a conservé tel quel le titre anglais |
|
| |
| — |
La Déesse Blanche. Un mythe poétique expliqué
par l'histoire (The White Goddess. London: Faber
& Faber, 1948; New York: Creative Age Press, 1948; rev.,
London: Faber & Faber, 1952, 1961; New York: Alfred. A.
Knopf, 1958), Editions du Rocher, coll. «Gnose»,
1979, 583 p. (trad. Guy Trévoux); rééd.
Les mythes celtes, la déesse blanche, Editions
du Rocher, 1989 [essai]; |
| — |
Les Mythes grecs (The Greek Myths. London:
Penguin, 1955; Baltimore: Penguin, 1955), 1958; Fayard, 1967,
666 p. (trad. Mounir Hafez) [essai]; |
| — |
(avec Raphael PATAI) Les Mythes hébreux (Hebrew
Myths. The Book of Genesis. New York: Doubleday, 1964;
London: Cassell, 1964), Fayard, 1987, 294 p. (trad. Jean-Paul
Landais) [essai]. |
|
| |
(Sa bibliographie
anglaise sur Wikipedia.)
Le roman : Moi, Claude, empereur (1934)
Voici les quatrièmes plats de couverture de la réédition
NRF.
I. Moi, Claude
Tibère Claude, «Claude l'avorton», comme
l'appelait sa mère, Claude qui boite et bégaie,
prend ici la parole et, à la veille d'être empereur,
fait le bilan de son existence.
Enfant souffreteux et
mal aimé, délicat et sensible, il est le canard
boiteux de la famille. Historien en chambre, il gagne par son
érudition et son équilibre les faveurs d'Auguste
et de Livie, sa grand-mère, qui en fait un prêtre
de Mars. Mais il est si sensible qu'il s'évanouit à
la vue du sang au cours d'un combat de gladiateurs.
A treize ans il rencontre,
au jardin de Salluste, Camille qui en a onze. Ils s'éprennent
l'un de l'autre et veulent se fiancer, mais Livie fait tuer la
jeune fille d'un coup d'épingle empoisonnée et force
Claude à épouser un Hercule femelle de seize ans,
la robuste Urgulanille qui le déteste. Il s'en sépare
bientôt pour épouser Ælia, la nièce
de Séjan (10).
Tibère, son oncle, vieux beau cupide, qui préfère
à ses devoirs d'empereur les délices de sa résidence
de Capri, le contraint à la répudier. Lorsque Tibère
meurt, par abus des aphrodisiaques, c'est son fils adoptif, Caligula,
qui lui succède : mégalomane, sanguinaire, dépravé,
il se fait déifier de son vivant, nomme son cheval consul,
dilapide le trésor public et tente de le renflouer en prostituant
ses sœurs. Peu de temps avant de se faire assassiner, Caligula
trouve plaisant de jeter la belle Messaline, âgée
de dix-sept ans, dans les bras de Claude, alors quinquagénaire,
qui s'éprend éperdument d'elle.
Comment cet intellectuel
perspicace et sarcastique, et pourtant débonnaire, a-t-il
pu survivre au règne de trois empereurs prêts à
supprimer quiconque portait ombrage à leur pouvoir ? Comment
a-t-il pu échapper à tant de pièges et de
meurtres pour hériter finalement d'une couronne qu'il ne
désirait pas ? Historien animé d'un impitoyable
souci de vérité, Claude nous dévoile sur
l'Empire et sur Rome des intrigues à faire frémir.
|
| |
|
A gauche l'édition NRF de 1964,
à droite les trois volumes de 1978 |
|
| |
II. Claude,
empereur malgré lui
En 41 après Jésus-Christ, Caligula est assassiné.
Claude, son oncle, découvert par les soldats mal caché
derrière un rideau, se retrouve sur le trône. Il
a cinquante et un ans. Boiteux, dur d'oreille, inadapté,
il est la risée de Rome. C'est un rat de bibliothèque
qui se passerait bien de l'honneur qu'on lui fait. Mais il n'a
pas le choix. Heureusement, Hérode Agrippa, le neveu du
grand Hérode de l'Evangile, son ancien compagnon d'études,
est là pour lui dispenser ses conseils. Un portrait savoureux
d'Hérode nous le montre astucieux, retors, sagace, affairiste,
truqueur, mais fidèle en amitié.
Claude est républicain
dans l'âme. Il gouverne contraint et forcé et, malgré
sa naïveté, son ignorance des arcanes du pouvoir,
il va réorganiser les finances, reconstituer le trésor
public dilapidé par les extravagances de Tibère
et de Caligula, réprimer les abus et les corruptions, supprimer
les pots-de-vin. Il se soucie du bien-être de Rome, fait
édifier des aqueducs, aménager le port d'Ostie,
pour permettre le ravitaillement des Romains en toute saison.
Soucieux de la stabilité de l'Empire, il contient sur les
rives du Rhin les tribus germaniques en effervescence.
Mais ces accomplissements
pèsent lourdement sur sa vie, il ne rêve que d'échapper
aux contraintes du pouvoir et de restaurer la République.
III. Le Divin Claude et sa femme Messaline
Dans ce dernier volet des mémoires de l'Empereur Claude,
nous le voyons céder peu à peu à la griserie
du pouvoir. Il entreprend la conquête de l'Angleterre. La
guerre de chars attelés à des poneys, menée
par les Bretons, le déroute d'abord, mais il a tôt
fait d'adapter son armement et ses méthodes de combat à
ces tactiques guerrières qui lui sont inconnues. Sa victoire
le rend populaire et Rome lui fait un triomphe.
Messaline, sa troisième
épouse, le mène par le bout du nez. Aveuglé
par la passion, il sera le dernier à apprendre les débordements
et les indélicatesses de sa femme : trafic de droit de
cité, de titres de sénateur, de monopoles commerciaux.
Non contente de se refuser à lui, elle se vautre dans le
stupre avec une audace confondante. C'est la vieille maîtresse
de Claude, Calpurnia, ancienne prostituée au grand cœur,
qui lui ouvrira les yeux sur l'atmosphère de corruption
qui règne autour de lui à son insu. Mais Claude
ne se consolera pas de l'exécution de Messaline, à
laquelle il n'a pu ni voulu s'opposer. Pour sa perte, il épousera
Agrippine, qui lui réservera le sort que l'on sait.
Avec un parti pris
avoué d'anachronisme, Robert Graves fait revivre cette
période des débuts de l'ère chrétienne
comme s'il s'agissait d'un épisode de l'histoire moderne.
Le parallèle entre l'Antiquité et l'actualité
est sous-jacent tout au long de l'ouvrage. Certes, les mœurs
ont changé à bien des égards, mais les hommes,
eux, demeurent tels qu'ils ont toujours été : intègres
ou rusés, lâches ou courageux, avides de pouvoir
ou d'argent, pervers, glorieux. Ce journal imaginaire, fondé
sur une scrupuleuse documentation historique, est aussi passionnant
qu'un roman, aussi vivant que le reportage d'un témoin
oculaire. Il laisse du divin Claude l'image humaine, trop humaine
d'une destinée intemporelle.
|
| Suite… |
NOTES :
(1) Crobard griffonné sur une
serviette de restaurant glissé à Jacques Martin,
à l'occasion d'une homélie d'Hergé à
propos de ce que peu se permettre, ou non, un dessinateur de
BD collaborateur à Tintin (G. LEFORT & M.
LINDON, «Jacques Martin classé AliX», Libération,
5 septembre 1996). - Retour texte
(2) Sauf pour retrouver entre les
quatre murs de sa villa confortable, Tibère, en exil
à Rhodes ou retiré à Capri, ou entre les
quatre panneaux de toile de sa tente, Drusus, en Germanie. -
Retour texte
(3) S'agissant de Gaius Cæsar,
nous avons pris le parti de toujours orthographier «Gaius»
avec un «G», selon la préférence générale
anglo-saxonne, réservant le «C» à
tous les autres «Caius» de la mini-série.
Bien entendu, l'usage latin utilisait indifféremment
le «G» ou le «C» selon les tendances
de l'époque. - Retour texte
(4) Les historiens ont pris l'habitude
de nommer «Germanicus»
C. Julius Cæsar Germanicus, le fils aîné
de Drusus (I) -
le «pacificateur» de la Germanie - à qui
avait été attribué ce cognomen en raison
de son triomphe militaire sur les Barbares. - Retour
texte
(5) Quoique la chronologie semble
s'y opposer. Livia était enceinte de six mois lorsque
Octavien obtint qu'elle divorce de son premier mari. Mais il
semble que le Prince succomba à une passion foudroyante
et ne la connaissait que depuis quelques jours. D'ailleurs,
l'exilé Tiberius Claudius et son épouse étaient-ils
déjà rentrés à Rome, lorsque Livia
conçut ce fils (mi-avril 38) ? - Retour
texte
(6) En fait, Musa était le
médecin d'Auguste, que l'on avait également soupçonné
d'avoir quelque responsabilité dans la mort de Drusus.
Plus loin dans la minisérie, l'on voit Livia prendre
de l'ascendant sur Musa, qui n'a pu sauver Marcellus (et pour
cause !). Cependant, Moi, Claude... délivrera
un quitus à Livia, lorsque celle-ci, en veine
de confidences, déclinera la liste de ses
victimes - dont elle exclut expressément Drusus et
Germanicus. - Retour texte
(7) Cette séquence de l'épisode
3 fait ici l'impasse sur les aînés d'Agrippa :
Gaius et Lucius [et Julilla]), plus âgés, que l'on
a vus enfants dans l'épisode 2. - Retour
texte
(8) Suétone rapporte que, sous
Caligula, Claude «fut son collègue au consulat
pendant deux mois. La première fois qu'il parut au Forum
avec les faisceaux, un aigle qui passait vint se percher sur
son épaule droite» (SUÉT., Claude,
VII). - Retour texte
(9) En fait, seulement le tome I de
la trilogie. - Retour texte
(10) Ou sa sœur adoptive (N.d.M.E.).
- Retour texte
|
| |
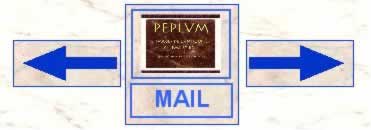 |
|